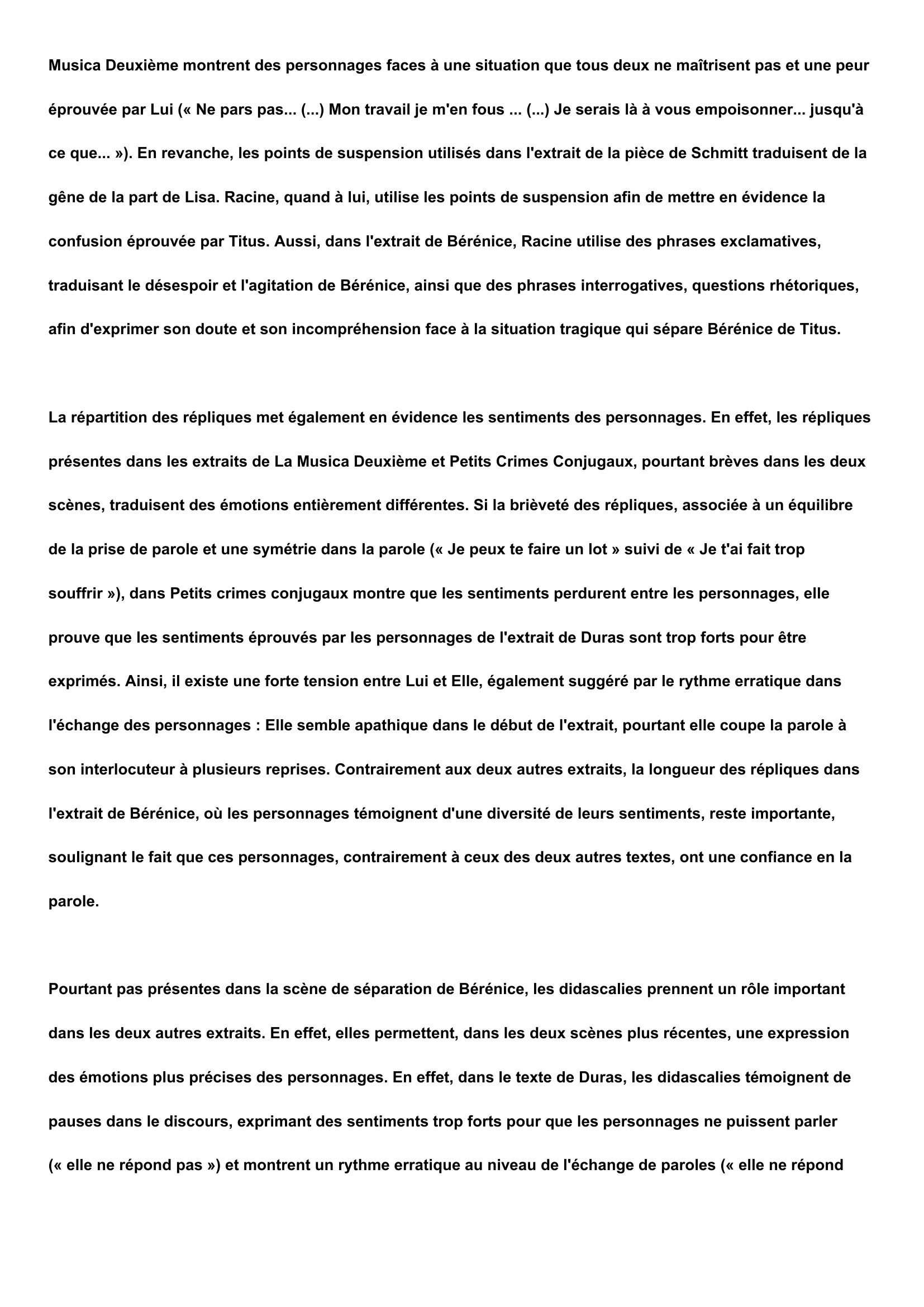Corpus Racine, Duras, Schmitt
Publié le 30/11/2013

Extrait du document


«
Musica Deuxième montrent des personnages faces à une situation que tous deux ne maîtrisent pas et une peur
éprouvée par Lui (« Ne pars pas...
(...) Mon travail je m'en fous ...
(...) Je serais là à vous empoisonner...
jusqu'à
ce que... »).
En revanche, les points de suspension utilisés dans l'extrait de la pièce de Schmitt traduisent de la
gêne de la part de Lisa.
Racine, quand à lui, utilise les points de suspension afin de mettre en évidence la
confusion éprouvée par Titus.
Aussi, dans l'extrait de Bérénice, Racine utilise des phrases exclamatives,
traduisant le désespoir et l'agitation de Bérénice, ainsi que des phrases interrogatives, questions rhétoriques,
afin d'exprimer son doute et son incompréhension face à la situation tragique qui sépare Bérénice de Titus.
La répartition des répliques met également en évidence les sentiments des personnages.
En effet, les répliques
présentes dans les extraits de La Musica Deuxième et Petits Crimes Conjugaux, pourtant brèves dans les deux
scènes, traduisent des émotions entièrement différentes.
Si la brièveté des répliques, associée à un équilibre
de la prise de parole et une symétrie dans la parole (« Je peux te faire un lot » suivi de « Je t'ai fait trop
souffrir »), dans Petits crimes conjugaux montre que les sentiments perdurent entre les personnages, elle
prouve que les sentiments éprouvés par les personnages de l'extrait de Duras sont trop forts pour être
exprimés.
Ainsi, il existe une forte tension entre Lui et Elle, également suggéré par le rythme erratique dans
l'échange des personnages : Elle semble apathique dans le début de l'extrait, pourtant elle coupe la parole à
son interlocuteur à plusieurs reprises.
Contrairement aux deux autres extraits, la longueur des répliques dans
l'extrait de Bérénice, où les personnages témoignent d'une diversité de leurs sentiments, reste importante,
soulignant le fait que ces personnages, contrairement à ceux des deux autres textes, ont une confiance en la
parole.
Pourtant pas présentes dans la scène de séparation de Bérénice, les didascalies prennent un rôle important
dans les deux autres extraits.
En effet, elles permettent, dans les deux scènes plus récentes, une expression
des émotions plus précises des personnages.
En effet, dans le texte de Duras, les didascalies témoignent de
pauses dans le discours, exprimant des sentiments trop forts pour que les personnages ne puissent parler
(« elle ne répond pas ») et montrent un rythme erratique au niveau de l'échange de paroles (« elle ne répond.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Résumé scène par scène de Britannicus, Racine
- Le classicisme La Thébaïde, Racine, 1664
- La politique, c'est la distinction de l'ami et l'ennemi de Schmitt
- ANALYSE LINEAIRE PHEDRE DE RACINE ACTE II SCENE 5
- Bérénice (1671) de Jean Racine (1639-1699)