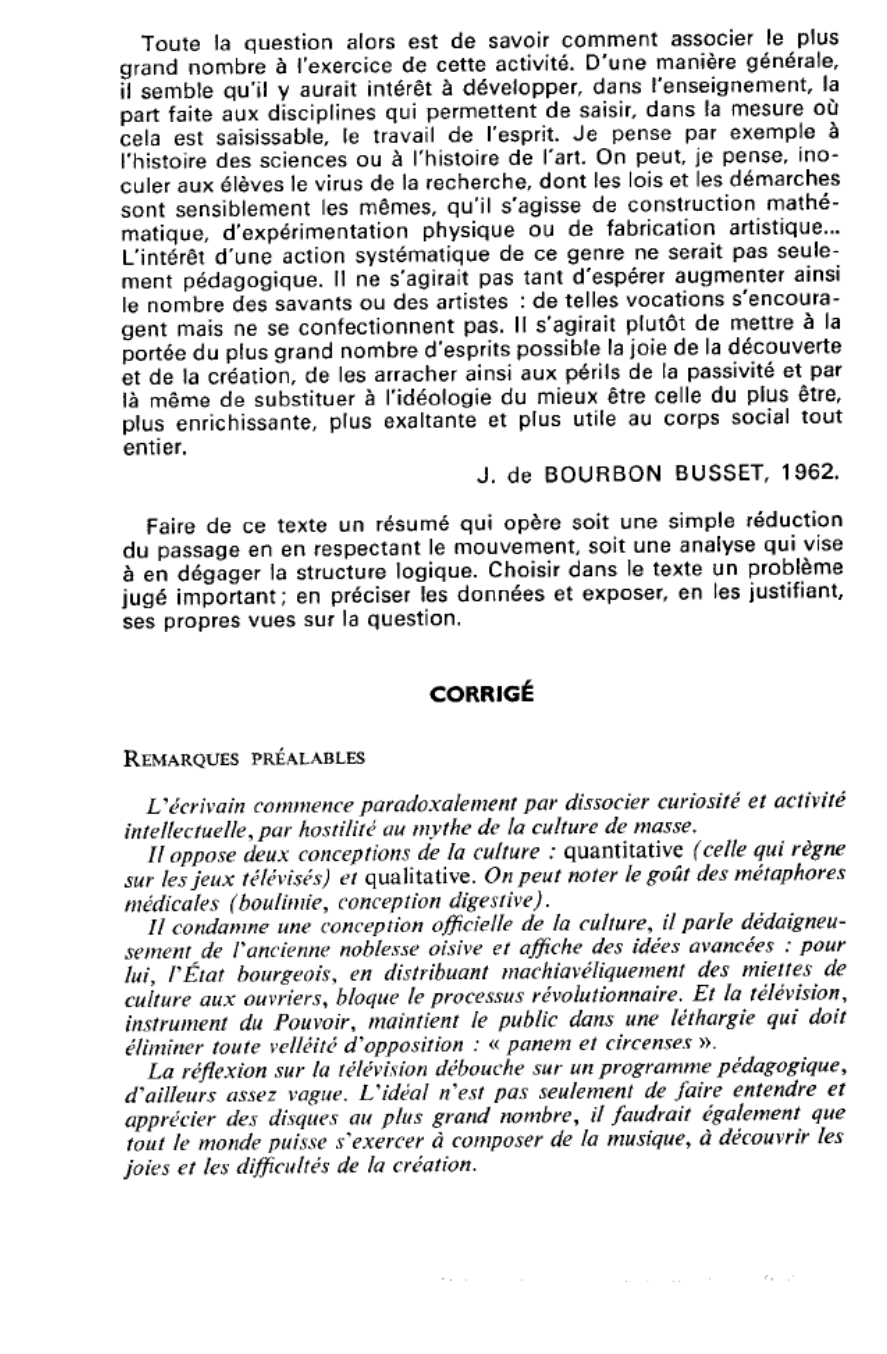CURIOSITÉ ET ACTIVITÉ DE L'ESPRIT de J. de BOURBON BUSSET, 1962. Commentaire
Publié le 10/11/2016

Extrait du document

CURIOSITÉ ET ACTIVITÉ DE L'ESPRIT
Qu'il s'agisse de science ou de culture, nous montrons une même tendance à confondre la curiosité avec l'activité de l'esprit. Le lecteur de magazines, le téléspectateur montrent une grande curiosité, un grand désir de s'informer. Cela est bien, à la condition qu'ils ne s'imaginent pas qu'en assouvissant leur curiosité ils déploient une activité intellectuelle.
La curiosité est un assouvissement, une passivité. Elle n'a rien à voir avec le jeu de l'esprit. La curiosité n'est en effet reliée à rien, sinon à une sorte de boulimie qui s'attache bien plus à la quantité ingérée qu'à la qualité. Il y a dans la curiosité un désir de rendement pour ainsi dire. Il s'agit dans le minimum de temps et d'espace d'accumuler le maximum d'informations, de sensations, d'idées : « conception digestive ». La culture devient non plus un refuge comme autrefois mais un poids.
La culture devient aussi un appoint, comme un élément surajouté qui vient remplir un vide, tous ces temps morts appelés loisirs. On assiste ainsi à une résurrection de la conception « culture ornement », mais cette fois il s'agit d'orner l'esprit non de belles dames qui s'ennuient, mais d'ouvriers qu'il vaut mieux soustraire à une inquiétude qui peut prendre des formes dangereuses pour la paix sociale. La chose sera d'autant plus facile que les techniques modernes de diffusion suivent naturellement la ligne de plus grande pente et que déjà, elles s'emploient, sous le prétexte de la distraction, de l'information et de l'instruction, à anesthésier le sens critique des auditeurs et des spectateurs. Les jeux radiophoniques ne s'adressent qu'à la mémoire.
Cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas un incontestable progrès de la culture... Jamais certes Mozart n'a eu autant d'auditeurs, ni Shakespeare de lecteurs. Il en résulte une très sensible augmentation du niveau d'absorption du matériel culturel.
Mais de même que la science ne se confond pas avec la somme des théories ou des découvertes, la culture ne se confond pas avec l'accumulation des tableaux, des partitions et des livres. Pour l'art comme pour la science, l'essentiel est l'exercice d'une activité qui pour celui qui s'y adonne importe plus encore que le produit...
Remarques préalables
L'écrivain commence paradoxalement par dissocier curiosité et activité intellectuelle, par hostilité au mythe de la culture de masse.
Il oppose deux conceptions de la culture : quantitative (celle qui règne sur les jeux télévisés) et qualitative. On peut noter le goût des métaphores médicales (boulimie, conception digestive).
Il condamne une conception officielle de la culture, il parle dédaigneusement de l'ancienne noblesse oisive et affiche des idées avancées : pour lui, l'État bourgeois, en distribuant machiavéliquement des miettes de culture aux ouvriers, bloque le processus révolutionnaire. Et la télévision, instrument du Pouvoir, maintient le public dans une léthargie qui doit éliminer toute velléité d'opposition : « panem et circenses ».
La réflexion sur la télévision débouche sur un programme pédagogique, d'ailleurs assez vague. L'idéal n'est pas seulement de faire entendre et apprécier des disques au plus grand nombre, il faudrait également que tout le monde puisse s'exercer à composer de la musique, à découvrir les joies et les difficultés de la création.
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Curiosité et activité de l'esprit
- «Notre civilisation est une somme de connaissances et de souvenirs accumulés par les générations qui nous ont précédés. Nous ne pouvons y participer qu'en prenant contact avec la pensée de ces générations... » A. Maurois, mai 1961 «Les jeunes gens admettent très difficilement la valeur de l'expérience... la mutation brusque que nous vivons, l'avènement de la société scientifique, disqualifie sérieusement, il faut le dire, l'expérience des générations précédentes. » J. de Bourbon-Busset
- CURIOSITÉ ET ACTIVITÉ DE L'ESPRIT
- Commentaire de texte : L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme de Max Weber
- ACTIVITÉ MENTALE (L’) et Les éléments de l’esprit. (résumé & analyse)