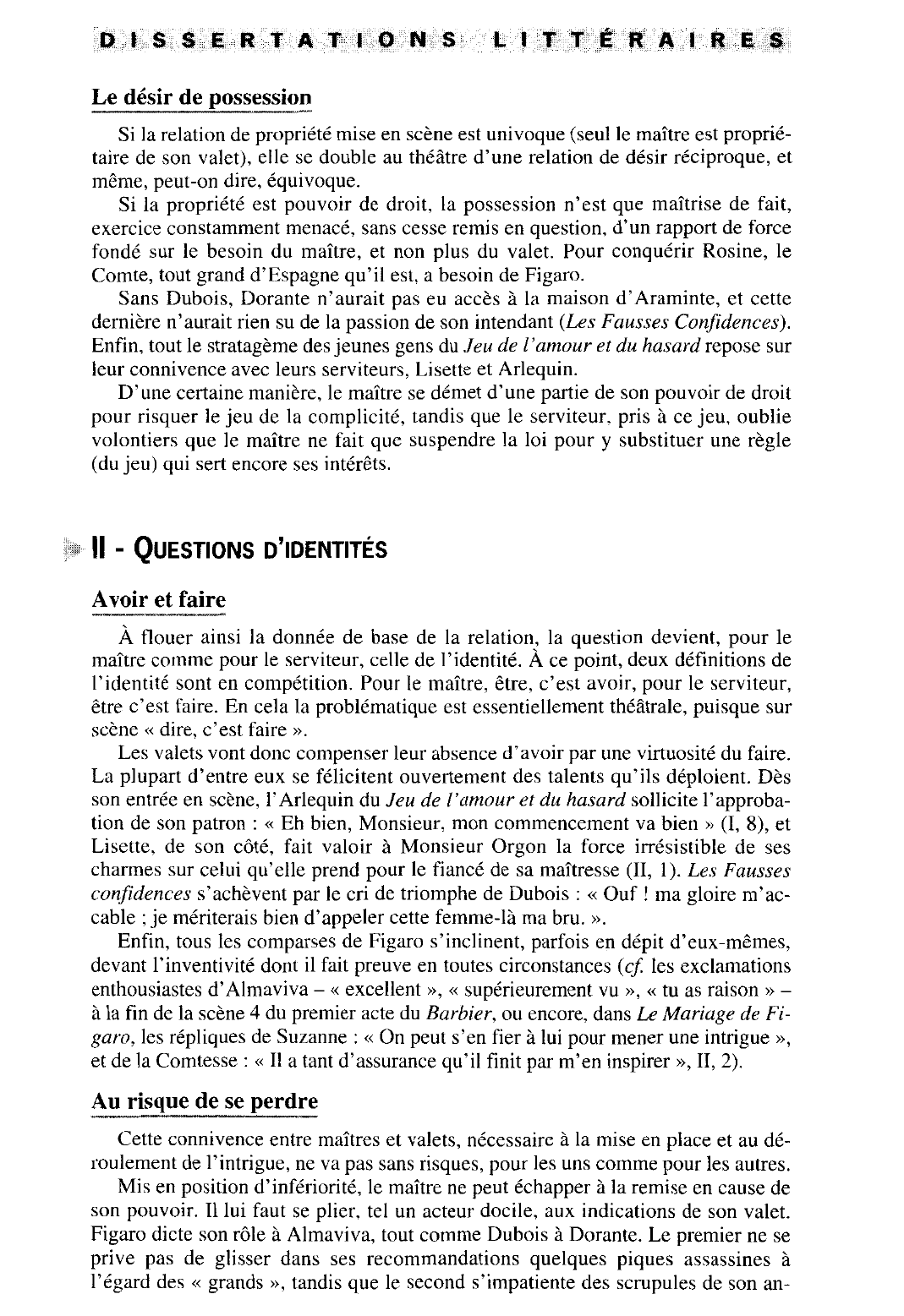De quelle manière et dans quel but le jeu théâtral transforme-t-il la relation entre martres et valets ?
Publié le 15/03/2015

Extrait du document
À flouer ainsi la donnée de base de la relation, la question devient, pour le maître comme pour le serviteur, celle de l'identité. À ce point, deux définitions de l'identité sont en compétition. Pour le maître, être, c'est avoir, pour le serviteur, être c'est faire. En cela la problématique est essentiellement théâtrale, puisque sur scène « dire, c'est faire «.
Les valets vont donc compenser leur absence d'avoir par une virtuosité du faire. La plupart d'entre eux se félicitent ouvertement des talents qu'ils déploient. Dès son entrée en scène, l'Arlequin du Jeu de l'amour et du hasard sollicite l'approbation de son patron : « Eh bien, Monsieur, mon commencement va bien « (I, 8), et Lisette, de son côté, fait valoir à Monsieur Orgon la force irrésistible de ses charmes sur celui qu'elle prend pour le fiancé de sa maîtresse (II, 1). Les Fausses confidences s'achèvent par le cri de triomphe de Dubois : « Ouf ! ma gloire m'accable ; je mériterais bien d'appeler cette femme-là ma bru. «.
«
D 1 S S E R T A T 1 .0 N S LITTÉRAIRES
Le désir de possession
Si la relation de propriété mise en scène est univoque (seul le maître est proprié
taire de son valet), elle se double au théâtre d'une relation de désir réciproque, et
même, peut-on dire, équivoque.
Si la propriété est pouvoir de droit, la possession
n'est que maîtrise de fait,
exercice constamment menacé, sans cesse remis en question,
d'un rapport de force
fondé sur le besoin du maître, et non plus du valet.
Pour conquérir Rosine, le
Comte, tout grand d'Espagne qu'il est, a besoin de Figaro.
Sans Dubois, Doran te n'aurait pas eu accès à la maison
d' Araminte, et cette
dernière n'aurait rien
su de la passion de son intendant (Les Fausses Confidences).
Enfin, tout le stratagème des jeunes gens du Jeu
de l'amour et du hasard repose sur
leur connivence avec leurs serviteurs, Lisette et Arlequin.
D'une certaine manière, le maître se démet d'une partie de son pouvoir de droit
pour risquer le
jeu de la complicité, tandis que le serviteur.
pris à ce jeu, oublie
volontiers que le maître ne fait que suspendre la loi pour
y substituer une règle
(du jeu) qui sert encore ses intérêts.
Il -QUESTIONS D'IDENTITÉS
A voir et faire
À flouer ainsi la donnée de base de la relation, la question devient, pour le
maître comme pour le serviteur, celle de l'identité.
À ce point, deux définitions de
l'identité sont en compétition.
Pour le maître, être, c'est avoir, pour le serviteur,
être
c'est faire.
En cela la problématique est essentiellement théâtrale, puisque sur
scène « dire, c'est faire ».
Les valets vont donc compenser leur absence d'avoir par une virtuosité du faire.
La plupart d'entre eux se félicitent ouvertement des talents qu'ils déploient.
Dès
son entrée en scène,
r Arlequin du Jeu de l'amour et du hasard sollicite !' approba
tion de son patron :
« Eh bien, Monsieur, mon commencement va bien » (I, 8), et
Lisette, de son côté, fait valoir à Monsieur Orgon la force irrésistible de ses
charmes sur celui qu'elle prend pour le fiancé de sa maîtresse (II, 1).
Les Fausses
confidences s'achèvent par le cri de triomphe de
Dubois:« Ouf! ma gloire m'ac
cable ;
je mériterais bien d'appeler cette femme-là ma bru.
».
Enfin, tous les comparses de Figaro s'inclinent, parfois en dépit d'eux-mêmes,
devant l'inventivité dont
il fait preuve en toutes circonstances (cf les exclamations
enthousiastes d' Almaviva -
« excellent », « supérieurement vu », « tu as raison » -
à la fin
de la scène 4 du premier acte du Barbier, ou encore, dans Le Mariage de Fi
garo, les répliques de Suzanne:« On peut s'en fier à lui pour mener une intrigue»,
et de la Comtesse:« Il a tant d'assurance qu'il finit par m'en inspirer», II, 2).
Au risque de se perdre
Cette connivence entre maîtres et valets, nécessaire à la mise en place et au dé
roulement de l'intrigue,
ne va pas sans risques, pour les uns comme pour les autres.
Mis en position d'infériorité, le maître
ne peut échapper à la remise en cause de
son pouvoir.
Il lui faut se plier, tel un acteur docile, aux indications de son valet.
Figaro dicte son rôle à Almaviva, tout comme Dubois à Dorante.
Le premier ne se
prive pas de glisser dans ses recommandations quelques piques assassines à
l'égard
des« grands», tandis que le second s'impatiente des scrupules de son an-
~MAÎTRES ET VALETS.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- L'apologue, petit récit à visée morale est une forme d'argumentation indirecte dont le but est de faire passer un message. Est-il selon vous plus efficace d'argumenter à l'aide de récits imagés plutôt que de manière directe ?
- Il faudrait un génial stratège pour transposer dans le pré carré de la politique fédérale une manière de grand jeu de bascule de l'équilibre européen. Le Temps.ch
- La relation maitre-valet das "le jeu de l'amour et du hasard" de Marivaux
- «Dans la mémoire des Français, le XVIIe siècle joue un peu le rôle d'une référence par rapport à laquelle on juge tout le reste, comme, avant le classicisme, on jugeait tout par rapport à l'antiquité. Cela tient peut-être au fait que ; par rapport aux siècles qui l'on précédé, il inaugure les temps modernes. Mais on peut croire aussi qu'en dépit des luttes qui ont marqué son histoire il évoque la pensée d'une certaine cohésion : l'approche, par différentes avenues, d'un commun idéal de
- Toute relation érotique doit être vécue de manière qu'il vous soit facile d'en évoquer une image avec tout ce qu'il y a de beau en elle. Le Journal du séducteur (1843) Kierkegaard, Søren Aabye. Commentez cette citation.