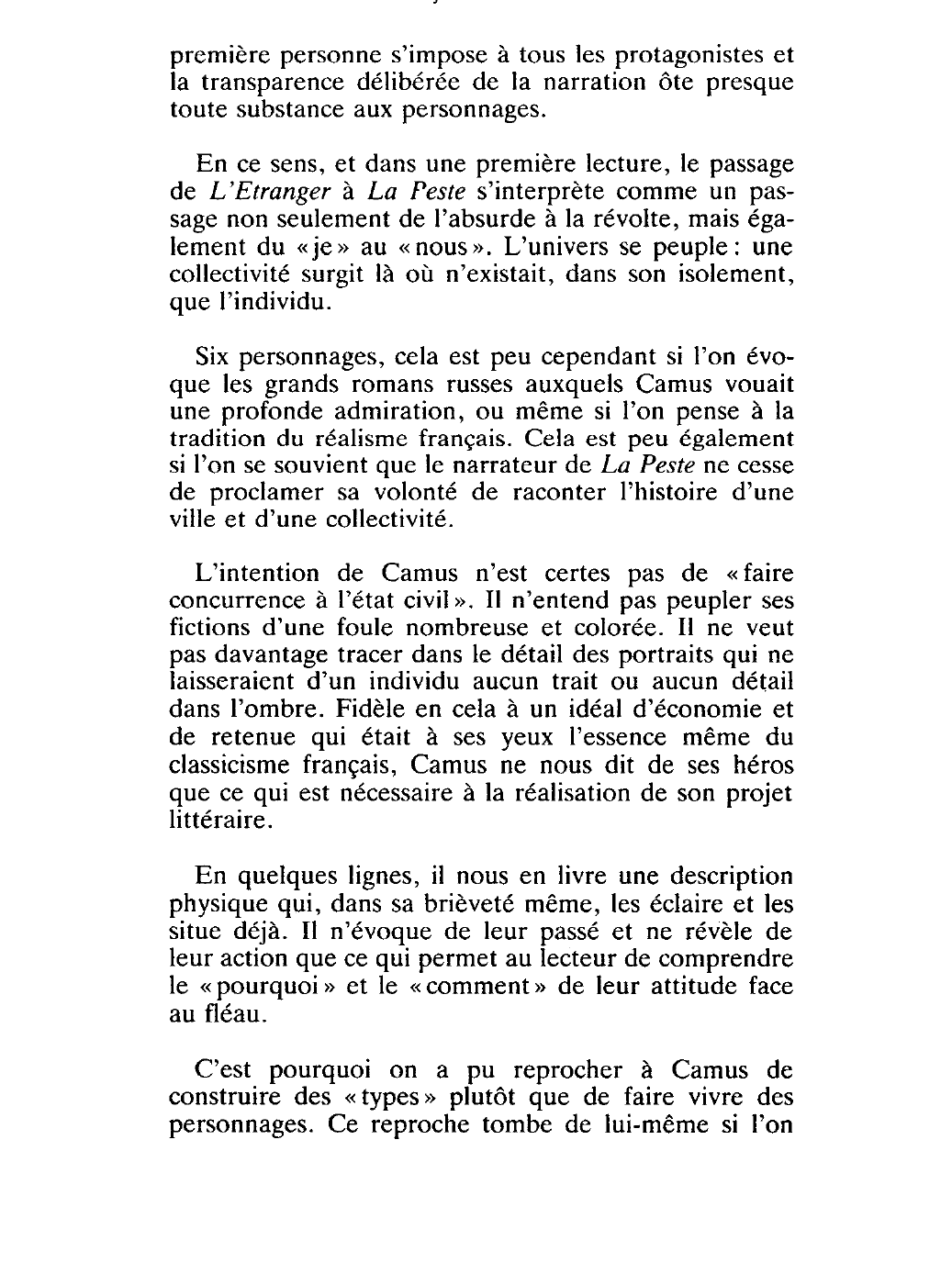Destins individuels, histoire collective dans La Peste de Camus
Publié le 09/08/2014

Extrait du document

Au début de cette troisième partie du roman, qui est pour Camus l'occasion de tracer un tableau d'ensemble de l'épidémie et de ses ravages, le narrateur note : «... en fait, on pouvait dire à ce moment, au milieu du mois d'août, que la peste avait tout recouvert. Il n'y avait plus alors de destins individuels, mais une histoire collective qui était la peste et des sentiments partagés par tous. «
Roman dans lequel évoluent des personnages à l'identité bien marquée, récit qui relate le drame d'une société unifiée soudain par la crainte et la douleur, La Peste, tout au long d'elle-même, tresse ensemble l'histoire de tous et celle de chacun. Les gros plans et les visions d'ensemble alternent : soigneusement sélectionnés pour leur exemplarité, quelques portraits se détachent sur la toile de fond de l'épidémie; de la réunion de quelques destins émerge la figure d'une collectivité. De cette dialectique du « je « et du « nous « naît, dans une large mesure, le sens de La Peste.
Personnages et types
Dans La Peste, six personnages au total occupent, à tour de rôle, le devant de la scène. C'est à la fois peu et beaucoup.
Beaucoup, si l'on compare le second roman de Camus avec L'Etranger ou La Chute : dans ces textes, tout se ramène sans ambiguïtés à la conscience singulière d'un être unique par lequel existent tous les autres protagonistes. Nous ne connaissons Marie, Céleste ou Raymond qu'à travers Meursault : le filtre du récit à la

«
première personne s'impose à tous les protagonistes et
la transparence délibérée de la narration
ôte presque
toute substance aux personnages.
En ce sens, et dans une première lecture, le passage
de L'Etranger à La
Peste s'interprète comme un pas
sage non seulement de l'absurde à la révolte, mais éga
lement du
«je» au «nous».
L'univers se peuple: une
collectivité surgit là où n'existait, dans son isolement,
que l'individu.
Six personnages, cela est peu cependant si l'on évo
que les grands romans russes auxquels Camus vouait
une profonde admiration, ou même
si l'on pense à la
tradition du réalisme français.
Cela est peu également
si l'on se souvient que le narrateur de La Peste ne cesse
de proclamer sa volonté de raconter l'histoire
d'une
ville et d'une collectivité.
L'intention de Camus n'est certes pas de
«faire
concurrence à l'état civil».
Il n'entend pas peupler ses
fictions d'une foule nombreuse et colorée.
Il ne veut
pas davantage tracer dans le détail des portraits qui ne
laisseraient d'un individu aucun trait ou aucun détail
dans l'ombre.
Fidèle en cela à un idéal d'économie et
de retenue qui était à ses yeux l'essence même du
classicisme français, Camus ne nous dit de ses héros
que ce qui est nécessaire à la réalisation de son projet
littéraire.
En quelques lignes, il nous en livre une description
physique qui, dans sa brièveté même, les éclaire
et les
situe déjà.
Il n'évoque de leur passé et ne révèle de
leur action que ce qui permet au lecteur de comprendre
le
«pourquoi » et le «comment» de leur attitude face
au fléau.
C'est pourquoi on a pu reprocher à Camus de
construire des
«types» plutôt que de faire vivre des
personnages.
Ce reproche tombe de lui-même
si l'on.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- De l'Histoire à la chronique - Etude de La Peste de Camus
- Dissertation La Peste de Camus : la peste n'est elle qu'un fléau ?
- Fiche de lecture sur la peste d'Albert Camus
- La Peste d'Albert Camus : la solidarité face à la révolte
- La Peste de Camus (résumé de l'oeuvre & analyse détaillée)