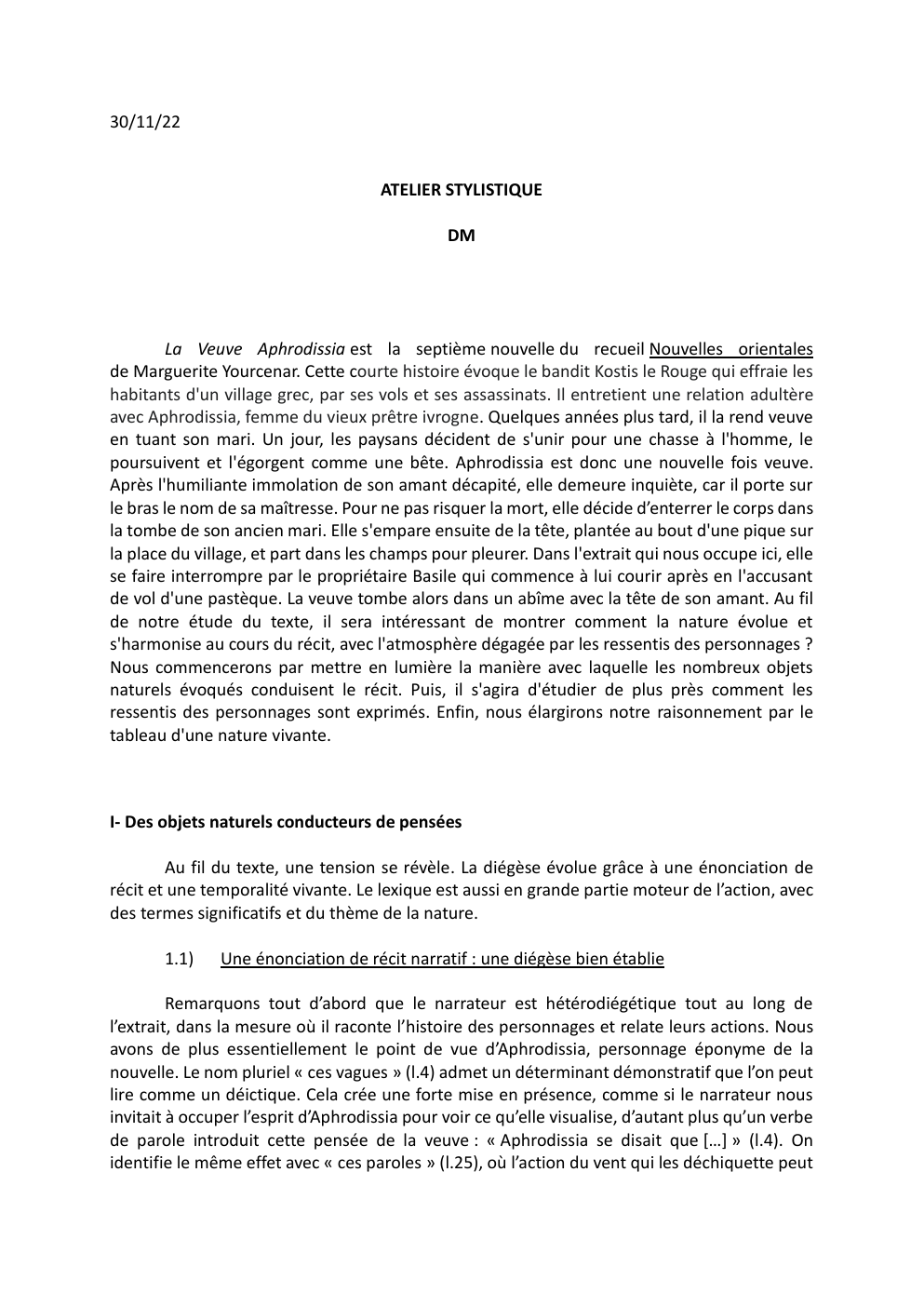Devoir maison, Nouvelles orientales de Marguerite Yourcenar
Publié le 07/12/2022
Extrait du document
«
30/11/22
ATELIER STYLISTIQUE
DM
La Veuve Aphrodissia est la septième nouvelle du recueil Nouvelles orientales
de Marguerite Yourcenar.
Cette courte histoire évoque le bandit Kostis le Rouge qui effraie les
habitants d'un village grec, par ses vols et ses assassinats.
Il entretient une relation adultère
avec Aphrodissia, femme du vieux prêtre ivrogne.
Quelques années plus tard, il la rend veuve
en tuant son mari.
Un jour, les paysans décident de s'unir pour une chasse à l'homme, le
poursuivent et l'égorgent comme une bête.
Aphrodissia est donc une nouvelle fois veuve.
Après l'humiliante immolation de son amant décapité, elle demeure inquiète, car il porte sur
le bras le nom de sa maîtresse.
Pour ne pas risquer la mort, elle décide d’enterrer le corps dans
la tombe de son ancien mari.
Elle s'empare ensuite de la tête, plantée au bout d'une pique sur
la place du village, et part dans les champs pour pleurer.
Dans l'extrait qui nous occupe ici, elle
se faire interrompre par le propriétaire Basile qui commence à lui courir après en l'accusant
de vol d'une pastèque.
La veuve tombe alors dans un abîme avec la tête de son amant.
Au fil
de notre étude du texte, il sera intéressant de montrer comment la nature évolue et
s'harmonise au cours du récit, avec l'atmosphère dégagée par les ressentis des personnages ?
Nous commencerons par mettre en lumière la manière avec laquelle les nombreux objets
naturels évoqués conduisent le récit.
Puis, il s'agira d'étudier de plus près comment les
ressentis des personnages sont exprimés.
Enfin, nous élargirons notre raisonnement par le
tableau d'une nature vivante.
I- Des objets naturels conducteurs de pensées
Au fil du texte, une tension se révèle.
La diégèse évolue grâce à une énonciation de
récit et une temporalité vivante.
Le lexique est aussi en grande partie moteur de l’action, avec
des termes significatifs et du thème de la nature.
1.1)
Une énonciation de récit narratif : une diégèse bien établie
Remarquons tout d’abord que le narrateur est hétérodiégétique tout au long de
l’extrait, dans la mesure où il raconte l’histoire des personnages et relate leurs actions.
Nous
avons de plus essentiellement le point de vue d’Aphrodissia, personnage éponyme de la
nouvelle.
Le nom pluriel « ces vagues » (l.4) admet un déterminant démonstratif que l’on peut
lire comme un déictique.
Cela crée une forte mise en présence, comme si le narrateur nous
invitait à occuper l’esprit d’Aphrodissia pour voir ce qu’elle visualise, d’autant plus qu’un verbe
de parole introduit cette pensée de la veuve : « Aphrodissia se disait que […] » (l.4).
On
identifie le même effet avec « ces paroles » (l.25), où l’action du vent qui les déchiquette peut
être imaginée aisément.
L’emploi du déterminant possessif dans « ses pieds » (l.2), puis « son
pied » (l.27), relève également d’une situation ancrée et présente au moment où la femme
interagit avec l’environnement.
De plus, les embrayeurs temporels « en ce moment » (l.5) et
« depuis longtemps » (l.23) prouvent bien que le récit est ancré dans la situation d’énonciation,
au sens de Benveniste.
Par ailleurs, la narration est intéressante à analyser : le narrateur
mobilise en effet l’imparfait pour les descriptions de second plan, tandis que le passé simple
est utilisé pour les actions de premier plan, soudaines quelques fois, qui permettent au récit
d’avancer.
Cela reste classique dans le cadre de la restitution de la diégèse d’une nouvelle.
Nous trouvons par exemple un passé simple suivi d’un infinitif semi-auxiliaire de temps du
futur au début de l’extrait, « elle alla s’asseoir » (l.1), permettant au récit d’imposer la première
action dans le temps, puis plus loin un autre passé simple précédant un gérondif, « [Il]
s’engagea sur la pente en brandissant son bâton » (l.20), ayant un aspect duratif.
Le temps
imparfait se voit utilisé pour un effet descriptif comme au moment où « les rochers dévalaient
rapidement » (l.2), « Basile s’était arrêté et hurlait à pleine voix » (l.23), « elle laissait couler
ses larmes » (l.9).
Notons dans cette dernière proposition l’infinitif « couler » à modalité
permissive, qui suggère la forte retenue qu’avait la veuve avant de s’autoriser à lâcher ses
émotions.
1.2)
Champ lexical de la nature : des éléments naturels au cœur du sujet
Qu'ils soient des noms, des verbes, les références à la nature ne manquent pas dans
cet extrait.
Un vrai travail sur « l'air » (l.11) ambiant a été réalisé.
Nous avons en effet ici à faire
à un cadre bucolique, un environnement en plein cœur de la nature, comme l'indiquent les
nombreux noms évocateurs d'objets naturels : « le platane » (l.1), « le terrain » (l.1), « les
rochers » (l.2), « la plaine » (l.2), « les forêts » (l.2), « la terre » (l.2), « la mer » (l.3), « la
montagne » (l.4), « le sentier » (l.22, 24), « les pierres » (l.23), « la piste » (l.24), « le vent »
(l.25).
Remarquons que le narrateur mobilise l’article défini pour désigner ces noms, leur
donnant un caractère concret et appuyant leur présence.
Le verbe « poussait » (l.1) est
également évocateur d’une nature qui ne cesse de se transformer, ici d’une situation qui a
pour but d’évoluer.
Les compléments du nom « du côté du précipice » (l.21) et « le sang du
soleil » (l.22) laisse place à des objets de la nature en guise d’image créée.
Nous distinguons
une subtilité avec le terme « bâton » (l.11, 20) ; en premier lieu désigné avec l’article indéfini
« un », il nous est ensuite présenté avec le déterminant possessif « son », ce qui mobilise
l’aspect d’appartenance au paysan Basile, et d’ancrage dans la situation d’énonciation
narrative.
De même, en fin de texte, le nom « une pierre » (l.27) surprend le lecteur car il n’est
désigné que par un article indéfini, ne donnant pas lieu à une possibilité de caractérisation de
cet élément.
Cette pierre semble arriver inopinément, presque pour mettre un terme à cette
course.
1.3)
Des adverbes significatifs : accentuation d’un climat tendu
Les adverbes sont nombreux et ont leur place dans cet extrait de nouvelle, accentuant
ou temporisant l’action choisie.
Ils sont nombreux à exprimer une apparence de profondeur
et un sentiment de descente « tout au fond » (l.3) du gouffre : « sous le platane » (l.1), « sous
ses pieds » (l.2), « sous son pied » (l.27), « au fond » (l.27).
Cette occurrence d’adverbes de
sens équivalents est surprenante et nous laisse à penser que Aphrodissia s’approche
doucement « du côté du précipice » (l.21) et de la mort inévitable.
D’autres adverbes
permettent de conduire le fil de notre pensée dans la description de l’environnement, comme
« de loin » (l.3), « rapidement » (l.2), « en haut » (l.11), pendant que certains appuient le fil
des actions de l’histoire, tels « encore plus » (l.12), « rien qu’une pastèque » (l.16), « avec »
(l.17, 29), « de plus en plus » (l.21, 22), « à pleine voix » (l.23).
Quelques négations
apparaissent, presque dans le but de rappeler à quel point les actions de la veuve sont vaines,
sans grand intérêt désormais : « je n’ai pris qu’une pastèque » (l.16), « le sentier n’était plus
qu’une piste » (l.26), « une vieille femme qui n’est plus aimée » (l.27).
Lorsque la pierre
décisive « enfin se détacha » (l.27), le lecteur peut ressentir de l’ambiguïté par l’utilisation de
l’adverbe « enfin ».
Un soulagement se ressent, une liberté presque désormais trouvée grâce
à « une pierre » (l.27).
C’est un lexique et une temporalité intéressante et vivante qui s’offre à nous dans ce
texte, conduisant la veuve à sa perte.
On le voit aussi, une certaine dramatisation se répand
au fur et à mesure de la lecture, qui nous pousse à étudier les différents sentiments eprouvés
par les personnages.
II- Des ressentis naturellement exprimés
Une nature qui évolue, transcende nos attentes, et des ressentis ambivalents des
personnages.
La nouvelle se montre captivante dès le début de la lecture, et l’histoire semble
sans cesse remodelée par des rebondissements.
2.1)
Du discours direct enchevêtré dans un récit : l’hybridité du texte
Nous remarquons au milieu du texte étudié une place attribuée à du discours direct.
Une disposition avec des tirets, des retours à la ligne, des types de phrases variés le prouvent
en effet.
Nous assistons en fait ici à un échange entre la veuve Aphrodissia et le fermier Basile,
propriétaire du terrain.
La discussion est naturelle, spontanée, pouvant être justifié par
l’utilisation d’un langage courant, et de modalités correspondantes aux types de phrases
interrogatif, « une citrouille ? » (l.15), injonctif, « montre-moi ça » (l.18), et assertif « je suis
pauvre » (l.16).
Par ailleurs, l’emploi des temps du présent, de l’impératif et du passé composé
sont adéquats à un énoncé ancré dans la situation d’énonciation.
Une description narrative
des actions des personnages nous est aussi communiquée de la ligne 11 à 14.
Le déterminant
possessif dans « mon verger » (l.10) est déictique, dans la mesure où il nous indique
parfaitement que la scène se déroule au niveau de la propriété de Basile.
2.2)
Un lexique travaillé : des ressentis clairement identifiés
Ce qui alimente également la surprise est le naturel avec lequel la veuve Aphrodissia
désigne son interlocuteur, apparemment simple paysan, « oncle Basile » (l.14, 16), comme si
un lien de parenté était établi.
Elle utilise même le tutoiement pour communiquer avec lui.
Or,
Basile témoigne d’une certaine haine envers la femme en la traitant de tous les noms :
« voleuse » (l.10, 15), « menteuse » (l.18), « espèce de taupe noire » (l.18).
Il se base aussi sur
le malheur qu’elle a vécu en associant ses insultes à des périphrases pour l’appeler....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Marguerite YOURCENAR, Nouvelles orientales, «Le Lait de la mort»
- Fiches de lecture - Nouvelles orientales de Marguerite Yourcenar
- L'usage de la description dans « Nouvelles Orientales » (Yourcenar)
- Quiz sur Mémoires d'Hadrien de Marguerite Yourcenar
- DEVOIR MAISON : LE SUPPORT DE L’INFORMATION GENETIQUE, L’ADN