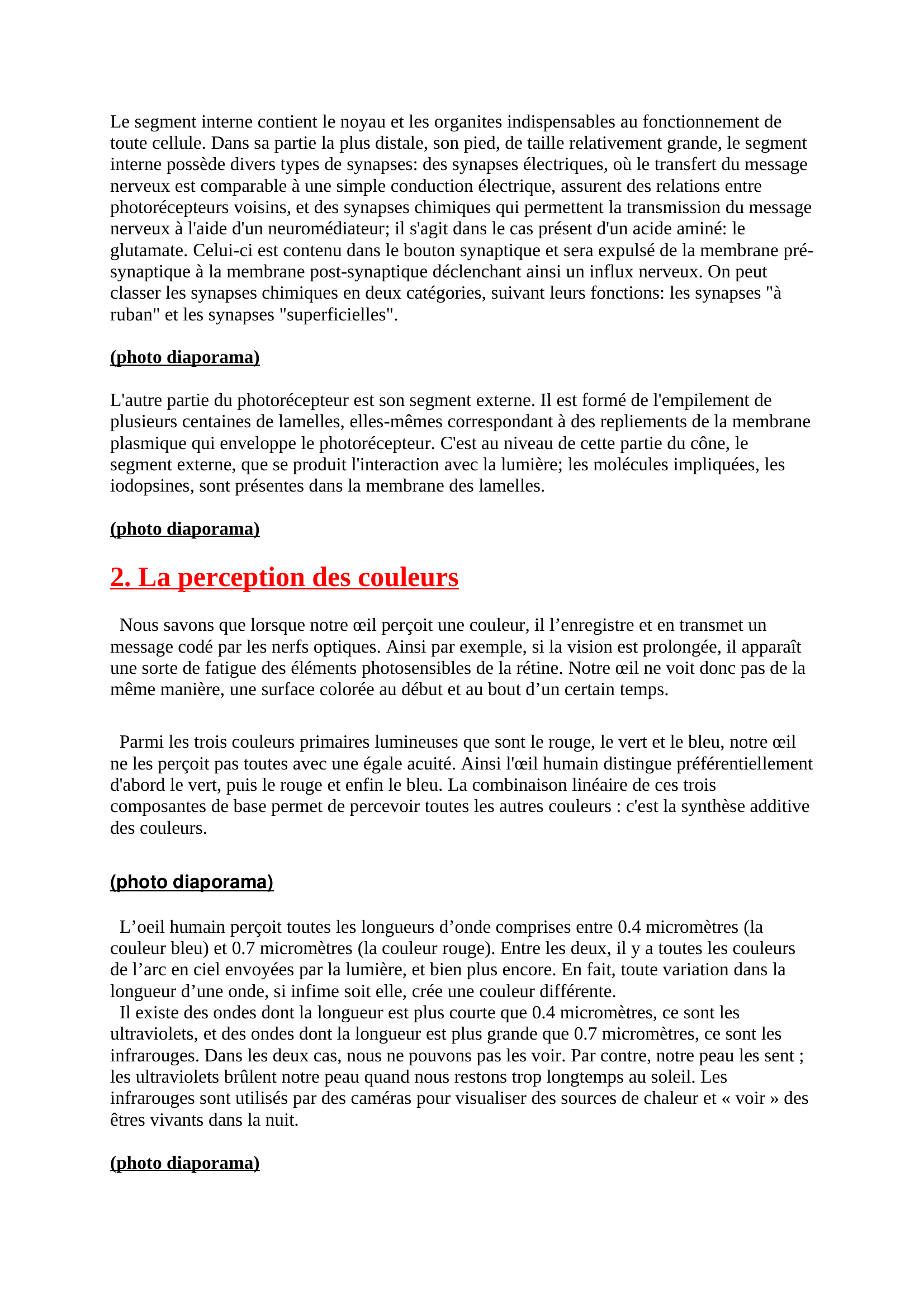Dissert
Publié le 21/01/2013

Extrait du document
«
Le segment interne contient le noyau et les organites indispensables au fonctionnement de
toute cellule.
Dans sa partie la plus distale, son pied, de taille relativement grande, le segment
interne possède divers types de synapses: des synapses électriques, où le transfert du message
nerveux est comparable à une simple conduction électrique, assurent des relations entre
photorécepteurs voisins, et des synapses chimiques qui permettent la transmission du message
nerveux à l'aide d'un neuromédiateur ; il s'agit dans le cas présent d'un acide aminé: le
glutamate.
Celui-ci est contenu dans le bouton synaptique et sera expulsé de la membrane pré-
synaptique à la membrane post-synaptique déclenchant ainsi un influx nerveux.
On peut
classer les synapses chimiques en deux catégories, suivant leurs fonctions: les synapses "à
ruban" et les synapses "superficielles".
(photo diaporama)
L'autre partie du photorécepteur est son segment externe.
Il est formé de l'empilement de
plusieurs centaines de lamelles, elles-mêmes correspondant à des repliements de la membrane
plasmique qui enveloppe le photorécepteur.
C'est au niveau de cette partie du cône, le
segment externe, que se produit l'interaction avec la lumière; les molécules impliquées, les
iodopsines, sont présentes dans la membrane des lamelles.
(photo diaporama)
2.
La perception des couleurs
Nous savons que lorsque notre œil perçoit une couleur, il l’enregistre et en transmet un
message codé par les nerfs optiques.
Ainsi par exemple, si la vision est prolongée, il apparaît
une sorte de fatigue des éléments photosensibles de la rétine.
Notre œil ne voit donc pas de la
même manière, une surface colorée au début et au bout d’un certain temps.
Parmi les trois couleurs primaires lumineuses que sont le rouge, le vert et le bleu, notre œil
ne les perçoit pas toutes avec une égale acuité .
Ainsi l'œil humain distingue préférentiellement
d'abord le vert, puis le rouge et enfin le bleu.
La combinaison linéaire de ces trois
composantes de base permet de percevoir toutes les autres couleurs : c'est la synthèse additive
des couleurs.
(photo diaporama)
L’oeil humain perçoit toutes les longueurs d’onde comprises entre 0.4 micromètres (la
couleur bleu) et 0.7 micromètres (la couleur rouge).
Entre les deux, il y a toutes les couleurs
de l’arc en ciel envoyées par la lumière, et bien plus encore.
En fait, toute variation dans la
longueur d’une onde, si infime soit elle, crée une couleur différente.
Il existe des ondes dont la longueur est plus courte que 0.4 micromètres, ce sont les
ultraviolets, et des ondes dont la longueur est plus grande que 0.7 micromètres, ce sont les
infrarouges.
Dans les deux cas, nous ne pouvons pas les voir.
Par contre, notre peau les sent ;
les ultraviolets brûlent notre peau quand nous restons trop longtemps au soleil.
Les
infrarouges sont utilisés par des caméras pour visualiser des sources de chaleur et « voir » des
êtres vivants dans la nuit.
(photo diaporama).
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- dissert juste la fin du monde et la crise familiale
- Dissert-La Malade Imaginaire-Molière: en quoi Le Malade Imaginaire de Molière est conçu comme un spectacle complet ?
- Faut-il avoir peur de la technique ? (dissert)
- dissert
- Dissert