dissertation master littérature de jeunesse sur le conte - Commentez : "Pierre Péju nous dit que «Le conte en général […] met en scène un héros au nom commun, à la psychologie sommaire, dont les aventures sont comme suspendues en dehors du temps et de l’espace. Le conte décrit souvent un « passage », une traversée […]. A la fin, celui qui est mal parti finit par accéder à un état nouveau de maturité, de puissance ou de richesse. Mais certains contes valent avant tout par la force de l
Publié le 27/01/2013

Extrait du document
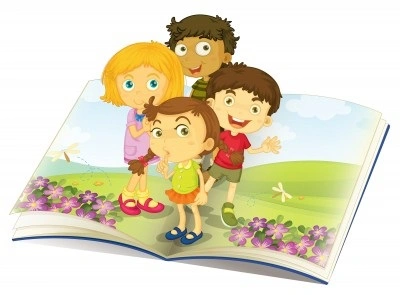
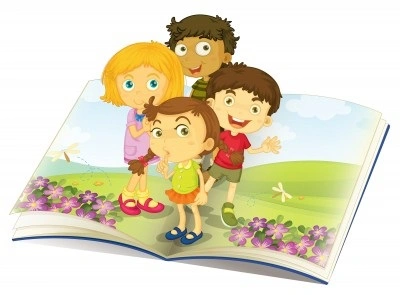
«
considère Grimm) de retouches, en s'appropriant d'une certaine manière un trésor commun ? Le
déclenchement de cet intérêt et de cette utilisation a certes des raisons historiques, mais ces raisons doivent
être complétées par des causes « irrationnelles », celles qu'on peut trouver dans le jeu des forces de
l'imaginaire.
Les frères Grimm dans la préface à l'édition des contes de 1856 avaient bien vu que les contes ne
« sont jamais le simple jeu coloré d'une imagination sans contenu », mais qu'ils sont « des petits fragments
d'une pierre précieuse éclatée», cette « pierre précieuse éclatée » étant pour eux le
mythe. Il s'agit donc
d'interroger le conte lettré, en ce qu'il a de merveilleux, ce qui le caractérise et le singularise.
Nous mettrons
ainsi en évidence la redondance des thèmes et des motifs du conte, insistant sur la permanence de certaines
images, ce que Jacob Grimm appelait le « fond», et qui reste identique à lui-même quand bien même on le
raconte avec d'autres mots.
Puis nous nous interrogerons sur l'imaginaire des contes merveilleux lettrés, en
tant que monde hors de la raison, monde d'images.
Enfin, il nous faudra envisager les interprétations que l'on
peut donner à ce vaste tissu d'images.
***
La spécificité du conte merveilleux repose essentiellement sur ses motifs et sa structure. La structure,
contrairement aux motifs, semble restée pratiquement intacte depuis la tradition orale et constitue une base
narrative sur laquelle il est possible de varier les récits à l'infini, comme l'ont montré les travaux de Vladimir
Propp dans Morphologie du Conte, qui ont mis en avance la spécificité de la structure du conte merveilleux.
Propp constate en effet que le conte merveilleux est « un récit construit selon la succession régulière des
fonctions citées dans leurs différentes formes », dont le schéma minimal peut se résumer en quatre principaux
temps: une situation de départ (introduite le plus souvent par « Il était une fois»), un élément perturbateur qui
entraîne le héros dans une aventure ou une quête, une série d'épreuves ( le plus souvent au nombre de trois
selon le principe du contage oral ) qu'il surmonte à l'aide d'êtres ou d'objets magiques, et le dénouement final
avec la victoire du héros sur ses ennemis ainsi que son mariage, donnant lieu à la célèbre formule « Ils se.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Commentez ces lignes de Sylvain Menant (Littérature française, t. VI : De l'Encyclopédie aux Méditations, Arthaud, 1984) : «Tout le monde, de Voltaire à Diderot, cherche à définir un «droit naturel», droit absolu inscrit dans la raison humaine et antérieur, d'un point de vue intellectuel, à l'existence des sociétés. Ce droit naturel doit s'imposer dans tous les régimes politiques. Il protège la liberté des individus et leur fixe des devoirs. Chaque intervention dans les affaires du tem
- La dernière phrase du récit d'André Breton intitulé Nadja (1928) est : «La beauté sera convulsive ou ne sera pas.» À la fin du premier chapitre de L'Amour fou (1937), Breton précise sa formule : «La beauté convulsive sera érotique-voilée, explosante-fixe, magique-circonstancielle ou ne sera pas.» À la lumière de ces déclarations, vous tâcherez de définir l'esthétique surréaliste.
- Commentez ces lignes d'André Maurois : «La plupart des écrivains, consciemment ou non, fardent la vie ou la déforment ; les uns parce qu'ils n'osent pas montrer la vanité de tout ce à quoi s'attachent les hommes et eux-mêmes ; les autres parce que leurs propres griefs leur cachent ce qu'il y a, dans le monde, de grandeur et de poésie ; presque tous parce qu'ils n'ont pas la force d'aller au-delà des apparences et de délivrer la beauté captive. Observer ne suffit pas ; il faut pénétrer
- Arthur SCHOPENHAUER / Aphorismes sur la sagesse dans la vie (1851) / Collection Quadrige / PUF 1943 « On reproche fréquemment aux hommes de tourner leurs voeux principalement vers l'argent et de l'aimer plus que tout au monde. Pourtant il est bien naturel, presque inévitable d'aimer ce qui, pareil à un protée infatigable, est prêt à tout instant à prendre la forme de l'objet actuel de nos souhaits si mobiles ou de nos besoins si divers. Tout autre bien, en effet, ne peut satisfaire qu'
- Dissertation : En quoi Juste la fin du monde met en scène une crise personnelle et familiale ?
































![Prévisualisation Prévisualisation du document dissertation master littérature de jeunesse sur le conte - Commentez : "Pierre Péju nous dit que «Le conte en général […] met en scène un héros au nom commun, à la psychologie sommaire, dont les aventures sont comme suspendues en dehors du temps et de l’espace. Le conte décrit souvent un « passage », une traversée […]. A la fin, celui qui est mal parti finit par accéder à un état nouveau de maturité, de puissance ou de richesse. Mais certains contes valent avant tout par la force de l](https://static.devoir-de-philosophie.com/img/preview/dissertation-master-litterature-de-jeunesse-sur-le-conte-commentez-pierre-peju-nous-dit-que-le-conte-en-general-8230-met-en-scene-un-heros.png)
