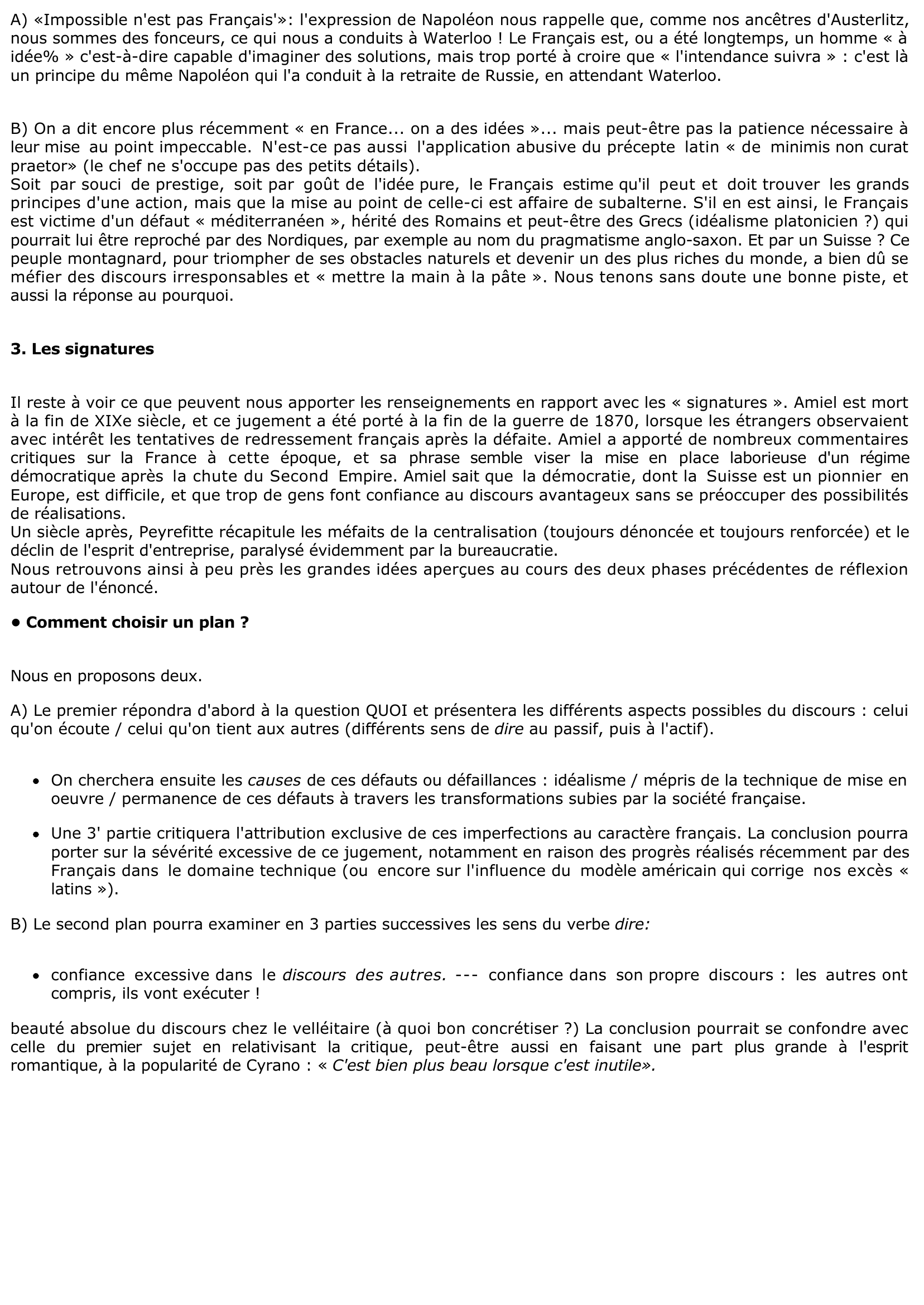«En France, on croit toujours qu'une chose dite est une chose faite. ». Discutez.
Publié le 22/02/2012

Extrait du document
«
A) «Impossible n'est pas Français'»: l'expression de Napoléon nous rappelle que, comme nos ancêtres d'Austerlitz,nous sommes des fonceurs, ce qui nous a conduits à Waterloo ! Le Français est, ou a été longtemps, un homme « àidée% » c'est-à-dire capable d'imaginer des solutions, mais trop porté à croire que « l'intendance suivra » : c'est làun principe du même Napoléon qui l'a conduit à la retraite de Russie, en attendant Waterloo.
B) On a dit encore plus récemment « en France...
on a des idées »...
mais peut-être pas la patience nécessaire àleur mise au point impeccable.
N'est-ce pas aussi l'application abusive du précepte latin « de minimis non curatpraetor» (le chef ne s'occupe pas des petits détails).Soit par souci de prestige, soit par goût de l'idée pure, le Français estime qu'il peut et doit trouver les grandsprincipes d'une action, mais que la mise au point de celle-ci est affaire de subalterne.
S'il en est ainsi, le Françaisest victime d'un défaut « méditerranéen », hérité des Romains et peut-être des Grecs (idéalisme platonicien ?) quipourrait lui être reproché par des Nordiques, par exemple au nom du pragmatisme anglo-saxon.
Et par un Suisse ? Cepeuple montagnard, pour triompher de ses obstacles naturels et devenir un des plus riches du monde, a bien dû seméfier des discours irresponsables et « mettre la main à la pâte ».
Nous tenons sans doute une bonne piste, etaussi la réponse au pourquoi.
3.
Les signatures
Il reste à voir ce que peuvent nous apporter les renseignements en rapport avec les « signatures ».
Amiel est mortà la fin de XIXe siècle, et ce jugement a été porté à la fin de la guerre de 1870, lorsque les étrangers observaientavec intérêt les tentatives de redressement français après la défaite.
Amiel a apporté de nombreux commentairescritiques sur la France à cette époque, et sa phrase semble viser la mise en place laborieuse d'un régimedémocratique après la chute du Second Empire.
Amiel sait que la démocratie, dont la Suisse est un pionnier enEurope, est difficile, et que trop de gens font confiance au discours avantageux sans se préoccuper des possibilitésde réalisations.Un siècle après, Peyrefitte récapitule les méfaits de la centralisation (toujours dénoncée et toujours renforcée) et ledéclin de l'esprit d'entreprise, paralysé évidemment par la bureaucratie.Nous retrouvons ainsi à peu près les grandes idées aperçues au cours des deux phases précédentes de réflexionautour de l'énoncé.
• Comment choisir un plan ?
Nous en proposons deux.
A) Le premier répondra d'abord à la question QUOI et présentera les différents aspects possibles du discours : celuiqu'on écoute / celui qu'on tient aux autres (différents sens de dire au passif, puis à l'actif).
On cherchera ensuite les causes de ces défauts ou défaillances : idéalisme / mépris de la technique de mise en oeuvre / permanence de ces défauts à travers les transformations subies par la société française.
Une 3' partie critiquera l'attribution exclusive de ces imperfections au caractère français.
La conclusion pourraporter sur la sévérité excessive de ce jugement, notamment en raison des progrès réalisés récemment par desFrançais dans le domaine technique (ou encore sur l'influence du modèle américain qui corrige nos excès «latins »).
B) Le second plan pourra examiner en 3 parties successives les sens du verbe dire:
confiance excessive dans le discours des autres.
--- confiance dans son propre discours : les autres ont compris, ils vont exécuter !
beauté absolue du discours chez le velléitaire (à quoi bon concrétiser ?) La conclusion pourrait se confondre aveccelle du premier sujet en relativisant la critique, peut-être aussi en faisant une part plus grande à l'espritromantique, à la popularité de Cyrano : « C'est bien plus beau lorsque c'est inutile»..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Commenter cette opinion d’un penseur contemporain : « Croire n’est pas quelque chose de moins, mais quelque chose de plus que savoir. Celui qui croit ajoute le poids de tout son être à ce qu'il pense. »
- « La chose inhumaine n’a rien à dire : d’où ce grand scandale que les sciences n’instruisent pas du tout », déclare le philosophe Alain. Expliquez et discutez.
- « Puisqu'on ne peut être universel et savoir tout ce qui se peut savoir sur tout, II faut savoir peu de tout car il est bien plus beau de savoir quelque chose de tout que de savoir tout d'une chose. » Discutez cette affirmation de Pascal.
- Commentez et discutez le texte suivant : « Notre époque technique n'a fait qu'augmenter le besoin d'une culture générale solide... De plus en plus, les grands industriels et même les purs scientifiques, tendent à recruter des collaborateurs cultivés de préférence à des collaborateurs avertis : les se-conds, bien souvent, ne progressent guère au-delà de leur succès initial, alors que les premiers sont sus-ceptibles d'apprendre. » « La culture générale n'est nullement cette culture vaine
- Discutez cette parole d'Anatole France : La science ne se soucie ni de plaire, ni de déplaire : elle est inhumaine. Ce n'est pas elle, c'est la poésie qui charme et qui console. C'est pourquoi la poésie est plus nécessaire que la science. »