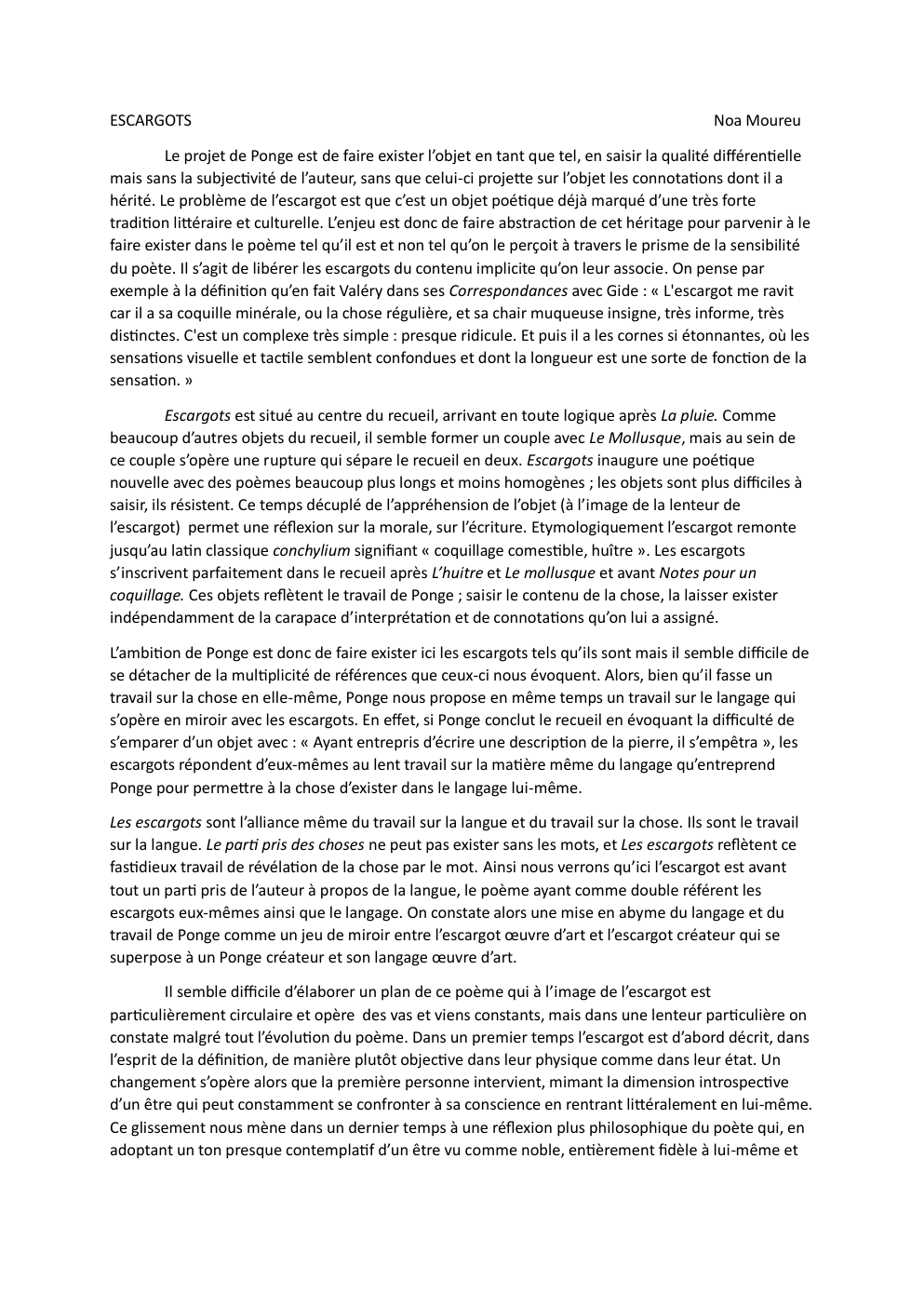explication de texte les escargots
Publié le 31/03/2025
Extrait du document
«
ESCARGOTS
Le projet de Ponge est de faire exister l’objet en tant que tel, en saisir la qualité différentielle
mais sans la subjectivité de l’auteur, sans que celui-ci projette sur l’objet les connotations dont il a
hérité.
Le problème de l’escargot est que c’est un objet poétique déjà marqué d’une très forte
tradition littéraire et culturelle.
L’enjeu est donc de faire abstraction de cet héritage pour parvenir à le
faire exister dans le poème tel qu’il est et non tel qu’on le perçoit à travers le prisme de la sensibilité
du poète.
Il s’agit de libérer les escargots du contenu implicite qu’on leur associe.
On pense par
exemple à la définition qu’en fait Valéry dans ses Correspondances avec Gide : « L'escargot me ravit
car il a sa coquille minérale, ou la chose régulière, et sa chair muqueuse insigne, très informe, très
distinctes.
C'est un complexe très simple : presque ridicule.
Et puis il a les cornes si étonnantes, où les
sensations visuelle et tactile semblent confondues et dont la longueur est une sorte de fonction de la
sensation.
»
Escargots est situé au centre du recueil, arrivant en toute logique après La pluie.
Comme
beaucoup d’autres objets du recueil, il semble former un couple avec Le Mollusque, mais au sein de
ce couple s’opère une rupture qui sépare le recueil en deux.
Escargots inaugure une poétique
nouvelle avec des poèmes beaucoup plus longs et moins homogènes ; les objets sont plus difficiles à
saisir, ils résistent.
Ce temps décuplé de l’appréhension de l’objet (à l’image de la lenteur de
l’escargot) permet une réflexion sur la morale, sur l’écriture.
Etymologiquement l’escargot remonte
jusqu’au latin classique conchylium signifiant « coquillage comestible, huître ».
Les escargots
s’inscrivent parfaitement dans le recueil après L’huitre et Le mollusque et avant Notes pour un
coquillage.
Ces objets reflètent le travail de Ponge ; saisir le contenu de la chose, la laisser exister
indépendamment de la carapace d’interprétation et de connotations qu’on lui a assigné.
L’ambition de Ponge est donc de faire exister ici les escargots tels qu’ils sont mais il semble difficile de
se détacher de la multiplicité de références que ceux-ci nous évoquent.
Alors, bien qu’il fasse un
travail sur la chose en elle-même, Ponge nous propose en même temps un travail sur le langage qui
s’opère en miroir avec les escargots.
En effet, si Ponge conclut le recueil en évoquant la difficulté de
s’emparer d’un objet avec : « Ayant entrepris d’écrire une description de la pierre, il s’empêtra », les
escargots répondent d’eux-mêmes au lent travail sur la matière même du langage qu’entreprend
Ponge pour permettre à la chose d’exister dans le langage lui-même.
Les escargots sont l’alliance même du travail sur la langue et du travail sur la chose.
Ils sont le travail
sur la langue.
Le parti pris des choses ne peut pas exister sans les mots, et Les escargots reflètent ce
fastidieux travail de révélation de la chose par le mot.
Ainsi nous verrons qu’ici l’escargot est avant
tout un parti pris de l’auteur à propos de la langue, le poème ayant comme double référent les
escargots eux-mêmes ainsi que le langage.
On constate alors une mise en abyme du langage et du
travail de Ponge comme un jeu de miroir entre l’escargot œuvre d’art et l’escargot créateur qui se
superpose à un Ponge créateur et son langage œuvre d’art.
Il semble difficile d’élaborer un plan de ce poème qui à l’image de l’escargot est
particulièrement circulaire et opère des vas et viens constants, mais dans une lenteur particulière on
constate malgré tout l’évolution du poème.
Dans un premier temps l’escargot est d’abord décrit, dans
l’esprit de la définition, de manière plutôt objective dans leur physique comme dans leur état.
Un
changement s’opère alors que la première personne intervient, mimant la dimension introspective
d’un être qui peut constamment se confronter à sa conscience en rentrant littéralement en lui-même.
Ce glissement nous mène dans un dernier temps à une réflexion plus philosophique du poète qui, en
adoptant un ton presque contemplatif d’un être vu comme noble, entièrement fidèle à lui-même et
qui laisse sa marque comme œuvre d’art sur le monde.
La première strophe commence par la négation, par dire ce que la chose n’est pas
pour qualifier ce que la chose est.
L’escargot n’est d’abord défini que par comparaison.
Dès le début,
le nom « escargot » s’impose comme la base phonique du poème (on le retrouve dans « escarbilles »,
dans « Go »…).
De plus l’humidité de l’escargot est partout, on retrouve le caractère visqueux qui lui
permet très pertinemment de laisser sa trace (qui va de pair avec les multiples assonances en [o]) :
« humide », « collés », « baignant », « humidité »…)
La parenthèse à la strophe suivante est à l’image de la circularité du poème, de ses vas et
viens constants, mais aussi à l’image de l’intériorité de l’escargot ; leur « sang-froid » se situe dans les
parenthèses de la coquille, dans le corps de l’escargot.
D’ailleurs cette intériorité est énoncée avec « il
rentre aussitôt au fond de lui-même ».
Les nombreux verbes d’actions détonnent avec sa lenteur mais
donnent un caractère très actif à l’être qui avance lentement mais surement.
A l’image de Ponge, les
escargots « n’affectionnent pas […] l’eau ».
En effet, dans son œuvre, tout ce qui est mou et informe
est objet de répulsion.
Les sentiments du poète sont ici exprimés de manière détournée.
Pourtant les
choses consistantes sont chargées de qualités que le poète s’attribue à lui-même.
En effet l’escargot
est particulièrement mis en valeur tout le long du poème.
D’ailleurs l’escargot s’élève
étymologiquement par rapport à l’eau.
Si l’eau se définit par sa « bassesse », l’escargot est par
définition un terme d’hydraulique, une machine servant à épuiser l’eau.
L’escargot acquiert de cette
manière une hauteur dans le sens où il s’oppose à l’eau.
On retrouve cette mise en valeur de l’escargot, sa dimension noble à la neuvième strophe
avec les quatre occurrences de l’adverbe d’intensité « si ».
D’ailleurs émerge ici la première personne
qui semble aller de soi pour continuer de décrire le caractère introspectif de l’escargot.
L’octosyllabe
blanc «....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- M Vergeade Philosophie : Explication du texte janv.21 Les idées et les âges (1927)P 102 -Manuel Delagrave -P 427-
- Explication de texte : « Qu’est-ce que le Moi » Pascal
- Explication de texte autour d'un extrait de l'ouvrage Le poète et l'activité de la fantaisie, de Sigmund Freud
- explication de texte Kant sur le bonheur comme idéal
- platon georgias explication de texte 483B 484