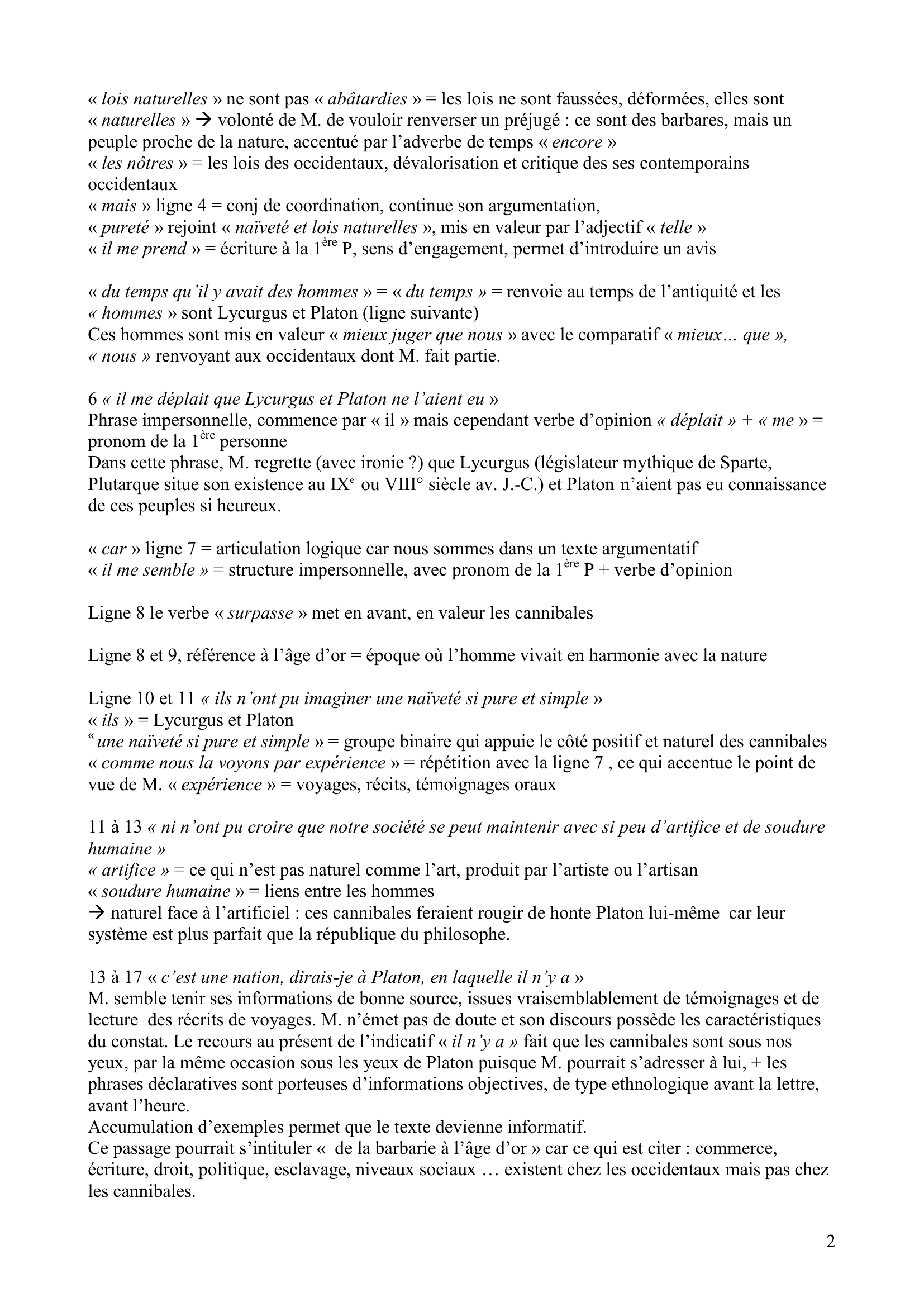Explication de texte p 438 – 439 « des cannibales » Essais Montaigne
Publié le 25/06/2012

Extrait du document

Situer le passage :
Les essais se composent d’un ensemble de 107 chapitre rédigés entre 1572 et 1592, distribués en trois livres.
Cannibales = livre I chapitre 31, rédigés en 1571, publiés en 1580
Précédemment, Montaigne a un grand intérêt pour les voyages, prend conscience de ses découvertes, et parvient à en tirer des conclusions morales et philosophiques ; Montaigne dévalorise, critique ses contemporains.
Lecture :
Résumé le texte :
Nous voyons que Montaigne décrit la vie et les mœurs des cannibales, peuples de l’Amérique du sud. Il montre la vie de cette nation, en la comparant plus ou moins à ces contemporains, occidentaux.
Plan du texte :
1ER mvt : ligne 1 à 21
2 mvt : ligne 22 à 48
3 mvt : ligne 49 à 65

«
2
« lois naturelles » ne sont pas « abâtardies » = les lois ne sont faussées, déformées, elles sont
« naturelles » volonté de M.
de vouloir renverser un préjugé : ce sont des barbares, mais un
peuple proche de la nature, accentué par l’adverbe de temps « encore »
« les nôtres » = les lois des occidentaux, dévalorisation et critique des ses contemporains
occidentaux
« mais » ligne 4 = conj de coordination , continue son argumentation,
« pureté » rejoint « naïveté et lois naturelles », mis en valeur par l’adjectif « telle »
« il me prend » = écriture à la 1
ère P, sens d’engagement, permet d’introduire un avis
« du temps qu’il y avait des hommes » = « du temps » = renvoie au temps de l’antiquité et les
« hommes » sont Lycurgus et Platon (ligne suivante)
Ces hommes sont mis en valeur « mieux juger que nous » avec le comparatif « mieux… que »,
« nous » renvoyant aux occidentaux dont M.
fait partie.
6 « il me déplait que Lycurgus et Platon ne l’aient eu »
Phrase impersonnelle, commence par « il » mais cependant verbe d’opinion « déplait » + « me » =
pronom de la 1
ère personne
Dans cette phrase, M.
regrette (avec ironie ?) que Lycurgus (législateur mythique de Sparte,
Plutarque si tue son existence au IX
e ou VIII° siècle av.
J.
-C.
) et Pl aton n’aient pas eu connaissance
de ces peuples si heureux.
« car » ligne 7 = articulation logique car nous sommes dans un texte argumentatif
« il me semble » = structure impersonnelle, avec pronom de la 1
ère P + verbe d’opinion
Ligne 8 le verbe « surpasse » met en avant, en valeur les cannibales
Ligne 8 et 9, référence à l’âge d’or = époque où l’homme vivait en harmonie avec la nature
Ligne 10 et 11 « ils n’ont pu imaginer une naïveté si pure et simple »
« ils » = Lycurgus et Platon
« une naïveté si pure et simple » = groupe binaire qui appuie le côté positif et naturel des cannibales
« comme nous la voyons par expérience » = répétition avec la ligne 7 , ce qui accentue le point de
vue de M.
« expérience » = voyages, récits, témoignages oraux
11 à 13 « ni n’ont pu croire que notre société se peut maintenir avec si peu d’artifice et de soudure
humaine »
« artifice » = ce qui n’est pas naturel comme l’art, produit par l’artiste ou l’artisan
« soudure humaine » = liens entre les hommes
naturel face à l’artificiel : ces cannibales feraient rougir de honte Platon lui -même car leur
système est plus pa rfait que la république du philosophe.
13 à 17 « c’est une nation, dirais -je à Platon, en laquelle il n’y a »
M.
semble tenir ses informations de bonne source, issues vraisemblablement de témoignages et de
lecture des récrits de voyages.
M.
n’émet pas de doute et son discours possède les caractéristiques
du constat.
Le recours au présent de l’indicatif « il n’y a » fait que les cannibales sont sous nos
yeux, par la même occasion sous les yeux de Platon puisque M.
pourrait s’adresser à lui, + les
phrases d éclaratives sont porteuses d’informations objectives, de type ethnologique avant la lettre,
avant l’heure.
Accumulation d’exemples permet que le texte devienne informatif.
Ce passage pourrait s’intituler « de la barbarie à l’âge d’or » car ce qui est cit er : commerce,
écriture, droit, politique, esclavage, niveaux sociaux … existent chez les occidentaux mais pas chez
les cannibales..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Montaigne, Essais, « Des Cannibales », I, 31 Questions sur le texte 1) Quelle thèse l'auteur développe-t-il dans ce texte ?
- Explication de texte Montaigne, Essais, 1,26 (commentaire)
- Montaigne - Explication de texte extrait livre III
- "Des cannibales" , Les Essais , Livre 1 chap 31 (1580) de Montaigne
- Explication de texte : Les sens, quoique nécessaires pour toutes nos connaissances actuelles, ne sont point suffisants pour nous les donner toutes..." de Leibniz (préface aux Nouveaux essais sur l'entendement humain)