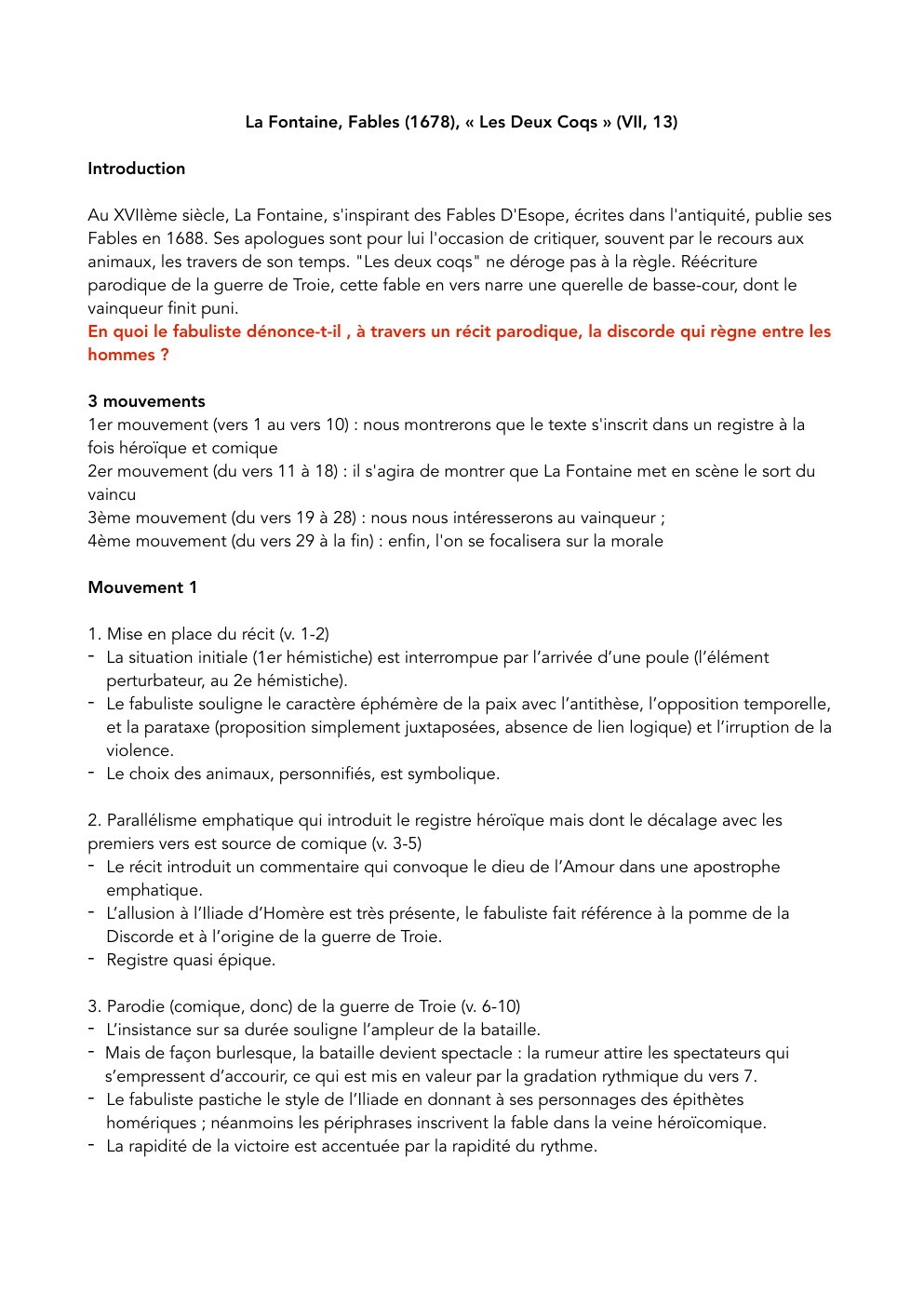Explication linéaire: La Fontaine, Fables (1678), "Les Deux Coqs"
Publié le 07/11/2023
Extrait du document
«
La Fontaine, Fables (1678), « Les Deux Coqs » (VII, 13)
Introduction
Au XVIIème siècle, La Fontaine, s'inspirant des Fables D'Esope, écrites dans l'antiquité, publie ses
Fables en 1688.
Ses apologues sont pour lui l'occasion de critiquer, souvent par le recours aux
animaux, les travers de son temps.
"Les deux coqs" ne déroge pas à la règle.
Réécriture
parodique de la guerre de Troie, cette fable en vers narre une querelle de basse-cour, dont le
vainqueur finit puni.
En quoi le fabuliste dénonce-t-il , à travers un récit parodique, la discorde qui règne entre les
hommes ?
3 mouvements
1er mouvement (vers 1 au vers 10) : nous montrerons que le texte s'inscrit dans un registre à la
fois héroïque et comique
2er mouvement (du vers 11 à 18) : il s'agira de montrer que La Fontaine met en scène le sort du
vaincu
3ème mouvement (du vers 19 à 28) : nous nous intéresserons au vainqueur ;
4ème mouvement (du vers 29 à la fin) : enfin, l'on se focalisera sur la morale
Mouvement 1
1.
Mise en place du récit (v.
1-2)
- La situation initiale (1er hémistiche) est interrompue par l’arrivée d’une poule (l’élément
perturbateur, au 2e hémistiche).
- Le fabuliste souligne le caractère éphémère de la paix avec l’antithèse, l’opposition temporelle,
et la parataxe (proposition simplement juxtaposées, absence de lien logique) et l’irruption de la
violence.
- Le choix des animaux, personnifiés, est symbolique.
2.
Parallélisme emphatique qui introduit le registre héroïque mais dont le décalage avec les
premiers vers est source de comique (v.
3-5)
- Le récit introduit un commentaire qui convoque le dieu de l’Amour dans une apostrophe
emphatique.
- L’allusion à l’Iliade d’Homère est très présente, le fabuliste fait référence à la pomme de la
Discorde et à l’origine de la guerre de Troie.
- Registre quasi épique.
3.
Parodie (comique, donc) de la guerre de Troie (v.
6-10)
- L’insistance sur sa durée souligne l’ampleur de la bataille.
- Mais de façon burlesque, la bataille devient spectacle : la rumeur attire les spectateurs qui
s’empressent d’accourir, ce qui est mis en valeur par la gradation rythmique du vers 7.
- Le fabuliste pastiche le style de l’Iliade en donnant à ses personnages des épithètes
homériques ; néanmoins les périphrases inscrivent la fable dans la veine héroïcomique.
- La rapidité de la victoire est accentuée par la rapidité du rythme.
Mouvement 2
1.
L’humiliation (v.
11-14)
- Le vaincu est mis à l’écart ; la locution prépositionnelle "au fond de" renforce l’idée de chute.
- Cette mise à l’écart est physique et symbolique : les rimes « retraite » et « défaite » sont
significatives.
- Le narrateur adopte le point de vue du vaincu (pathétique) et associe le lexique de la guerre et
de la haine à celui de l’amour.
2.
Mais la parodie annule rapidement le pathos (v.
15-18)
- Parodie du héros tragique en proie au dilemme cornélien (gloire / amour).
- Le fabuliste pastiche le style cornélien en utilisant le pluriel emphatique et redondant,....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Dans le salon de Madame de La Sablière qu'il a fréquenté de 1672 à 1678, La Fontaine s'est mêlé aux discussions des philosophes et des savants. Les fables des Livres VII à XII contiennent des échos de leurs débats. ?
- les 2 coqs - Fables de la Fontaine
- LES DEUX COQS de La Fontaine, Fables VII - commentaire composé
- Les Deux Coqs de Jean de la fontaine (analyse linéaire)
- La Fontaine, Fables VII. LES DEUX COQS