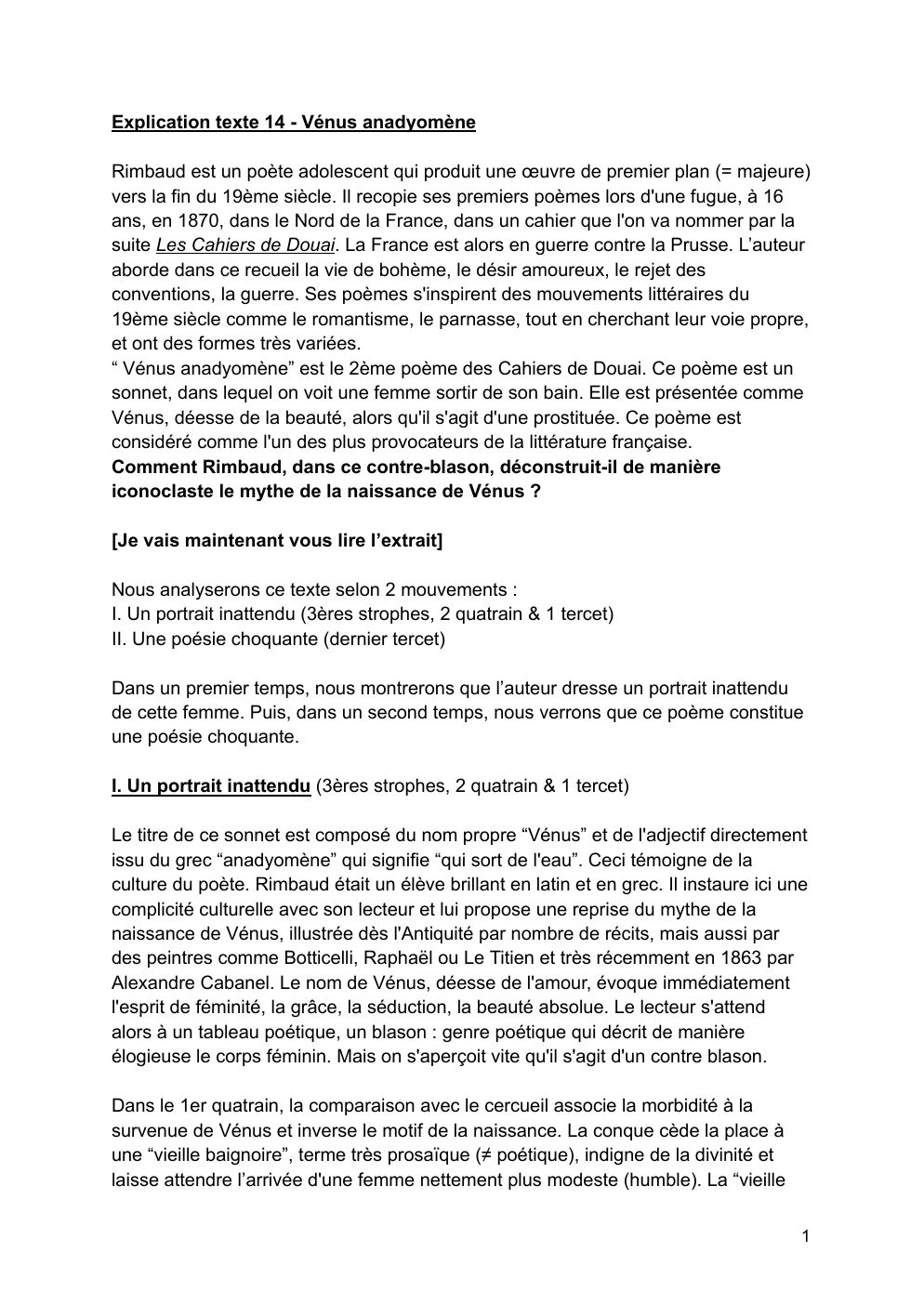Explication linéaire - Vénus anadyomène, Rimbaud
Publié le 05/10/2025
Extrait du document
«
Explication texte 14 - Vénus anadyomène
Rimbaud est un poète adolescent qui produit une œuvre de premier plan (= majeure)
vers la fin du 19ème siècle.
Il recopie ses premiers poèmes lors d'une fugue, à 16
ans, en 1870, dans le Nord de la France, dans un cahier que l'on va nommer par la
suite Les Cahiers de Douai.
La France est alors en guerre contre la Prusse.
L’auteur
aborde dans ce recueil la vie de bohème, le désir amoureux, le rejet des
conventions, la guerre.
Ses poèmes s'inspirent des mouvements littéraires du
19ème siècle comme le romantisme, le parnasse, tout en cherchant leur voie propre,
et ont des formes très variées.
“ Vénus anadyomène” est le 2ème poème des Cahiers de Douai.
Ce poème est un
sonnet, dans lequel on voit une femme sortir de son bain.
Elle est présentée comme
Vénus, déesse de la beauté, alors qu'il s'agit d'une prostituée.
Ce poème est
considéré comme l'un des plus provocateurs de la littérature française.
Comment Rimbaud, dans ce contre-blason, déconstruit-il de manière
iconoclaste le mythe de la naissance de Vénus ?
[Je vais maintenant vous lire l’extrait]
Nous analyserons ce texte selon 2 mouvements :
I.
Un portrait inattendu (3ères strophes, 2 quatrain & 1 tercet)
II.
Une poésie choquante (dernier tercet)
Dans un premier temps, nous montrerons que l’auteur dresse un portrait inattendu
de cette femme.
Puis, dans un second temps, nous verrons que ce poème constitue
une poésie choquante.
I.
Un portrait inattendu (3ères strophes, 2 quatrain & 1 tercet)
Le titre de ce sonnet est composé du nom propre “Vénus” et de l'adjectif directement
issu du grec “anadyomène” qui signifie “qui sort de l'eau”.
Ceci témoigne de la
culture du poète.
Rimbaud était un élève brillant en latin et en grec.
Il instaure ici une
complicité culturelle avec son lecteur et lui propose une reprise du mythe de la
naissance de Vénus, illustrée dès l'Antiquité par nombre de récits, mais aussi par
des peintres comme Botticelli, Raphaël ou Le Titien et très récemment en 1863 par
Alexandre Cabanel.
Le nom de Vénus, déesse de l'amour, évoque immédiatement
l'esprit de féminité, la grâce, la séduction, la beauté absolue.
Le lecteur s'attend
alors à un tableau poétique, un blason : genre poétique qui décrit de manière
élogieuse le corps féminin.
Mais on s'aperçoit vite qu'il s'agit d'un contre blason.
Dans le 1er quatrain, la comparaison avec le cercueil associe la morbidité à la
survenue de Vénus et inverse le motif de la naissance.
La conque cède la place à
une “vieille baignoire”, terme très prosaïque (≠ poétique), indigne de la divinité et
laisse attendre l’arrivée d'une femme nettement plus modeste (humble).
La “vieille
1
baignoire” dénature le cadre de la vision et semble inscrire le tableau dans la
dérision.
Le tableau du poète se présente donc d'emblée comme une parodie du
motif original.
De la même façon le jeu sur les couleurs et les matières “vert en
fer-blanc” dénature aussi le cadre, d'autant que le fer-blanc est un matériau
commun, de bas prix qui colle mal avec l'idée du sublime associé à l'image de la
déesse.
La femme, vieillissante, se dévoile progressivement, avec une certaine
difficulté traduite par les allitérations en F/ V.
La grâce semble céder la place à la
lourdeur et à la maladresse.
Le contre-rejet “une tête” met en valeur ce groupe
nominal : la tête semble coupée, dénuée d'humanité, d'autant plus que le mot rime
avec “bête” (qui peut signifier ici stupide ou proche de l'animal).
De même les
“cheveux bruns” s'opposent au blond vénitien souvent attribué à Vénus et en
donnent un portrait inattendu et décevant.
L'expression “fortement pommadés”
suggère des soins de beauté maladroits et s'oppose à l'idée d'une beauté naturelle.
Le bain n'a pas lavé cette Vénus, autrement la pommade aurait été ôtée : ce détail
renforce le dégoût que produit le personnage.
Bien des aspects de la description
évoquent la vieillesse : “vieille baignoire” / “cercueil” / le terme “déficits”, qui désigne
des imperfections physiques / le participe “ravaudés” au vers 4, complété par le
groupe adverbial “assez mal”.
Cette expression fait de cette Vénus une prostituée
vieillissante et miteuse dont le maquillage ne suffit plus à gommer la laideur.
Le
verbe “ravauder” désigne aussi le raccommodage des vêtements usés.
/ L'allitération
en [S] et [D] au vers 4 cherche à traduire l'amollissement des chairs.
Le verbe
“émerge” ôte tout caractère exceptionnel à l'apparition de cette femme, le geste
semble banal et pénible.
Le poète semble s'adonner à un blason, toutefois, le
portrait qu'il réalise ainsi est particulièrement dépréciatif : il s'agit donc d'un
contre-blason.
Le second quatrain poursuit la description introduite par “Puis”.
Suivant un regard
descendant, Rimbaud se livre à un portrait cru de cette femme vue de dos.
Il insiste
sur une....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- EXPLICATION LINÉAIRE: Rimbaud - Sensation
- Explication linéaire A la Musique Arthur Rimbaud, Poésies, 1870-1871
- Lecture Analytique 2 : Vénus anadyomène : Arthur Rimbaud
- Rimbaud – « Vénus Anadyomène », Les cahiers de Douai, 1919
- Commentaire du poème : Vénus Anadyomène De Arthur Rimbaud.