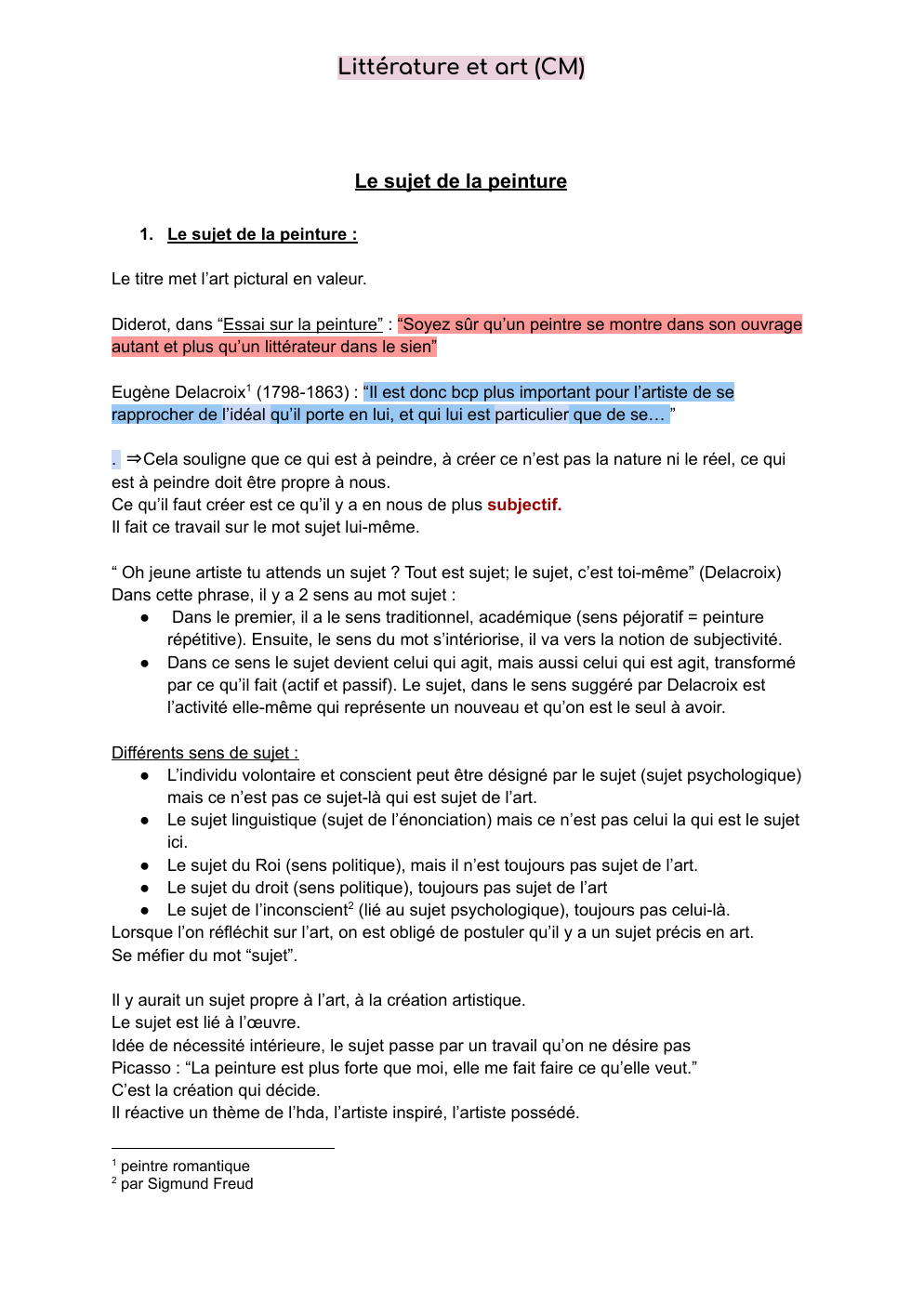Histoire littéraire: Littérature et art (CM)
Publié le 21/10/2022

Extrait du document
«
Littérature et art (CM)
Le sujet de la peinture
1.
Le sujet de la peinture :
Le titre met l’art pictural en valeur.
Diderot, dans “Essai sur la peinture” : “Soyez sûr qu’un peintre se montre dans son ouvrage
autant et plus qu’un littérateur dans le sien”
Eugène Delacroix1 (1798-1863) : “Il est donc bcp plus important pour l’artiste de se
rapprocher de l’idéal qu’il porte en lui, et qui lui est particulier que de se… ”
.
⇒Cela souligne que ce qui est à peindre, à créer ce n’est pas la nature ni le réel, ce qui
est à peindre doit être propre à nous.
Ce qu’il faut créer est ce qu’il y a en nous de plus subjectif.
Il fait ce travail sur le mot sujet lui-même.
“ Oh jeune artiste tu attends un sujet ? Tout est sujet; le sujet, c’est toi-même” (Delacroix)
Dans cette phrase, il y a 2 sens au mot sujet :
● Dans le premier, il a le sens traditionnel, académique (sens péjoratif = peinture
répétitive).
Ensuite, le sens du mot s’intériorise, il va vers la notion de subjectivité.
● Dans ce sens le sujet devient celui qui agit, mais aussi celui qui est agit, transformé
par ce qu’il fait (actif et passif).
Le sujet, dans le sens suggéré par Delacroix est
l’activité elle-même qui représente un nouveau et qu’on est le seul à avoir.
Différents sens de sujet :
● L’individu volontaire et conscient peut être désigné par le sujet (sujet psychologique)
mais ce n’est pas ce sujet-là qui est sujet de l’art.
● Le sujet linguistique (sujet de l’énonciation) mais ce n’est pas celui la qui est le sujet
ici.
● Le sujet du Roi (sens politique), mais il n’est toujours pas sujet de l’art.
● Le sujet du droit (sens politique), toujours pas sujet de l’art
● Le sujet de l’inconscient2 (lié au sujet psychologique), toujours pas celui-là.
Lorsque l’on réfléchit sur l’art, on est obligé de postuler qu’il y a un sujet précis en art.
Se méfier du mot “sujet”.
Il y aurait un sujet propre à l’art, à la création artistique.
Le sujet est lié à l’œuvre.
Idée de nécessité intérieure, le sujet passe par un travail qu’on ne désire pas
Picasso : “La peinture est plus forte que moi, elle me fait faire ce qu’elle veut.”
C’est la création qui décide.
Il réactive un thème de l’hda, l’artiste inspiré, l’artiste possédé.
1
2
peintre romantique
par Sigmund Freud
Ce thème est associé aux muses, quand un artiste veut faire qqc il invoque les muses3.
Chaque muse est l’allégorie4 du sujet de l’art.
P.S5 (1959) : “c’est ce que je fais qui m’apprend ce que je cherche”.
Cela rejoins l’idée de Picasso.
On ne peut pas confondre l’art et l’artisanat.
L’artisan fait ce qu’il veut faire et comment le faire, contrairement à l’artiste, mais il le fait
quand même.
Dans le domaine artistique, l’expérience, le savoir faire, au lieu de donner une maitrise
toujours plus grande ouvre vers l’inconnu.
L’art va vers l’inconescence.
Conséquence : si c’est vrai du sujet de l’art, ce sera vrai aussi du sujet qui fait l’art.
En art, le savoir est toujours inaccompli.
“L’art, c’est l’infini dans le fini” (Baudelaire)
Infini, car ça va vers l’inconnu.
Cela permet de réfléchir sur le début du XXe (début de l’art abstrait).
Les historiens de la
peinture pensent que l’apparition de la peinture non figurative est liée a la découverte de l’art
primitif (sculpture, masque africain/océanien).
Au début, ce n’est pas considéré comme des œuvres d’art, mais comme des objets culturels
et surtout religieux (ce qui était le cas au départ).
Ils nous renseigne sur des pratiques
archaïques.
Les artistes en France, vont se passionner pour ces œuvres.
Des gens comme Picasso,
Aragon… voient de l’art dans ces œuvres de l’art.
Ils vont s’en inspirer et même les imiter
(comme Picasso, qui le dis lui-même).
Tous ces artistes ont refusé de se documenter sur ces œuvres, sur le condition de création.
Un refus à la fois politique et historique de savoir au sens scientifique.
Dans un article de 1909 : “Il y a longtemps déjà qu’un grand nombre d’artistes ne cachent
plus leur admiration….comme toujours les musées sont en retard sur le goût.”
Il y a une question de temps.
Pour les musées à cette époque, ce n’est pas concevable que cela rentrent dans leur
bâtiment, à la rigueur, dans des musées ethnologiques.
“Les ouvrages des artistes anonymes de l’Afrique sont ce que l’imagination humaine de plus
puissant et plus beau” (Picasso)
Le musée court après l’art.
Un musée est une institution qui se consacre a ce qu’une société
reconnaît comme étant de l’art.Cela explique donc pourquoi les musées court après l’art, car
les sociétés méconnaissent l’inconnu de l’art.
L’inconnu de l’art est souvent, toujours
méconnu.
De ce fait, la réaction première est le rejet “c’est n’importe quoi”.
Ce qui passe pour du n’importe quoi, c’est en fait un je-ne-sais-quoi.
L’invention du sujet en art et en peinture part de 0.
3
filles d’Apollon et de la déesse Mnémosyne (déesse de la mémoire) qui sont chacune associé à une
discipline.
4
incarnation concrète d’une idée abstraite
5
Pierre Soulage, peintre abstrait
Merlau-Ponty (20e) dans “Sens et non sens” : “il peint comme si l’on avait jamais peint” en
parlant de Cézanne.
La création de l’art est toujours primitive, toute œuvre d’art est primitive.
Et la découverte des œuvres que l’on appelle primitive (aujourd’hui art premier), met à nu
d’un principe universel de l’art : ”l’art est toujours surgissement imprévisible”.
De ce fait, le
temps que prend la reconnaissance d’une œuvre est variable et parfois très long (en avance
sur leur temps).
Dans l’hdp, un peintre du 16e , le Greco.
Peinture novatrice qui a été si nouvelle qu’elle a été
oublié et rejetée.
Redécouverte au 19ᵉ (3 siècles d’oubli).
Perçu comme une œuvre majeure
ajd.
Au 16ᵉ, en poésie, Maurice Scève, qui a écrit une œuvre poétique vaste, très riche, mais qui
n’est apparu qu’au début du 20ᵉ siècle (400 ans de non reconnaissance).
Au 19ᵉ siècle, Lautréamont (originaire de l’Uruguay, qui a eu une existence brève) a écrit
“Les Champs de Maldoror” qui passe inaperçue lorsqu’elle est publiée.
L’effet retard est
moins long, car les surréaliste (notamment André Breton), 40 ans après sa publication, vont
la mettre en lumière.
P.S, en 1963 : “L’art du passée existe, mais c’est le nôtre qui peut seul le découvrir.
Pour
l’historien aujourd’hui né d’hier ; pour le créateur né d’aujourd’hui.” Paradoxe par le
retournement des termes.
Il y a l’idée qu’hier né d’aujourd’hui et cela va contre la logique,
contre la chronologie.
Le paradoxe peut être levé assez facilement.
L’idée est que le passé,
en art, à de l’avenir puisque le passé est toujours à redécouvrir.
L’avenir c’est le passé.
Par opposition à la logique de l’historien, pour qui aujourd’hui né d’hier (relation de cause à
effet).
Il à une logique causale, progressive et linéaire.
Cependant, cela ne fonctionne pas
en art, car son histoire n’est pas linéaire ou causale.
Nécessite d’une autre logique.
Autrement dit, en art tout est toujours au présent.
L’art fait comprendre que pour l’être
humain il n’y a que du présent.
En ce sens, le passé, c’est le présent du passé, le présent,
c’est le présent du présent et le futur le présent du futur.
Il n’y a que 3 présents.
C’est l’idée
du philosophe Saint Augustin, grand philosophe du temps.
La question de l’art implique un rapport au temps.
Baudelaire appelle cela la question de la
modernité.
2.
Le je-ne-sais-quoi :
L’art demande la logique du je-ne-sais-quoi.
Voltaire dans une lettre à Diderot (1773) : “Il y a dans tous les arts un je-ne-sais-quoi qu’il est
bien difficile d’attraper.”
Cette expression montre que la formule jnsq6 est bien connue des littéraires, elle apparait
dès le 17e et cette pensée est lié à la réflexion, à la pensée de l’art.
Calqué sur une formule latine “nesco quid”.
On la trouve dans les pièces de théâtres de
Corneille, Racine ou encore Molière, chez le philosophe Blaise Pascal ou encore chez
Bossuet.
La formule est reprise par Montesquieu, Mariveau, Voltaire…
Chez eux, la formule apparait dans 3 contextes précis :
- contexte artistique ou esthétique
- contexte de moral, réflexion morale
- contexte érotique (chez Molière)
6
je-ne-sais-quoi
- contexte mystique
On emploi cette expression en art pour parler de ce qui plait ou non sans que l’on puisse
l’expliquer.
Valable dans le domaine moral et érotique (synonyme du mot “charme”).
L’expression chercher à conceptualiser l’indéfinissable.
Dès qu’elle est employée, on est
face à quelque chose qui résiste à l’explication, qui échappe au moyen traditionnel de savoir.
Terme très employé par les mystiques7 pour expliquer le rapport au Divin (qui est
inexplicable).
L’artistique, l’erotique8, le moral et le mystiques se rejoignent par cette expression.
Marivau, en plus du théâtre et du roman a écrit des essais.
Dans son essai “Le cabinet du
philosophe”, il y a un apologue9, qui est une réflexion sur l’art.
2 demeures, dans l’une habite la beauté et l’autre le je-ne-sais-quoi.
Ils visitent les deux
maisons.
Commencent par celle de la beauté, qui est silencieuse (“elle ne parle qu’aux
yeux”, “elle nous dit toujours la même chose”), ils sont figés dans une sorte d’extase, elle
crée le silence chez ceux qui la regarde.
Ils sont face au parfait.
Chez le je-ne-sais-quoi,
c’est le contraire.
C’est une demeure qui va résonner de propos, de langage, car sa maison
est remplie de désordre.
C’est une sorte de joyeuse pagaille.
On sait qu’il est la mais on ne
le voit pas.
Le jnsp n’est pas un objet de contemplation comparé à la beauté.
Il est l’objet d’une
recherche qui passe par le langage (on l’appelle, le questionne).
Il appelle à une aventure
paisible chez Mariveau (“nous sommes résolu de le chercher toujours”).
Il y a une métaphore de l’art, qui chez Marivau est plus proche du jnsq que de la beauté.
Cette fable tend a montré que chez la beauté, il y a un mutisme et en ce sens une certaine
stérilité.
Elle n’engendre rien à part le mutisme alors que le jnsq tend vers le dicible, il y
quelque chose à dire.
Le visible pétrifie et rend silencieux alors que le dicible met en action une aventure
langagière.
Cette réflexion mène à une réflexion sur l’inconnu et le langage.
Question du comment dire
l’inconnu ? Qui reprend Comment parler de l’art ? Il disqualifie la beauté alors que c’est ce
qu’on associe à l’art.
Chez les artistes il y a tout un champ lexical :
- quelque chose (vu chez Soulage et aussi Baudelaire (1821-1867))
- je ne sais quoi
- …
Baudelaire, tout comme Diderot à fait des salons.
En 1846 : “Toutes les beautés contiennent comme tous les phénomènes possibles quelques
chose d’éternel et quelque chose de transitoire, -d’absolu et de particulier.”
Dans cette citation, le neutre indéfini lui permet d’abolir l’opposition traditionnelle entre
l’éternel et le transitoire (opposition de l’absolu et du particulier).
Car en art ces choses
s’associent.
7
Jean de la Croix (16e), poète et mystique.
Œuvre “Quantique de la nuit obscure”.
Montesquieu, Essai sur le goût, réfléchit sur le charme féminin (il emploi le je-ne-sais-quoi pour
parler des femmes dites laides).
9
petite histoire concrète qui a une leçon
8
Fusées10 : “J’ai trouvé la définition du Beau, -de mon Beau.....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- HISTOIRE DE LA GUERRE DE TRENTE ANS (Exposé – Art & Littérature – Collège/Lycée)
- L'histoire de la musique occidentale: la musique religieuse (Exposé – Art & Littérature – Collège/Lycée)
- « L'étude de l'histoire littéraire est destinée à remplacer en grande partie la lecture directe des Oeuvres de l'esprit humain. » A cette affirmation de Renan, Lanson répond dans l'avant-propos de son Histoire de la Littérature française : « Je voudrais que cet ouvrage ne fournît pas une dispense de lire les Oeuvres originales, mais une raison de les lire, qu'il éveillât les curiosités au lieu de les éteindre. » Étudier ces deux jugements. ?
- Michelet écrit en 1855: "Nous avons évoqué l'histoire, et la voici partout; nous en sommes assiégés, étouffés, écrasés; nous marchons tout courbés sous ce bagage, nous ne respirons plus, n'inventons plus. Le passé tue l'avenir. D'où vient que l'art est mort (sauf de si rares exceptions) ? c'est que l'histoire l'a tué." Est-ce qu'au XIXe siècle l'histoire a tué ou renouvelé l'art et la littérature ?
- INSTITUTION LITTÉRAIRE (Histoire de la littérature)