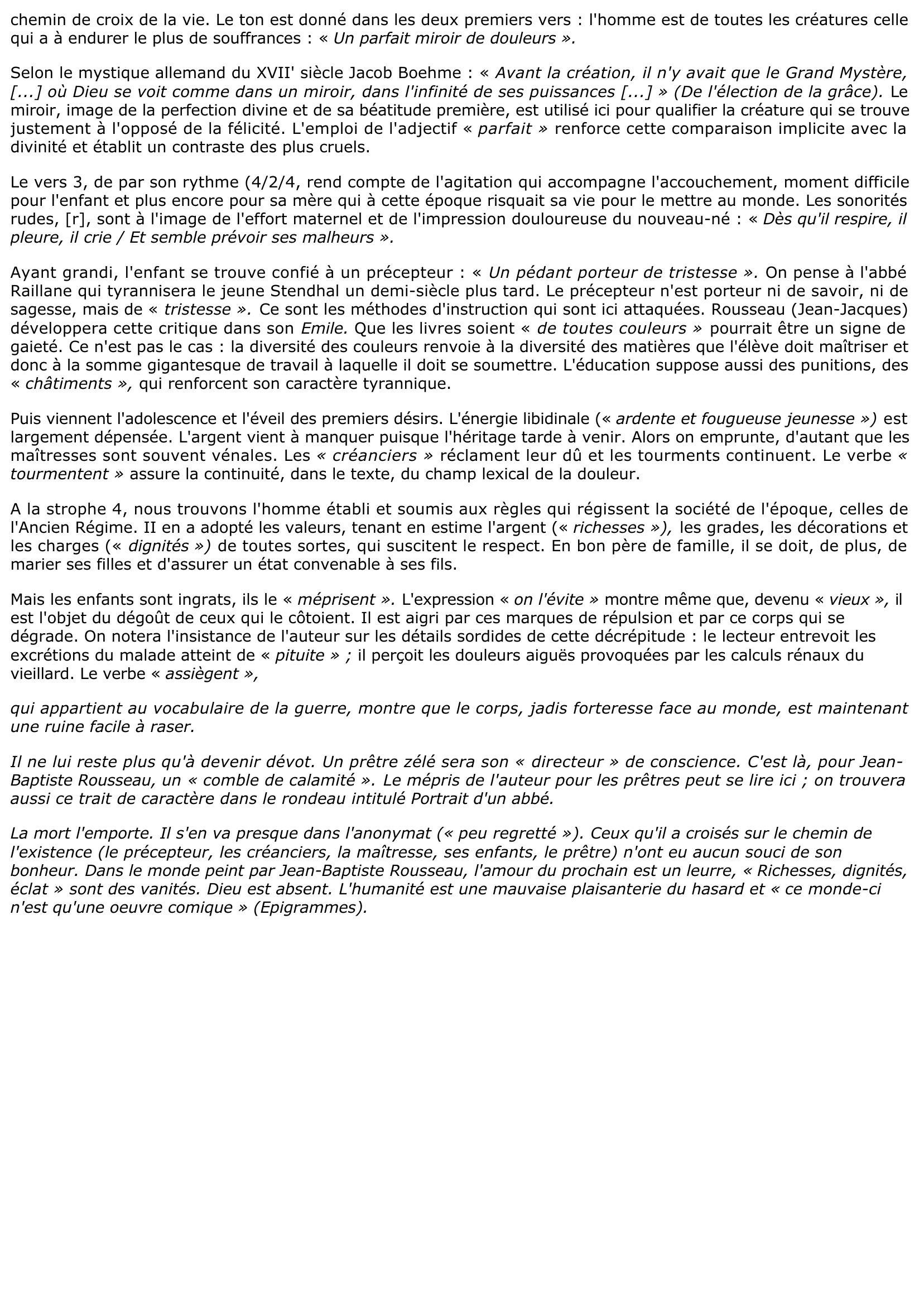Jean-Baptiste Rousseau - Stances
Publié le 17/01/2022

Extrait du document
«
chemin de croix de la vie.
Le ton est donné dans les deux premiers vers : l'homme est de toutes les créatures cellequi a à endurer le plus de souffrances : « Un parfait miroir de douleurs ».
Selon le mystique allemand du XVII' siècle Jacob Boehme : « Avant la création, il n'y avait que le Grand Mystère, [...] où Dieu se voit comme dans un miroir, dans l'infinité de ses puissances [...] » (De l'élection de la grâce).
Le miroir, image de la perfection divine et de sa béatitude première, est utilisé ici pour qualifier la créature qui se trouvejustement à l'opposé de la félicité.
L'emploi de l'adjectif « parfait » renforce cette comparaison implicite avec la divinité et établit un contraste des plus cruels.
Le vers 3, de par son rythme (4/2/4, rend compte de l'agitation qui accompagne l'accouchement, moment difficilepour l'enfant et plus encore pour sa mère qui à cette époque risquait sa vie pour le mettre au monde.
Les sonoritésrudes, [r], sont à l'image de l'effort maternel et de l'impression douloureuse du nouveau-né : « Dès qu'il respire, il pleure, il crie / Et semble prévoir ses malheurs ».
Ayant grandi, l'enfant se trouve confié à un précepteur : « Un pédant porteur de tristesse ».
On pense à l'abbé Raillane qui tyrannisera le jeune Stendhal un demi-siècle plus tard.
Le précepteur n'est porteur ni de savoir, ni desagesse, mais de « tristesse ».
Ce sont les méthodes d'instruction qui sont ici attaquées.
Rousseau (Jean-Jacques) développera cette critique dans son Emile.
Que les livres soient « de toutes couleurs » pourrait être un signe de gaieté.
Ce n'est pas le cas : la diversité des couleurs renvoie à la diversité des matières que l'élève doit maîtriser etdonc à la somme gigantesque de travail à laquelle il doit se soumettre.
L'éducation suppose aussi des punitions, des« châtiments », qui renforcent son caractère tyrannique.
Puis viennent l'adolescence et l'éveil des premiers désirs.
L'énergie libidinale (« ardente et fougueuse jeunesse ») est largement dépensée.
L'argent vient à manquer puisque l'héritage tarde à venir.
Alors on emprunte, d'autant que lesmaîtresses sont souvent vénales.
Les « créanciers » réclament leur dû et les tourments continuent.
Le verbe « tourmentent » assure la continuité, dans le texte, du champ lexical de la douleur.
A la strophe 4, nous trouvons l'homme établi et soumis aux règles qui régissent la société de l'époque, celles del'Ancien Régime.
II en a adopté les valeurs, tenant en estime l'argent (« richesses »), les grades, les décorations et les charges (« dignités ») de toutes sortes, qui suscitent le respect.
En bon père de famille, il se doit, de plus, de marier ses filles et d'assurer un état convenable à ses fils.
Mais les enfants sont ingrats, ils le « méprisent ».
L'expression « on l'évite » montre même que, devenu « vieux », il est l'objet du dégoût de ceux qui le côtoient.
Il est aigri par ces marques de répulsion et par ce corps qui sedégrade.
On notera l'insistance de l'auteur sur les détails sordides de cette décrépitude : le lecteur entrevoit lesexcrétions du malade atteint de « pituite » ; il perçoit les douleurs aiguës provoquées par les calculs rénaux du vieillard.
Le verbe « assiègent »,
qui appartient au vocabulaire de la guerre, montre que le corps, jadis forteresse face au monde, est maintenantune ruine facile à raser.
Il ne lui reste plus qu'à devenir dévot.
Un prêtre zélé sera son « directeur » de conscience.
C'est là, pour Jean- Baptiste Rousseau, un « comble de calamité ».
Le mépris de l'auteur pour les prêtres peut se lire ici ; on trouvera aussi ce trait de caractère dans le rondeau intitulé Portrait d'un abbé.
La mort l'emporte.
Il s'en va presque dans l'anonymat (« peu regretté »).
Ceux qu'il a croisés sur le chemin de l'existence (le précepteur, les créanciers, la maîtresse, ses enfants, le prêtre) n'ont eu aucun souci de sonbonheur.
Dans le monde peint par Jean-Baptiste Rousseau, l'amour du prochain est un leurre, « Richesses, dignités, éclat » sont des vanités.
Dieu est absent.
L'humanité est une mauvaise plaisanterie du hasard et « ce monde-ci n'est qu'une oeuvre comique » (Epigrammes)..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- ROUSSEAU (Jean-Baptiste)
- ROUSSEAU Jean-Baptiste
- ROUSSEAU ( JEAN-BAPTISTE)
- Le Temps, cette image mobile - De l'immobile éternité. Odes, III, 2 Rousseau, Jean-Baptiste. Commentez cette citation.
- Et semblable à l'abeille en nos jardins éclose, - De différentes fleurs j'assemble et je compose - Le miel que je produis. Odes, Livre III Rousseau, Jean-Baptiste. Commentez cette citation.