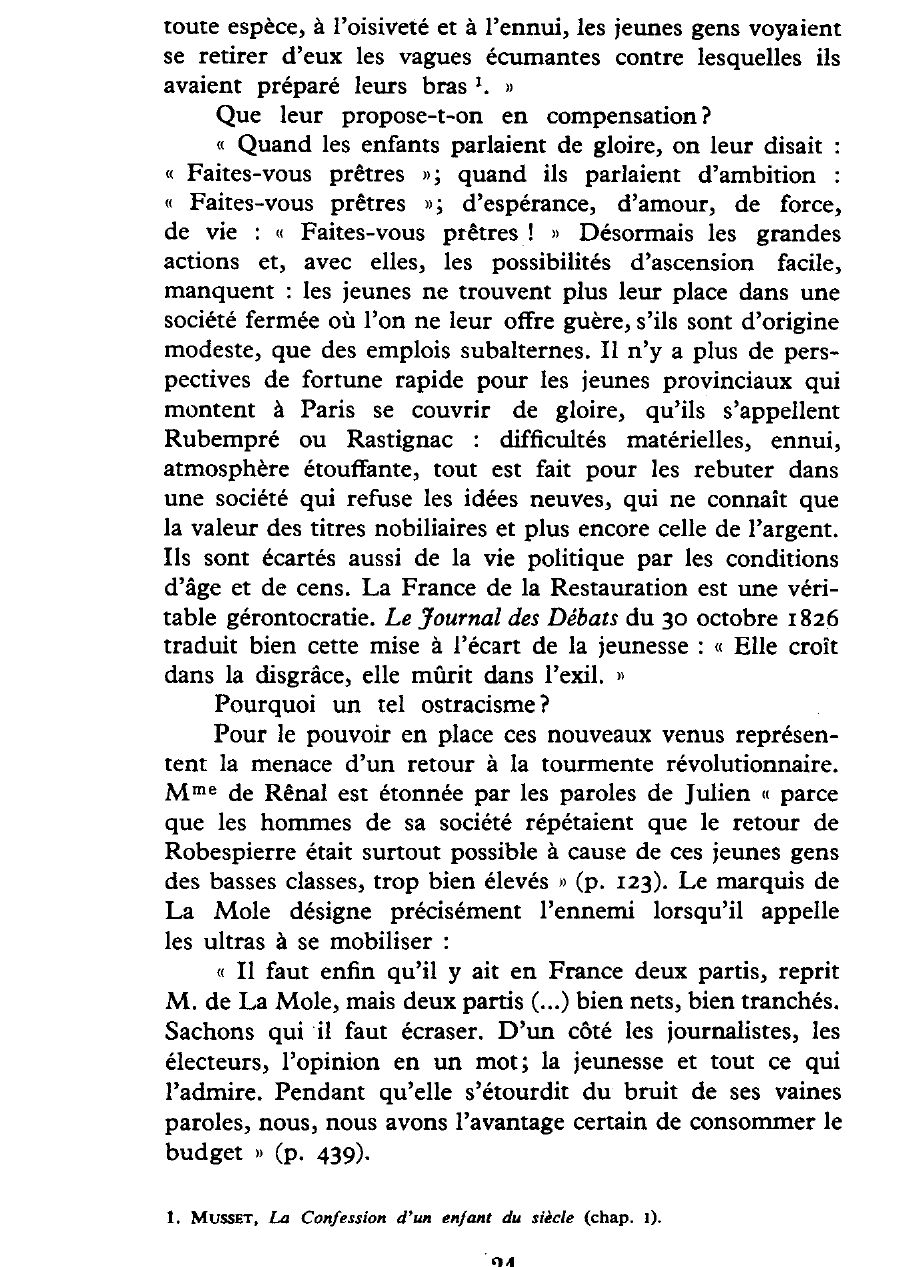Jeunesse et société ou « La chronique de 1830 »
Publié le 27/06/2015

Extrait du document
«
toute espèce, à l'oisiveté et à l'ennui, les jeunes gens voyaient
se
retirer d'eux les vagues écumantes contre lesquelles ils
avaient préparé leurs bras 1
• "
Que leur propose-t-on en compensation?
" Quand les enfants parlaient de gloire, on leur disait
" Faites-vous prêtres "; quand ils parlaient d'ambition
" Faites-vous prêtres "; d'espérance, d'amour, de force,
de vie :
" Faites-vous prêtres ! " Désormais les grandes
actions et, avec elles, les possibilités d'ascension facile,
manquent : les jeunes ne trouvent plus leur place dans une
société fermée où l'on ne leur offre guère, s'ils sont d'origine
modeste, que des emplois subalternes.
Il n'y a plus de pers
pectives
de fortune rapide pour les jeunes provinciaux qui
montent à Paris se couvrir de gloire, qu'ils s'appellent
Rubempré ou Rastignac : difficultés matérielles, ennui,
atmosphère étouffante, tout est fait pour les rebuter dans
une société qui refuse les idées neuves, qui ne connaît que
la valeur des titres nobiliaires et plus encore celle de l'argent.
Ils sont écartés aussi de la vie politique
par les conditions
d'âge et
de cens.
La France de la Restauration est une véri
table gérontocratie.
Le Journal des Débats du 30 octobre 1826
traduit bien cette mise à l'écart de la jeunesse : " Elle croît
dans la disgrâce, elle
mûrit dans l'exil.
"
Pourquoi un tel ostracisme?
Pour le pouvoir en place ces nouveaux venus représen
tent la menace d'un retour à la tourmente révolutionnaire.
Mme de Rênal est étonnée
par les paroles de Julien « parce
que les hommes de sa société répétaient que le
retour de
Robespierre était surtout possible à cause de ces jeunes gens
des basses classes,
trop bien élevés " (p.
123).
Le marquis de
La Mole désigne précisément l'ennemi lorsqu'il appelle
les ultras
à se mobiliser :
" Il faut enfin qu'il y ait en France deux partis, reprit
M.
de La Mole, mais deux partis ( ...
) bien nets, bien tranchés.
Sachons qui il faut écraser.
D'un côté les journalistes, les
électeurs, l'opinion
en un mot; la jeunesse et tout ce qui
l'admire.
Pendant qu'elle s'étourdit du bruit de ses vaines
paroles, nous, nous avons l'avantage certain de consommer le
budget " (p.
439).
l.
MUSSET, La Confession d'un enfant du siècle (chap.
1).
- 21 -.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Le Rouge et le Noir & Chronique de 1830 de Stendhal (analyse détaillée)
- « La chronique de 1830 » _ Le Rouge et le Noir de Stendhal
- Stendhal peintre et critique de la société de 1830 d 'après « Le Rouge et le Noir ».
- Stendhal peintre et critique de la société de 1830 d'après « Le Rouge et le Noir ».
- La jeunesse actuelle se dit souvent peu satisfaite du monde des adultes (parents, professeurs, société...). Partagez-vous entièrement ce point de vue? Construisez votre argumentation en l'illustrant par des exemples précis tirés ou non de votre expérience personnelle.