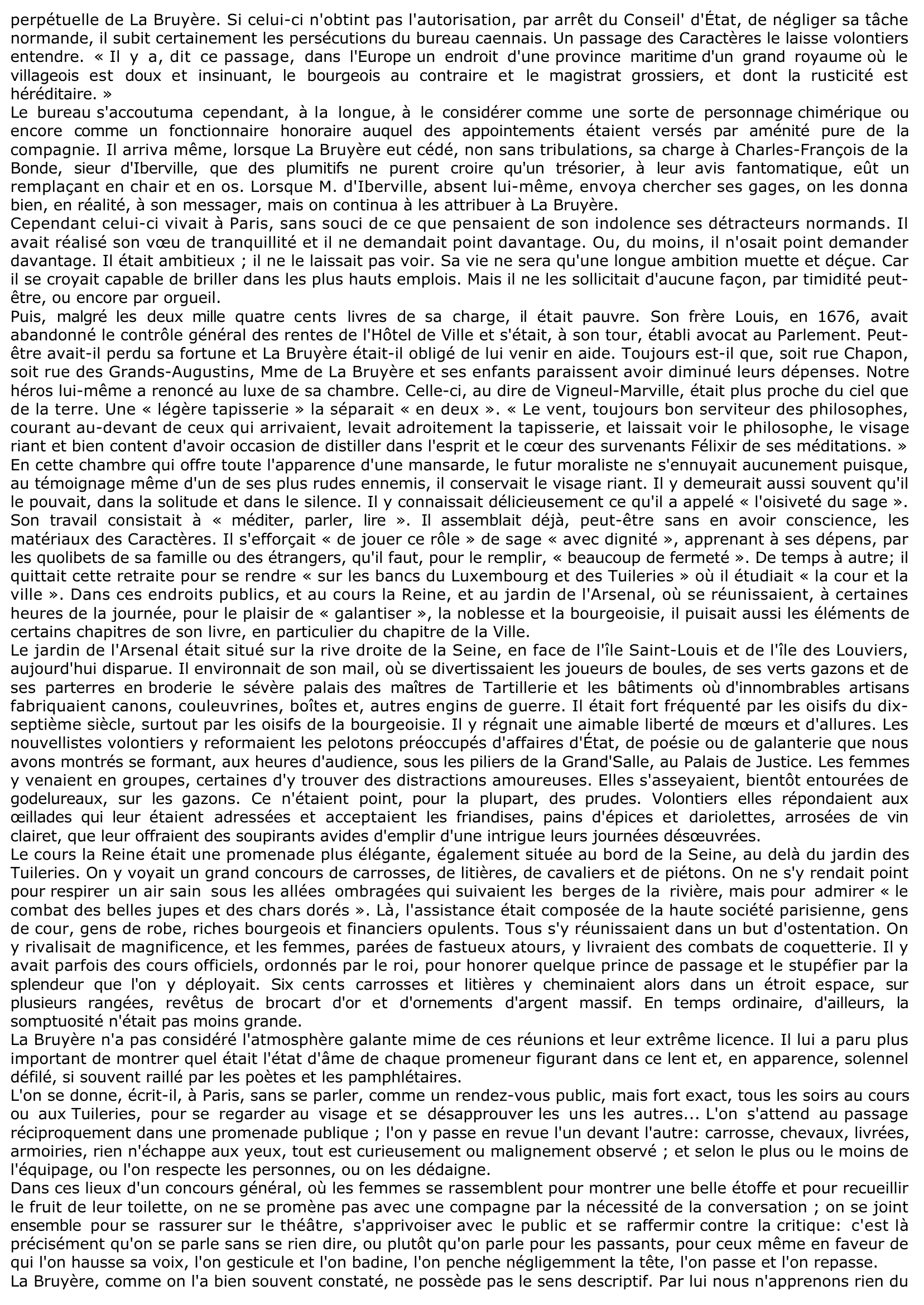LA BRUYÈRE TRESORIER GENERAL DES FINANCES
Publié le 07/07/2011

Extrait du document
On ne doit point exagérer le désintéressement de La Bruyère, et penser que, les jugeant, il planait au-dessus des hommes. Bien que, par certains endroits de son caractère, il leur fût supérieur, il en partageait néanmoins, sur beaucoup d'autres, leurs défauts. Il avait, on peut le présumer, toujours considéré sa situation d'avocat au Parlement comme transitoire. Elle le préservait d'une oisiveté qui conduit à la mollesse. Elle lui ouvrait quelques portes closes aux désœuvrés, celles, par exemple, de confrères célèbres, comme Jean de Gomont et Georges du Hamel. Elle lui procurait la considération de contemporains intelligents, érudits ou hommes de lettres. Mais il n'avait pas l'intention de la conserver toute sa vie. De plus en plus incliné par son tempérament à l'existence méditative, il cherchait « un office lucratif, qui rendît la vie aimable, qui fît prêter à ses amis et donner à ceux qui ne peuvent rendre «. En d'autres termes, il était en quête d'une grasse sinécure. Or, les grasses sinécures s'achetaient chèrement et étaient, en outre, assez recherchées pour que les vacances en fussent rares. Les fils, le plus souvent, obtenaient la survivance des pères décédés.
«
perpétuelle de La Bruyère.
Si celui-ci n'obtint pas l'autorisation, par arrêt du Conseil' d'État, de négliger sa tâchenormande, il subit certainement les persécutions du bureau caennais.
Un passage des Caractères le laisse volontiersentendre.
« Il y a, dit ce passage, dans l'Europe un endroit d'une province maritime d'un grand royaume où levillageois est doux et insinuant, le bourgeois au contraire et le magistrat grossiers, et dont la rusticité esthéréditaire.
»Le bureau s'accoutuma cependant, à la longue, à le considérer comme une sorte de personnage chimérique ouencore comme un fonctionnaire honoraire auquel des appointements étaient versés par aménité pure de lacompagnie.
Il arriva même, lorsque La Bruyère eut cédé, non sans tribulations, sa charge à Charles-François de laBonde, sieur d'Iberville, que des plumitifs ne purent croire qu'un trésorier, à leur avis fantomatique, eût unremplaçant en chair et en os.
Lorsque M.
d'Iberville, absent lui-même, envoya chercher ses gages, on les donnabien, en réalité, à son messager, mais on continua à les attribuer à La Bruyère.Cependant celui-ci vivait à Paris, sans souci de ce que pensaient de son indolence ses détracteurs normands.
Ilavait réalisé son vœu de tranquillité et il ne demandait point davantage.
Ou, du moins, il n'osait point demanderdavantage.
Il était ambitieux ; il ne le laissait pas voir.
Sa vie ne sera qu'une longue ambition muette et déçue.
Caril se croyait capable de briller dans les plus hauts emplois.
Mais il ne les sollicitait d'aucune façon, par timidité peut-être, ou encore par orgueil.Puis, malgré les deux mille quatre cents livres de sa charge, il était pauvre.
Son frère Louis, en 1676, avaitabandonné le contrôle général des rentes de l'Hôtel de Ville et s'était, à son tour, établi avocat au Parlement.
Peut-être avait-il perdu sa fortune et La Bruyère était-il obligé de lui venir en aide.
Toujours est-il que, soit rue Chapon,soit rue des Grands-Augustins, Mme de La Bruyère et ses enfants paraissent avoir diminué leurs dépenses.
Notrehéros lui-même a renoncé au luxe de sa chambre.
Celle-ci, au dire de Vigneul-Marville, était plus proche du ciel quede la terre.
Une « légère tapisserie » la séparait « en deux ».
« Le vent, toujours bon serviteur des philosophes,courant au-devant de ceux qui arrivaient, levait adroitement la tapisserie, et laissait voir le philosophe, le visageriant et bien content d'avoir occasion de distiller dans l'esprit et le cœur des survenants Félixir de ses méditations.
»En cette chambre qui offre toute l'apparence d'une mansarde, le futur moraliste ne s'ennuyait aucunement puisque,au témoignage même d'un de ses plus rudes ennemis, il conservait le visage riant.
Il y demeurait aussi souvent qu'ille pouvait, dans la solitude et dans le silence.
Il y connaissait délicieusement ce qu'il a appelé « l'oisiveté du sage ».Son travail consistait à « méditer, parler, lire ».
Il assemblait déjà, peut-être sans en avoir conscience, lesmatériaux des Caractères.
Il s'efforçait « de jouer ce rôle » de sage « avec dignité », apprenant à ses dépens, parles quolibets de sa famille ou des étrangers, qu'il faut, pour le remplir, « beaucoup de fermeté ».
De temps à autre; ilquittait cette retraite pour se rendre « sur les bancs du Luxembourg et des Tuileries » où il étudiait « la cour et laville ».
Dans ces endroits publics, et au cours la Reine, et au jardin de l'Arsenal, où se réunissaient, à certainesheures de la journée, pour le plaisir de « galantiser », la noblesse et la bourgeoisie, il puisait aussi les éléments decertains chapitres de son livre, en particulier du chapitre de la Ville.Le jardin de l'Arsenal était situé sur la rive droite de la Seine, en face de l'île Saint-Louis et de l'île des Louviers,aujourd'hui disparue.
Il environnait de son mail, où se divertissaient les joueurs de boules, de ses verts gazons et deses parterres en broderie le sévère palais des maîtres de Tartillerie et les bâtiments où d'innombrables artisansfabriquaient canons, couleuvrines, boîtes et, autres engins de guerre.
Il était fort fréquenté par les oisifs du dix-septième siècle, surtout par les oisifs de la bourgeoisie.
Il y régnait une aimable liberté de mœurs et d'allures.
Lesnouvellistes volontiers y reformaient les pelotons préoccupés d'affaires d'État, de poésie ou de galanterie que nousavons montrés se formant, aux heures d'audience, sous les piliers de la Grand'Salle, au Palais de Justice.
Les femmesy venaient en groupes, certaines d'y trouver des distractions amoureuses.
Elles s'asseyaient, bientôt entourées degodelureaux, sur les gazons.
Ce n'étaient point, pour la plupart, des prudes.
Volontiers elles répondaient auxœillades qui leur étaient adressées et acceptaient les friandises, pains d'épices et dariolettes, arrosées de vinclairet, que leur offraient des soupirants avides d'emplir d'une intrigue leurs journées désœuvrées.Le cours la Reine était une promenade plus élégante, également située au bord de la Seine, au delà du jardin desTuileries.
On y voyait un grand concours de carrosses, de litières, de cavaliers et de piétons.
On ne s'y rendait pointpour respirer un air sain sous les allées ombragées qui suivaient les berges de la rivière, mais pour admirer « lecombat des belles jupes et des chars dorés ».
Là, l'assistance était composée de la haute société parisienne, gensde cour, gens de robe, riches bourgeois et financiers opulents.
Tous s'y réunissaient dans un but d'ostentation.
Ony rivalisait de magnificence, et les femmes, parées de fastueux atours, y livraient des combats de coquetterie.
Il yavait parfois des cours officiels, ordonnés par le roi, pour honorer quelque prince de passage et le stupéfier par lasplendeur que l'on y déployait.
Six cents carrosses et litières y cheminaient alors dans un étroit espace, surplusieurs rangées, revêtus de brocart d'or et d'ornements d'argent massif.
En temps ordinaire, d'ailleurs, lasomptuosité n'était pas moins grande.La Bruyère n'a pas considéré l'atmosphère galante mime de ces réunions et leur extrême licence.
Il lui a paru plusimportant de montrer quel était l'état d'âme de chaque promeneur figurant dans ce lent et, en apparence, solenneldéfilé, si souvent raillé par les poètes et les pamphlétaires.L'on se donne, écrit-il, à Paris, sans se parler, comme un rendez-vous public, mais fort exact, tous les soirs au coursou aux Tuileries, pour se regarder au visage et se désapprouver les uns les autres...
L'on s'attend au passageréciproquement dans une promenade publique ; l'on y passe en revue l'un devant l'autre: carrosse, chevaux, livrées,armoiries, rien n'échappe aux yeux, tout est curieusement ou malignement observé ; et selon le plus ou le moins del'équipage, ou l'on respecte les personnes, ou on les dédaigne.Dans ces lieux d'un concours général, où les femmes se rassemblent pour montrer une belle étoffe et pour recueillirle fruit de leur toilette, on ne se promène pas avec une compagne par la nécessité de la conversation ; on se jointensemble pour se rassurer sur le théâtre, s'apprivoiser avec le public et se raffermir contre la critique: c'est làprécisément qu'on se parle sans se rien dire, ou plutôt qu'on parle pour les passants, pour ceux même en faveur dequi l'on hausse sa voix, l'on gesticule et l'on badine, l'on penche négligemment la tête, l'on passe et l'on repasse.La Bruyère, comme on l'a bien souvent constaté, ne possède pas le sens descriptif.
Par lui nous n'apprenons rien du.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Explication linéaire ascension sociale - Jean de la Bruyère
- Dissertation : D'après votre lecture des caractères de La Bruyère et d’autres moralistes que vous avez lus, peut-on dire que “tous les hommes se valent”, ou émerge t’il des différences entre les personnes et les caractères ? Vous développerez vos impressions de lecture en vous appuyant sur des exemples précis.
- la bruyère - ménalque
- La Bruyère, les Caractères (étude littéraire)
- commentaire: De la cour de La bruyère in les "Caractères"