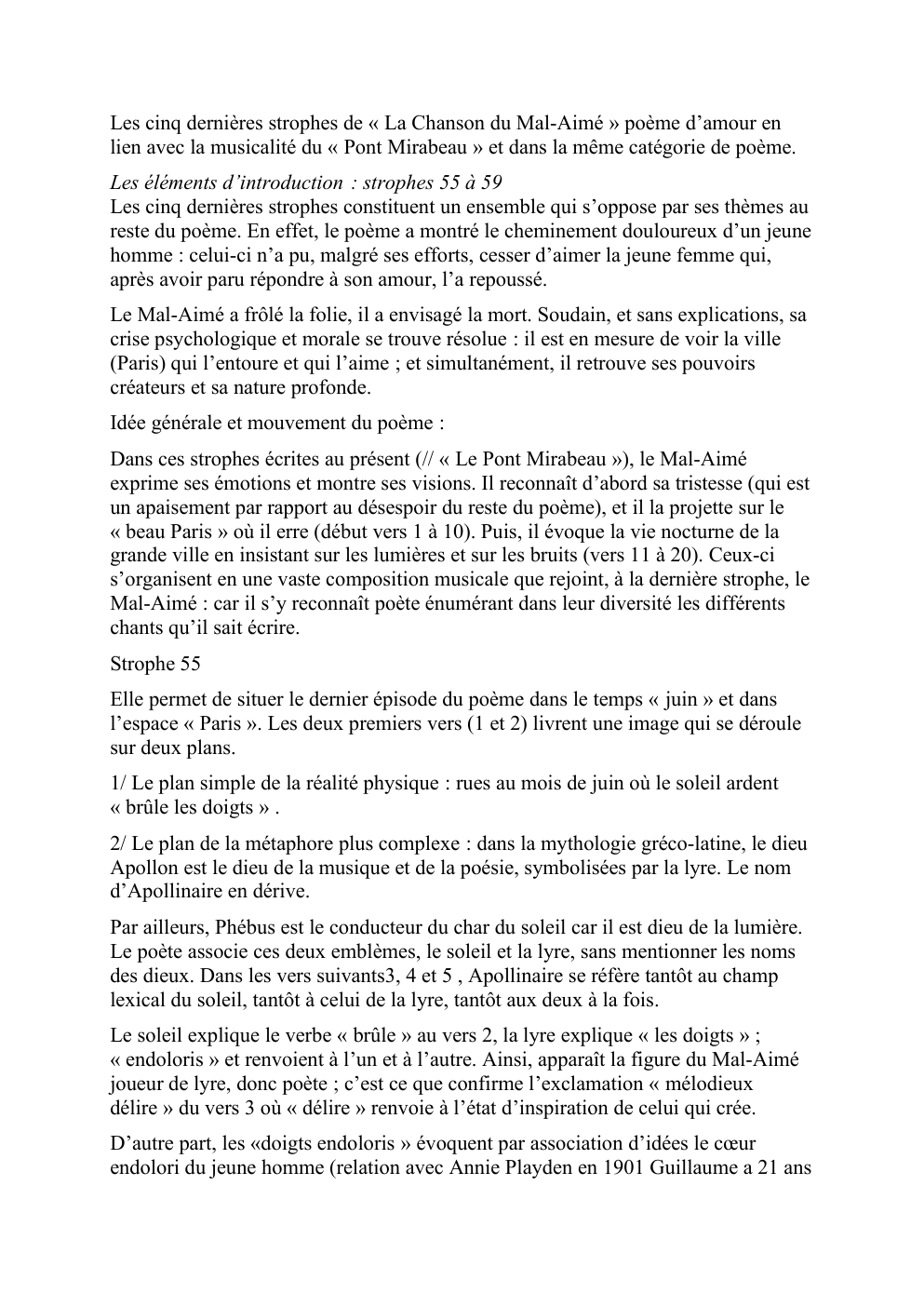La Chanson du mal-aimé d'Apollinaire : commentaire
Publié le 27/12/2022
Extrait du document
«
Les cinq dernières strophes de « La Chanson du Mal-Aimé » poème d’amour en
lien avec la musicalité du « Pont Mirabeau » et dans la même catégorie de poème.
Les éléments d’introduction : strophes 55 à 59
Les cinq dernières strophes constituent un ensemble qui s’oppose par ses thèmes au
reste du poème.
En effet, le poème a montré le cheminement douloureux d’un jeune
homme : celui-ci n’a pu, malgré ses efforts, cesser d’aimer la jeune femme qui,
après avoir paru répondre à son amour, l’a repoussé.
Le Mal-Aimé a frôlé la folie, il a envisagé la mort.
Soudain, et sans explications, sa
crise psychologique et morale se trouve résolue : il est en mesure de voir la ville
(Paris) qui l’entoure et qui l’aime ; et simultanément, il retrouve ses pouvoirs
créateurs et sa nature profonde.
Idée générale et mouvement du poème :
Dans ces strophes écrites au présent (// « Le Pont Mirabeau »), le Mal-Aimé
exprime ses émotions et montre ses visions.
Il reconnaît d’abord sa tristesse (qui est
un apaisement par rapport au désespoir du reste du poème), et il la projette sur le
« beau Paris » où il erre (début vers 1 à 10).
Puis, il évoque la vie nocturne de la
grande ville en insistant sur les lumières et sur les bruits (vers 11 à 20).
Ceux-ci
s’organisent en une vaste composition musicale que rejoint, à la dernière strophe, le
Mal-Aimé : car il s’y reconnaît poète énumérant dans leur diversité les différents
chants qu’il sait écrire.
Strophe 55
Elle permet de situer le dernier épisode du poème dans le temps « juin » et dans
l’espace « Paris ».
Les deux premiers vers (1 et 2) livrent une image qui se déroule
sur deux plans.
1/ Le plan simple de la réalité physique : rues au mois de juin où le soleil ardent
« brûle les doigts » .
2/ Le plan de la métaphore plus complexe : dans la mythologie gréco-latine, le dieu
Apollon est le dieu de la musique et de la poésie, symbolisées par la lyre.
Le nom
d’Apollinaire en dérive.
Par ailleurs, Phébus est le conducteur du char du soleil car il est dieu de la lumière.
Le poète associe ces deux emblèmes, le soleil et la lyre, sans mentionner les noms
des dieux.
Dans les vers suivants3, 4 et 5 , Apollinaire se réfère tantôt au champ
lexical du soleil, tantôt à celui de la lyre, tantôt aux deux à la fois.
Le soleil explique le verbe « brûle » au vers 2, la lyre explique « les doigts » ;
« endoloris » et renvoient à l’un et à l’autre.
Ainsi, apparaît la figure du Mal-Aimé
joueur de lyre, donc poète ; c’est ce que confirme l’exclamation « mélodieux
délire » du vers 3 où « délire » renvoie à l’état d’inspiration de celui qui crée.
D’autre part, les «doigts endoloris » évoquent par association d’idées le cœur
endolori du jeune homme (relation avec Annie Playden en 1901 Guillaume a 21 ans
et il est engagé comme précepteur de français auprès de la fille de la vicomtesse de
Milhau qu’il accompagne sur les bords du Rhin avec la gouvernante Annie dont il
tombe éperdument amoureux) dont l’immense désespoir amoureux a été chanté
dans les cinquante-quatre strophes précédentes.
Ainsi, s’explique « triste » qui qualifie « délire » au vers 3.
La crise psychologique
et morale s’est résolue d’elle-même, la tentation du suicide n’aboutit pas, comme le
confirme le vers 5 « sans avoir le cœur d’y mourir ».
Le cœur est synonyme de
courage comme dans la langue du XVII e siècle, mais il peut recouvrir la résonance
amoureuse (strophe 41 l’image du cœur percé de sept épées)
Strophe 56
Les images de l’errance se développent et suit la tristesse évoquée dans la strophe
précédente.
Nous remarquons, lecteurs, que le Mal-Aimé ne semble rencontrer
aucun être humain dans la ville à l’inverse de sa démarche ultérieure dans « Zone »
au début et à la fin de ce poème.
Dans la chanson, Apollinaire exprime sa solitude.
Vers 6, il s’attarde sur la longueur des dimanches où l’hyperbole (exagération à
valeur expressive) traduit son ennui.
Les dimanches s’y éternisent (octosyllabe)
Apollinaire ne décrit que des choses inanimées « orgues de barbarie » vers 7 et
« fleurs au balcons » vers 9 auxquelles le poète prête parfois des sentiments
humains, les orgues sanglotent au vers 8 comme s’ils prenaient à leur compte la
peine du jeune homme.
Au vers 10, les fleurs « penchent » comme saturées de
soleil et prêtes à mourir.
Pourtant, la strophe s’achève sur une comparaison
insolite :
Penchent comme la tour de Pise
L’humour de la comparaison rééquilibre la tristesse des vers précédents.
Tout se
passe comme si le jeune homme avait à présent maîtrisé sa peine et pouvait dès lors
renoncer à sa tristesse : les deux strophes suivantes vont célébrer la lumière, la
musique, la vie.
Strophe 57
Vers 11 et 12
Soirs de Paris ivres de gin
Flambant de l’électricité
Cette strophe comme la suivante sont consacrées aux soirs vécus dans la capitale.
Ces derniers sont personnifiés par le groupe épithète « ivres de gin/Flambant ».
De
plus, cette personnification s’accompagne d’une métaphore ( fin de « Zone »)qui
assimile à un alcool (le gin) l’électricité qui illumine la ville.
Les lecteurs
comprennent les deux registres de l’épithète « flambant » = brûlant comme le gin
dans la gorge, flamboyant comme l’électricité dans les rues et les cafés.
Les trois derniers vers témoignent d’une écriture complexe.
Au niveau de la réalité
physique, ils évoquent le déplacement, saccadé et sonore sur les « rails » vers 15,
des « tramways » vers 13 munis, à l’époque, tels des bateaux d’aujourd’hui, de
« feux » de route « verts » vers 13.
Mais, Apollinaire superpose (complexité de l’écriture et de la composition du
recueil) plusieurs niveaux distincts de métaphore.
D’une part, il assimile ces tramways à des animaux portant le long des flancs « sur
l’échine » vers 13 ces « feux » de route « verts ».
D’autre part, il tire de l’oubli le
verbe « musiquer » très employé aux XVI e et XVIII e et s’appuyant sur l’analogie
de forme qui unit les rails et les portées sur lesquelles on écrit la musique (cinq
lignes horizontales parallèles)
Apollinaire transforme ces mêmes tramways en notes qui vers 14 et 15:....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Commentaire Du Poème La "chanson Du Mal Aimé" D'apollinaire.
- Analyse du poème d'Apollinaire "La Chanson du mal-aimé"
- La Chanson Du Mal Aimé - Apollinaire
- Apollinaire: Fin de la chanson du mal aimé Alcools
- La Chanson Du Mal Aimé De Guillaume Apollinaire