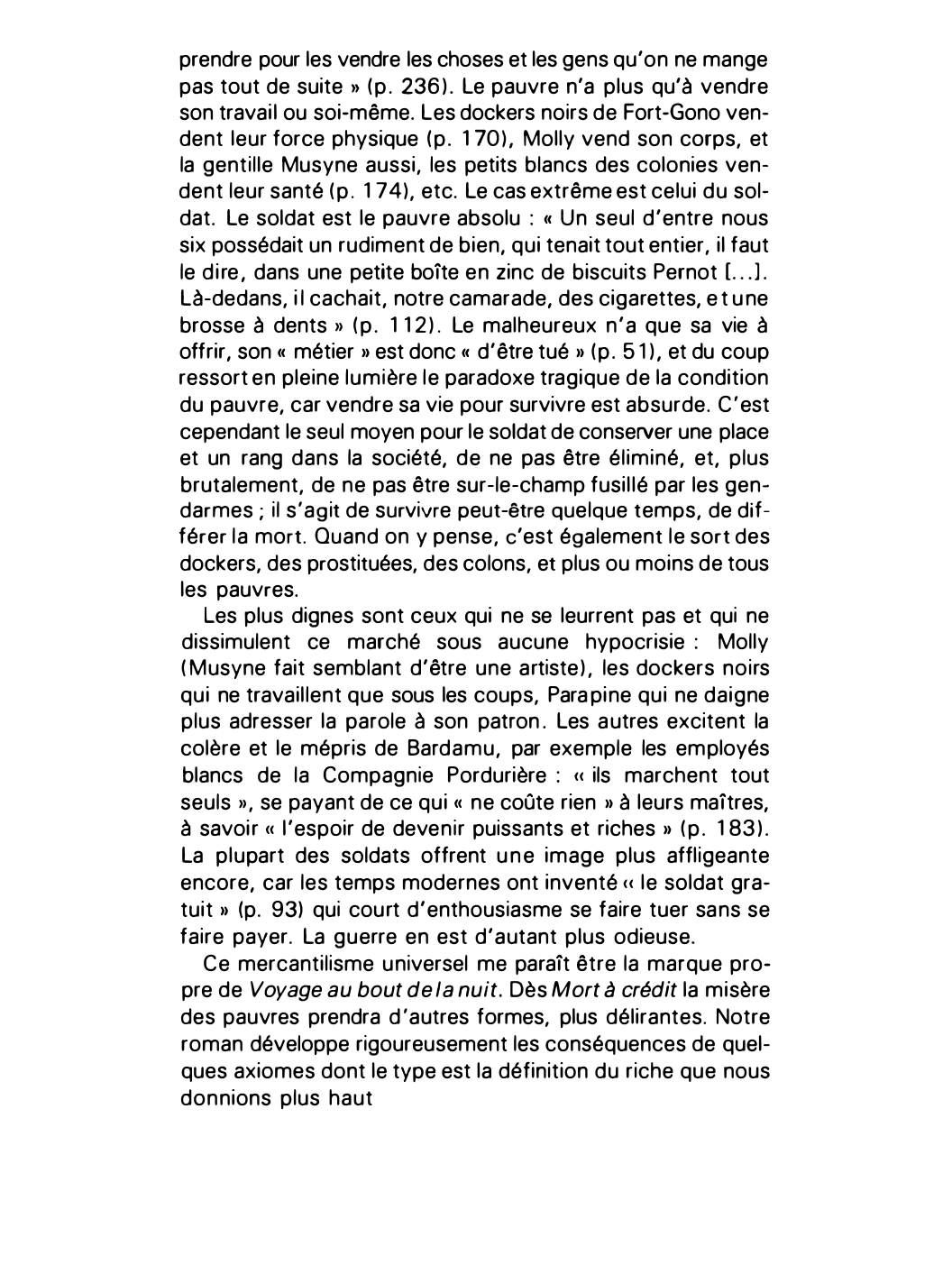La société dans Voyage au bout de la nuit (Céline)
Publié le 16/09/2018

Extrait du document
BARDAMU EN PRÉSENCE DES HOMMES
Au sein de la société dont nous avons tenté de dégager les fondements, que va-t-il se passer concrètement quand les êtres humains vont se trouver en présence les uns des autres ? Puisque Bardamu est le narrateur et qu'il est justement toujours présent aux événements racontés, la question revient à celle-ci : quels vont être les rapports de Bardamu avec les gens ? Il suit de ce que nous venons de dire que plusieurs cas sont possibles : ou bien Bardamu est en face d'un riche, d'un puissant, d'un privilégié ; ou bien il est en face d'un pauvre ; ou bien encore il est simultanément en rapport avec un riche et avec un autre pauvre.
Scènes à deux personnages
Nous rencontrons le premier cas dès le deuxième chapitre du roman. Bardamu et le colonel sont seuls sur la route, car les hommes de liaison qui surviennent pour un instant ne sont que des figurants indistincts. Force est de constater qu'il n'y a entre eux deux aucune communication. Bardamu se propose bien de discuter de la situation avec son chef : « Le tout c'est qu'on s'explique dans la vie. A deux on y arrive mieux que tout seul >> (p. 26). Il est trop évident que ce projet est sottement utopique. D'ailleurs le colonel est tué au moment où Bardamu va parler ; cesse à tout jamais l'espoir d'un dialogue. Toutefois, généralement, dans leur tête-à-tête avec Bardamu, les maîtres parlent ; le professeur Bestombes discourt (p. 121 à 124), et le directeur de la Compagnie Pordurière (p. 183 sqq.), et le D' Baryton (p. 526 à 554 passim). Mais il n'y a pas pour autant communication ni dialogue car Bar-damu ne croit pas ce qu'on lui débite et se contente de répondre par des formules lâchement approbatives. Parapine, plus sage et plus digne, s'enferme dans un mutisme absolu à Vigny-sur-Seine (p. 524). D'ailleurs il est permis de se demander si, dans les cas dont nous parlons, le supérieur est lui-même convaincu de ce qu'il dit : la fausse bonhomie est un moyen prudent d'inviter à la docilité un interlocuteur dont on n'est pas sûr. Mais lorsque le riche ou le privilégié se sent en nombre eten force, tout change ; c'est cequi se passe à bord de YAmiral Bragueton ; le pauvre devient une bête traquée
«
prendre
pour les vendre les choses et les gens qu'on ne mange
pas tout de suite " (p.
236).
Le pauvre n'a plus qu'à vendre
son trava il ou soi-même.
Les dockers noirs de Fort-Gono ven
dent leur force physique (p.
170).
Molly vend son corps, et
la gentille Musyne aussi, les petits blancs des colonies ven
dent leur santé (p.
174), etc.
Le cas extrême est celui du sol
dat.
Le soldat est le pauvre absolu : « Un seul d'entre nous
six possédait un rudiment de bien, qui tenait tout entier, il faut
le dir e, dans une petite boîte en zinc de biscuits Pernot [.
..
l.
Là-dedans, il cachait, notre camarade, des cigar ettes, et une
brosse à dents » (p.
112).
Le malheureux n'a que sa vie à
of frir, son« métier >> est donc « d'ê tre tué >> (p.
51) , et du coup
ressort en pleine lumière le paradoxe tragique de la condition
du pauvre, car vendre sa vie pour survivre est absurde.
C'est
cependant le seul moyen pour le soldat de conserver une place
et un rang dans la société, de ne pas être éliminé, et, plus
brutalement, de ne pas être sur-le-champ fusillé par les gen
darmes ; il s'agi t de survivre peut-être quelque temps, de dif
férer la mort.
Quand on y pense, c'est également le sort des
dockers, des prostituées, des colons, et plus ou moins de tous
les pauvres.
Les plus dignes sont ceux qui ne se leurrent pas et qui ne
dissimulent ce marché sous aucune hypocrisie : Molly
(M usyne fait semblant d'être une artiste ), les dockers noirs
qui ne trava illent que sous les coups, Para pi ne qui ne daign e
plus adresser la parole à son patron.
Les autres excitent la
colère et le mépris de Bardamu, par exemple les employés
blancs de la Compagnie Pordurière : à leurs maîtres,
à savo ir.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- La société vue par Céline dans le «Voyage au bout de la nuit»
- Louis-Ferdinand CÉLINE Voyage au bout de la nuit - Texte seul
- Voyage au bout de la nuit Louis-Ferdinand Céline (résumé de l'oeuvre & analyse détaillée)
- Voyage au bout de la nuit (résumé & analyse) de Céline
- VOYAGE AU BOUT DE LA NUIT Louis-Ferdinand Céline