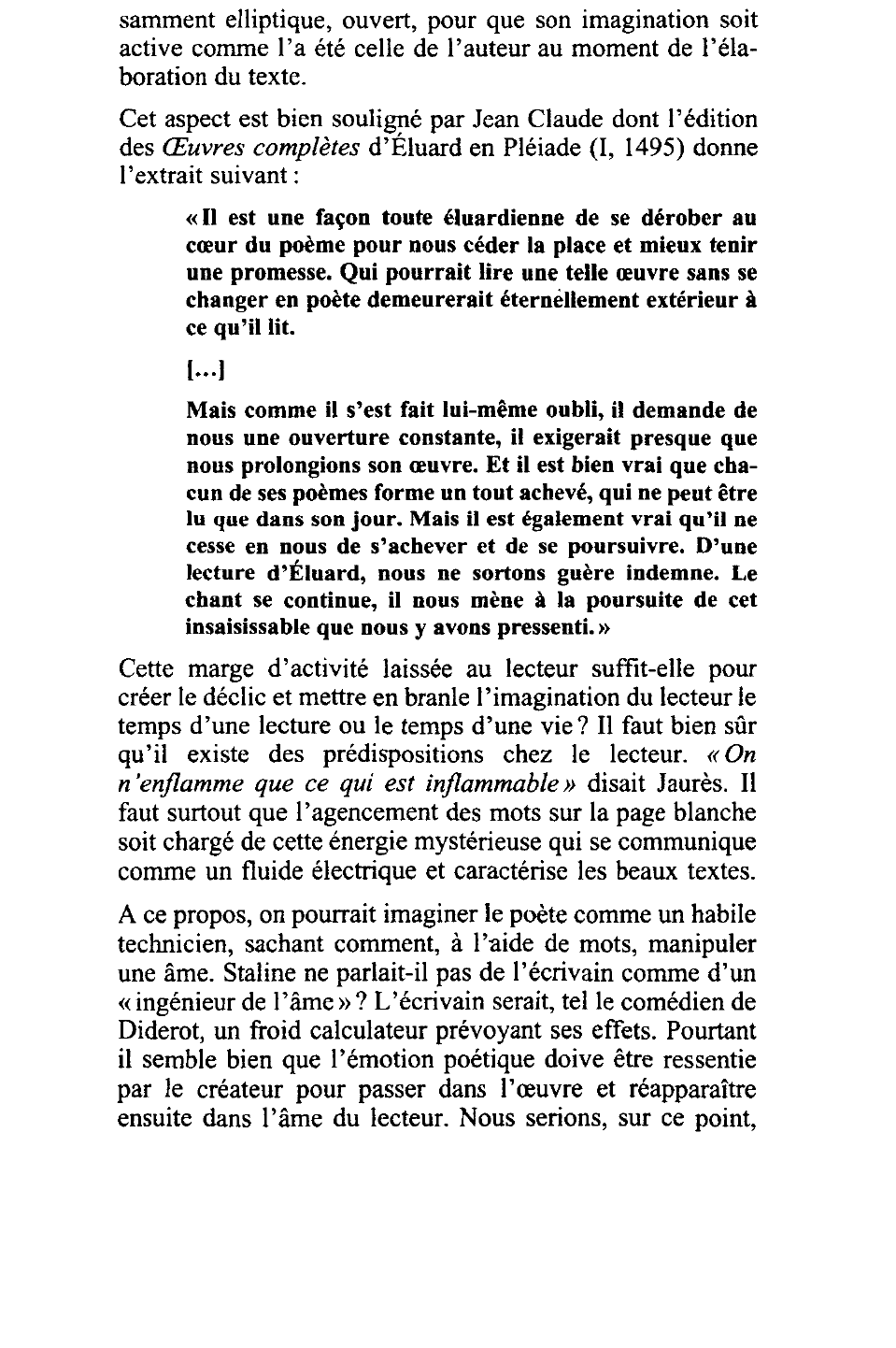LE POÈTE : CELUI QUI INSPIRE
Publié le 29/03/2015

Extrait du document
La grande poésie est donc bien celle qui inspire, mais on imagine mal que celui qui tient la plume ne soit pas lui-même inspiré. On ne peut mettre le feu chez autrui sans avoir le feu en soi. Pas de grande poésie sans « tremblement « chez le poète lui-même.
Il serait intéressant de rattacher cette réflexion de Paul Éluard à l'action inspiratrice qu'ont eue certains écrivains sur d'autres créateurs. Paul Claudel est comme foudroyé par la lecture de Rimbaud et les surréalistes sont eux-mêmes « illuminés « par les textes en prose de ce même poète. Rousseau est bouleversé par la lecture de Plutarque et les révolutionnaires français sont à leur tour bouleversés par la lecture de Rousseau. Mallarmé joue un rôle déterminant dans la vocation de Paul Valéry et Jules Renard disait d'ailleurs de lui, dans son Journal : «On ne peut fréquenter Mallarmé sans avoir du génie. « Les Nourritures terrestres (1897) de Gide auront aussi un rôle déclencheur sur toute une génération. La liste pourrait être allongée indéfiniment, au point que l'on se demande s'il est une vocation littéraire qui ne soit pas née de l'inspiration produite par un livre. Michel Tournier raconte que, pour lui, le choc eut lieu à neuf ans à la lecture d'un conte de Selma Lagerlôf intitulé Le Merveilleux Voyage de Nuls Holgersson. Et il ajoute, tout à fait dans la ligne de ce que dit Éluard :
«
§1 .
Le poète : celui qui inspire / 223
samment elliptique, ouvert, pour que son imagination soit
active comme
l'a été celle de l'auteur au moment de l'éla
boration du texte.
Cet aspect est bien souligné par Jean Claude dont l'édition
des
Œuvres complètes d'Éluard en Pléiade (1, 1495) donne
l'extrait suivant:
«Il est une façon toute éluardienne de se dérober au
cœur du poème
pour nous céder la place et mieux tenir
une promesse.
Qui
pourrait lire une telle œuvre sans se
changer en poète demeurerait éternéllement extérieur à
ce qu'il lit.
[ ••.
1
Mais comme il s'est fait lui-même oubli, il demande de
nous une ouverture constante,
il exigerait presque que
nous prolongions son œuvre.
Et il est bien vrai que cha
cun de ses poèmes forme un tout achevé, qui ne peut être
lu que dans son
jour.
Mais il est également vrai qu'il ne
cesse en nous de s'achever et de se poursuivre.
D'une
lecture
d'Éluard, nous ne sortons guère indemne.
Le
chant se continue, il nous mène à la poursuite de cet
insaisissable que nous
y avons pressenti.»
Cette marge d'activité laissée au lecteur suffit-elle pour
créer
le déclic et mettre en branle l'imagination du lecteur le
temps d'une lecture ou le temps d'une vie? Il faut bien sûr
qu'il existe des prédispositions chez
le lecteur.
«On
n'enflamme que ce qui est inflammable» disait Jaurès.
Il
faut surtout que l'agencement des mots sur la page blanche
soit chargé de cette énergie mystérieuse qui se communique
comme un fluide électrique et caractérise les beaux textes.
A ce propos, on pourrait imaginer
le poète comme un habile
technicien, sachant comment,
à l'aide de mots, manipuler
une âme.
Staline
ne parlait-il pas de !'écrivain comme d'un
«ingénieur de l'âme»? L' écrivain serait, tel le comédien de
Diderot, un froid calculateur prévoyant ses effets.
Pourtant
il semble bien que l'émotion poétique doive être ressentie
par
le créateur pour passer dans l' œuvre et réapparaître
ensuite dans l'âme du lecteur.
Nous serions, sur ce point,.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- LE POÈTE : CELUI QUI INSPIRE: Le poète est celui qui inspire bien plus que celui qui est inspiré. Paul Éluard
- Pierre de Ronsard (1524-1585) "Le prince des poètes, le poète des princes"
- Sujet : Comparez les approches intégration des femmes au développement (IFD) et Genre et Développement (GED) et dites sur quoi se fondent leurs différences au plan idéologique et ce que vous inspire vos expériences professionnelles ou de terrain.
- dissertation Baudelaire: comment le poète transforme-t-il le laid en beau ?
- Explication de texte autour d'un extrait de l'ouvrage Le poète et l'activité de la fantaisie, de Sigmund Freud