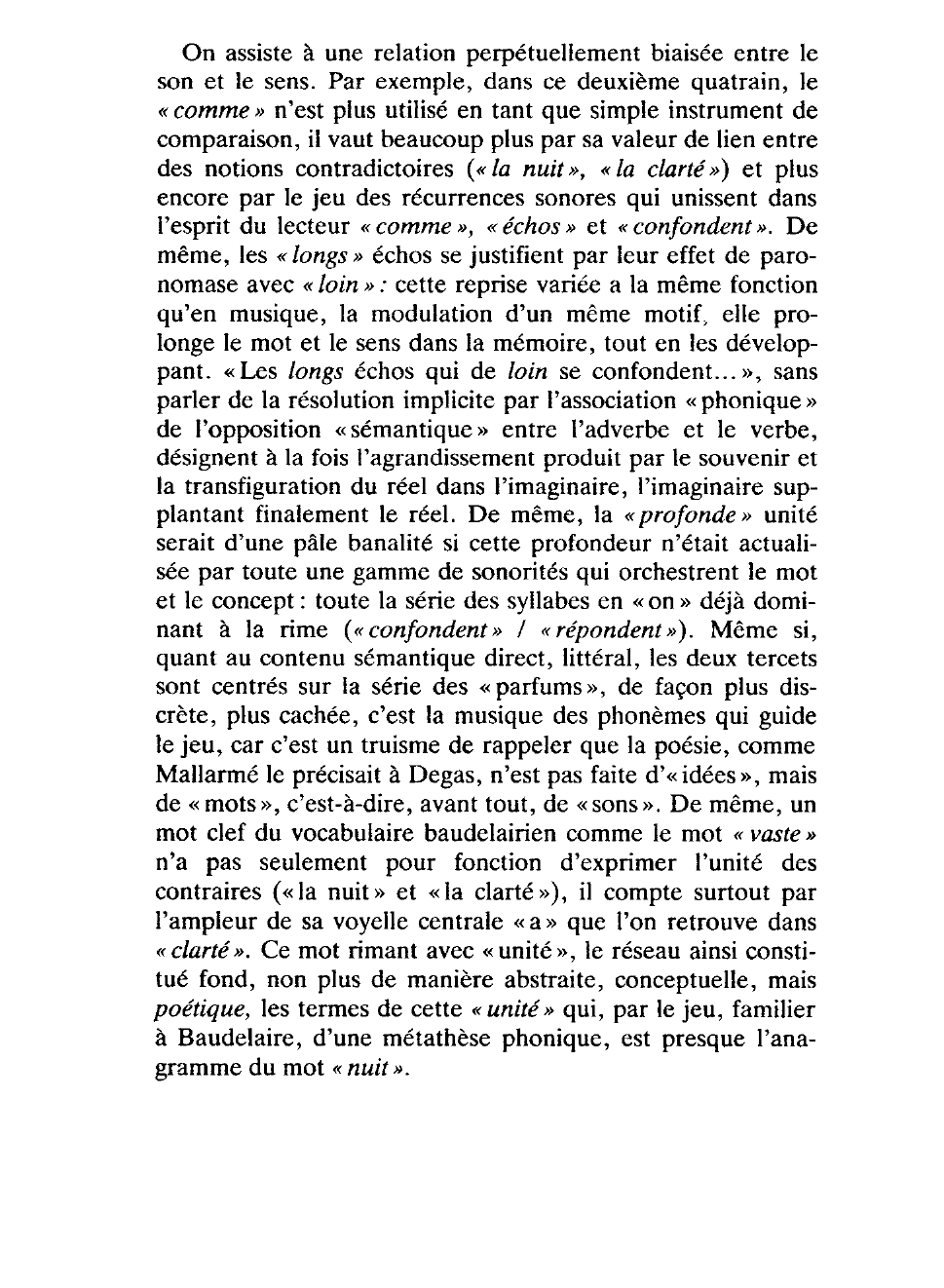Le son et le sens dans les Fleurs du mal de Baudelaire
Publié le 07/09/2013

Extrait du document

Cependant, l'important dans un poème n'est pas dans les
idées, forcément générales, qu'il est supposé illustrer, mais
dans la forme organique qui lui confère sa puissance de
suggestion, de fascination, son «charme« au sens fort, au
sens magique. L'intérêt des «Correspondances« comme des
autres grands textes des Fleurs du Mal, est donc de présenter
un «art«, un agencement de mots voulu par Baudelaire
comme autant d'associations condensées, et pourtant ouvertes:
la dissémination du sens constitue le support d'une
combinaison alchimique de «parfums, de couleurs et de
sons«.

«
On assiste à une relation perpétuellement biaisée entre le
son et
le sens.
Par exemple, dans ce deuxième quatrain, le
«comme» n'est plus utilisé en tant que simple instrument de
comparaison,
il vaut beaucoup plus par sa valeur de lien entre
des notions contradictoires
(«la nuit», «la clarté») et plus
encore
par le jeu des récurrences sonores qui unissent dans
l'esprit
du lecteur «comme», «échos» et «confondent».
De
même, les «longs» échos se justifient par leur effet de paro
nomase avec
«loin»: cette reprise variée a la même fonction
qu'en musique, la modulation d'un même
motif, elle pro
longe le mot et
le sens dans la mémoire, tout en les dévelop
pant.
«Les longs échos qui de loin se confondent...», sans
parler de la résolution implicite
par l'association «phonique»
de l'opposition «sémantique» entre l'adverbe et le verbe,
désignent à la fois l'agrandissement produit par
le souvenir et
la transfiguration du réel dans l'imaginaire, l'imaginaire sup
plantant finalement le réel.
De même, la «profonde» unité
serait d'une pâle banalité
si cette profondeur n'était actuali
sée par toute une gamme de sonorités qui orchestrent
le mot
et le concept : toute la série des syllabes en «on » déjà domi
nant à la rime
(«confondent» I «répondent»).
Même si,
quant au contenu sémantique direct, littéral, les deux tercets
sont centrés sur la série des
«parfums», de façon plus dis
crète, plus cachée, c'est la musique des phonèmes qui guide
le jeu,
car c'est un truisme de rappeler que la poésie, comme
Mallarmé le précisait à Degas, n'est pas faite d'
«idées», mais
de
«mots», c'est-à-dire, avant tout, de «sons».
De même, un
mot clef
du vocabulaire baudelairien comme le mot « vaste»
n'a pas seulement pour fonction d'exprimer l'unité des
contraires
(«la nuit» et «la clarté»), il compte surtout par
l'ampleur de sa voyelle centrale
«a» que l'on retrouve dans
«clarté».
Ce mot rimant avec «unité», le réseau ainsi consti
tué fond, non plus de manière abstraite, conceptuelle, mais
poétique, les termes de cette «unité» qui, par le jeu, familier
à Baudelaire, d'une métathèse phonique, est presque l'ana
gramme
du mot «nuit»..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Texte d’étude : Charles Baudelaire, « L’Ennemi », Les Fleurs du Mal (1857): Le temps mange-t-il la vie ? (HLP Philo)
- Fiche de révision Les Fleurs du mal, Charles Baudelaire (1857)
- Baudelaire, dans l’appendice aux Fleurs du mal, écrit : « Tu m’as donné ta boue et j’en ai fait de l’or. » En quoi ce vers éclaire-t-il votre lecture du recueil de Baudelaire ?
- Etude linéaire - Spleen et Idéal, Les Fleurs du mal, Charles Baudelaire
- Fleurs du mal: Baudelaire doit plonger dans le mal et en extraire la beauté