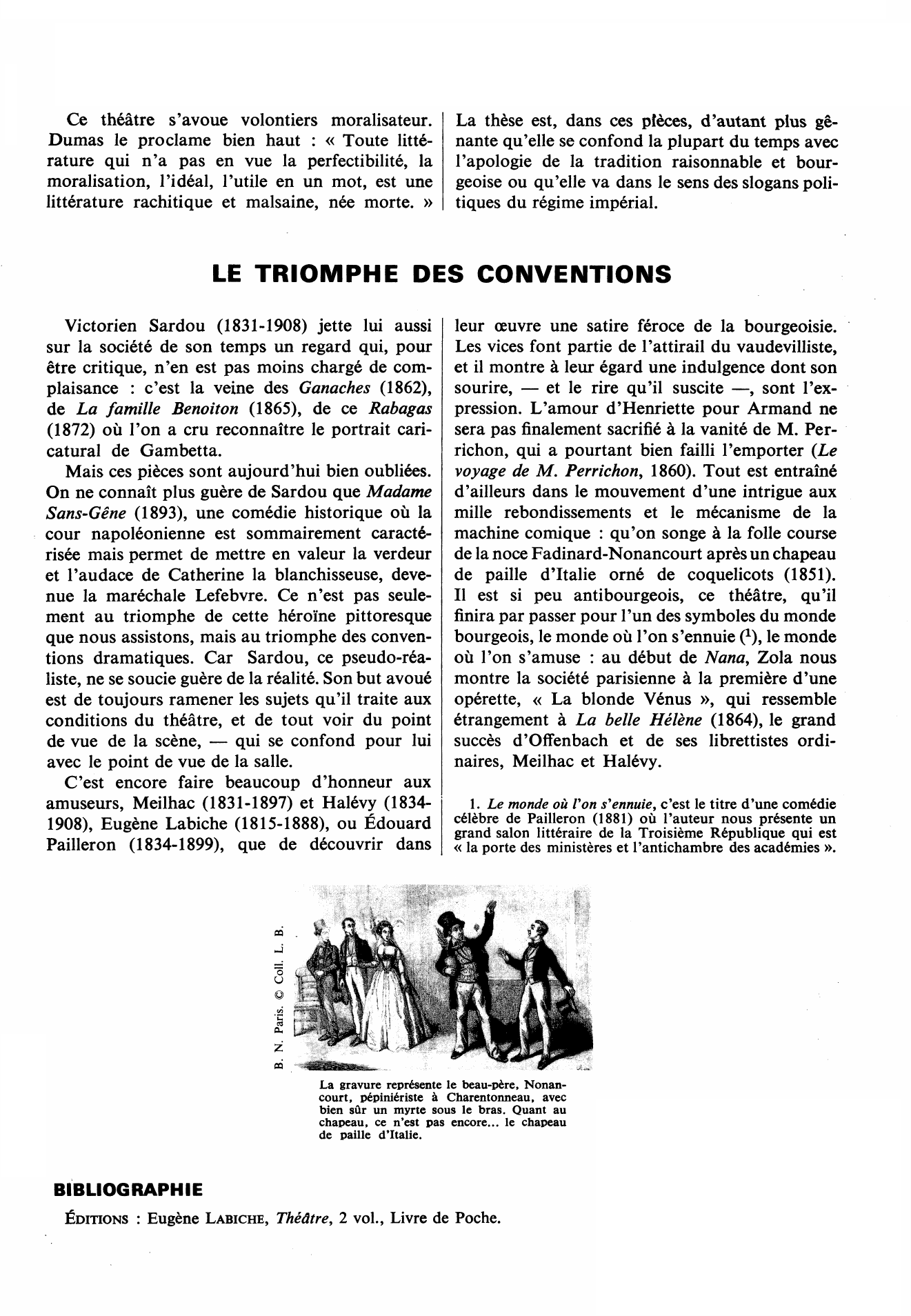LE THÉÂTRE ET LE RÉALISME
Publié le 22/02/2012
Extrait du document
Menant contre le romantisme la campagne de l'« école du bon sens«, Émile Augier (1820-1889) ne s'est pas contenté de présenter les événements simples de la vie bourgeoise. Sans aller jusqu'à la satire, car il entend rester dans les limites permises, il fait mainte allusion à des questions d'actualité : la montée vers 1860 des nouveaux bourgeois gentilshommes (Le gendre de M. Poirier, 1854), la vénalité de la presse (Les effrontés, 1861), l'opposition du « parti de l'ordre « et « du parti de la révolution « (Le fils de Giboyer, 1862).
«
-
Ce théâtre s'avoue volontiers moralisateur.
Dumas le proclame bien haut : « Toute litté
rature qui
n'a pas en vue la perfectibilité, la
moralisation, l'idéal, l'utile en un mot, est une
littérature rachitique et malsaine, née morte.
»
La thèse est, dans ces pfèces, d'autant plus gê
nante qu'elle se confond
la plupart du temps avec
l'apologie de la tradition raisonnable et bour
geoise ou qu'elle va dans le sens des slogans poli
tiques du régime impérial.
LE TRIOMPHE DES CONVENTIONS
Victorien Sardou (1831-1908) jette lui aussi
sur
la société de son temps un regard qui, pour
être critique, n'en est pas moins chargé de com
plaisance :
c'est la veine des Ganaches (1862),
de
La famille Benoiton (1865), de ce Rabagas
(1872)
où l'on a cru reconnaître le portrait cari
catural de Gambetta.
Mais ces pièces
sont aujourd'hui bien oubliées.
On ne connaît plus guère de Sardou que Madame
Sans-Gêne (1893), une comédie historique
où la
cour napoléonienne est sommairement caracté
risée mais permet de mettre en valeur
la verdeur
et l'audace de Catherine la blanchisseuse, deve
nue la maréchale Lefebvre.
Ce n'est pas seule
ment
au triomphe de cette héroïne pittoresque
que nous assistons, mais
au triomphe des conven
tions dramatiques.
Car Sardou, ce pseudo-réa
liste, ne se soucie guère de la réalité.
Son but avoué
est de toujours ramener les sujets qu'il traite aux
conditions du théâtre,
et de tout voir du point
de vue de
la scène, -qui se confond pour lui
avec le point de vue de la salle.
C'est encore faire beaucoup d'honneur aux
amuseurs, Meilhac (1831-1897) et Halévy (1834-
1908), Eugène Labiche (1815-1888),
ou Édouard
Pailleron (1834-1899), que de découvrir dans leur
œuvre une satire féroce de
la bourgeoisie.
Les vices font partie de l'attirail
du vaudevilliste,
et
il montre à leur égard une indulgence dont son
sourire, -et le rire
qu'il suscite -, sont l'ex
pression.
L'amour d'Henriette pour Armand ne
sera pas finalement sacrifié à
la vanité de M.
Per
richon, qui a pourtant bien failli l'emporter (Le
voyage
de M.
Perrichon, 1860).
Tout est entraîné
d'ailleurs dans le mouvement
d'une intrigue aux
mille rebondissements et le mécanisme de la
machine comique :
qu'on songe à la folle course
de la noce Fadinard-Nonancourt après
un chapeau
de paille d'Italie orné de coquelicots (1851).
Il est si peu antibourgeois, ce théâtre, qu'il
finira par passer
pour 1 'un des symboles du monde
bourgeois, le monde
où l'on s'ennuie ( 1), le monde
où l'on s'amuse : au début de Nana, Zola nous
montre la société parisienne à la première
d'une
opérette, « La blonde Vénus », qui ressemble
étrangement à
La belle Hélène (1864), le grand
succès
d'Offenbach et de ses librettistes ordi
naires, Meilhac et Halévy.
1.
Le monde où l'on s'ennuie, c'est le titre d'une comédie
célèbre de Pailleron (1881) où l'auteur nous présente un grand salon littéraire de la Troisième République qui est «la porte des ministères et l'antichambre des académies».
La gravure représente le beau-pére, Nonan court, pépiniériste à Charentonneau, avec
bien sür un myrte sous le bras.
Quant au chapeau, ce n'est pas encore ...
le chapeau de paille d'Italie.
BIBLIOGRAPHIE
ÉDITIONS : Eugène LABICHE, Thétltre, 2 vol., Livre de Poche..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Le Réalisme au théâtre
- Le Théâtre Classique et la règle de trois unités.
- Critique d'Artemisia Gentileschi Théâtre
- Dm de spé théâtre: Tartuffe de Molière
- Le théâtre n'est-il l'art que de la parole?