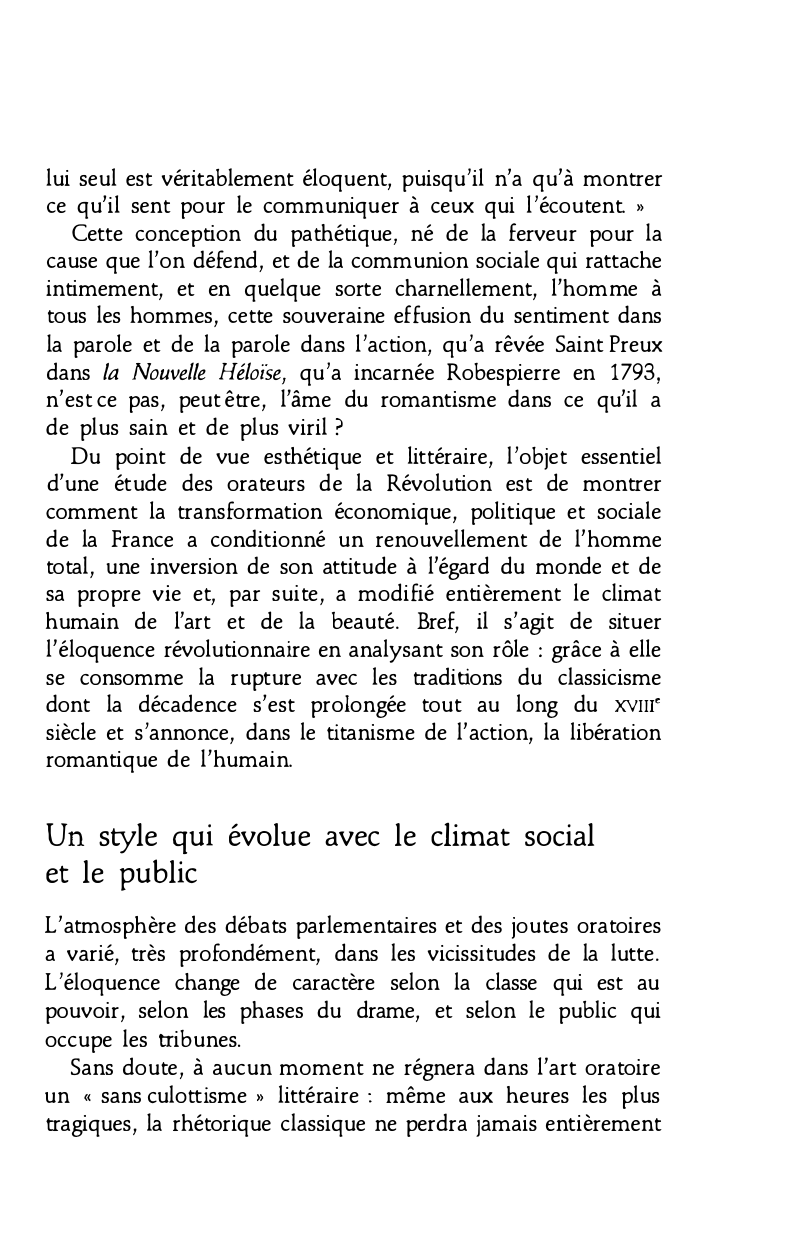L'éloquence révolutionnaire : triomphe et fin du classicisme
Publié le 10/09/2018

Extrait du document
lui seul est véritablement éloquent, puisqu'il n’a qu'à montrer ce qu'il sent pour le communiquer à ceux qui l'écoutent »
Cette conception du pathétique, né de la ferveur pour la cause que l’on défend, et de la communion sociale qui rattache intimement, et en quelque sorte charnellement, l’homme à tous les hommes, cette souveraine effusion du sentiment dans la parole et de la parole dans l'action, qu'a rêvée Saint Preux dans la Nouvelle Héloïse, qu'a incarnée Robespierre en 1793, n’est ce pas, peut être, l’âme du romantisme dans ce qu'il a de plus sain et de plus viril ?
Du point de vue esthétique et littéraire, l'objet essentiel d’une étude des orateurs de la Révolution est de montrer comment la transformation économique, politique et sociale de la France a conditionné un renouvellement de l'homme total, une inversion de son attitude à l'égard du monde et de sa propre vie et, par suite, a modifié entièrement le climat humain de l’art et de la beauté. Bref, il s’agit de situer l'éloquence révolutionnaire en analysant son rôle : grâce à elle se consomme la rupture avec les traditions du classicisme dont la décadence s’est prolongée tout au long du XVIII' siècle et s'annonce, dans le titanisme de l'action, la libération romantique de l’humain.
Un style qui évolue avec le climat social et le public
L’atmosphère des débats parlementaires et des joutes oratoires a varié, très profondément, dans les vicissitudes de la lutte. L'éloquence change de caractère selon la classe qui est au pouvoir, selon les phases du drame, et selon le public qui occupe les tribunes.
Sans doute, à aucun moment ne régnera dans l’art oratoire un « sans culottisme » littéraire : même aux heures les plus tragiques, la rhétorique classique ne perdra jamais entièrement
« L’éloquence a grandi », remarquait déjà l’historien et orateur latin Tacite (v. 55120 ap. J...C.), dans tous les orages qui déchiraient la république. Et, en vérité, l’éloquence politique française est née avec le bouleversement le plus profond qu’ait connu notre pays au cours de son histoire. L'extrême tension des sentiments suscités par la Révolution a renouvelé non seulement l’art oratoire, mais aussi tous les genres littéraires, en transformant radicalement les rapports entre la vie des hommes et leurs créations esthétiques.
Un changement profond de la condition humaine, en ces quelques années, est à l'origine d'une mutation artistique.
Une préfiguration du romantisme
On peut trouver chez Rousseau une anticipation de cette métamorphose : au livre IV de l’£mile, il dessine à grands traits son disciple s'exerçant à la parole, et nous pouvons voir en lui le modèle de l'homme nouveau et de l'orateur révolutionnaire au delà de toute rhétorique formaliste, de tout classicisme décadent : « Le noble sentiment qui l'inspire lui donne de la force et de l'élévation : pénétré du tendre amour de l'humanité, il transmet en parlant les mouvements de son âme ; sa généreuse franchise a je ne sais quoi de plus enchanteur que l'artificieuse éloquence des autres ; ou plutôt
«
lui
seul est véritablement éloquent, puisqu'il n'a qu'à montrer
ce qu'il sent pour le communiqu er à ceux qui l'écoutent.
»
Cette conception du pathétique, né de la ferveu r pour la
cause que l'on défend, et de la communion sociale qui rattache
intimement, et en quelque sorte charn ellement, l'homme à
tous les hommes, cette souveraine effusion du sentiment dans
la parole et de la parole dans l'action, qu'a rêvée Saint Preux
dans la Nouvelle Héloïse, qu'a incarnée Robespierre en 1793,
n' est ce pas, peut être, l'âme du romantisme dans ce qu'il a
de plus sain et de plus viril ?
Du point de vue esthétique et littéraire, l'objet essentiel
d'une étude des orateurs de la Révolution est de montrer
comment la transfo rmation économique, politique et sociale
de la France a conditionné un renouvellement de l'homme
total, une inversion de son attitu de à l'égard du monde et de
sa propre vie et, par suite, a modifié entièrement le climat
humain de l'art et de la beaut é.
Bref, il s'agit de situer
l'él oquence révolutionnaire en analysant son rôle : grâce à elle
se consomme la rupture avec les traditions du classicisme
dont la décadence s'est prolongée tout au long du XVIII'
siècle et s'annonce, dans le titanisme de l'action, la libération
roma ntique de l'humain.
Un style qui évolue avec le climat social
et le public
L'a tmosphère des débats parlementaires et des joutes oratoires
a varié, très profondément, dans les vicis situdes de la lutte.
L'éloquence change de caractère selon la classe qui est au
pouvoir, selon les phases du drame, et selon le public qui
occupe les tribunes.
Sans doute, à aucun moment ne régnera dans l'art oratoire
un « sans culottisme » littér aire : même aux heures les plus
tr agiques, la rhétorique classique ne perdra jamais entièrement.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- FIN DES TERROIRS - TRIOMPHE DES VILLES
- Le néo-classicisme: Fin du XVIIIe siècle Début du XIXe siècle.
- L'ÉLOQUENCE RÉVOLUTIONNAIRE
- «Dans la mémoire des Français, le XVIIe siècle joue un peu le rôle d'une référence par rapport à laquelle on juge tout le reste, comme, avant le classicisme, on jugeait tout par rapport à l'antiquité. Cela tient peut-être au fait que ; par rapport aux siècles qui l'on précédé, il inaugure les temps modernes. Mais on peut croire aussi qu'en dépit des luttes qui ont marqué son histoire il évoque la pensée d'une certaine cohésion : l'approche, par différentes avenues, d'un commun idéal de
- LA FIN DU CLASSICISME