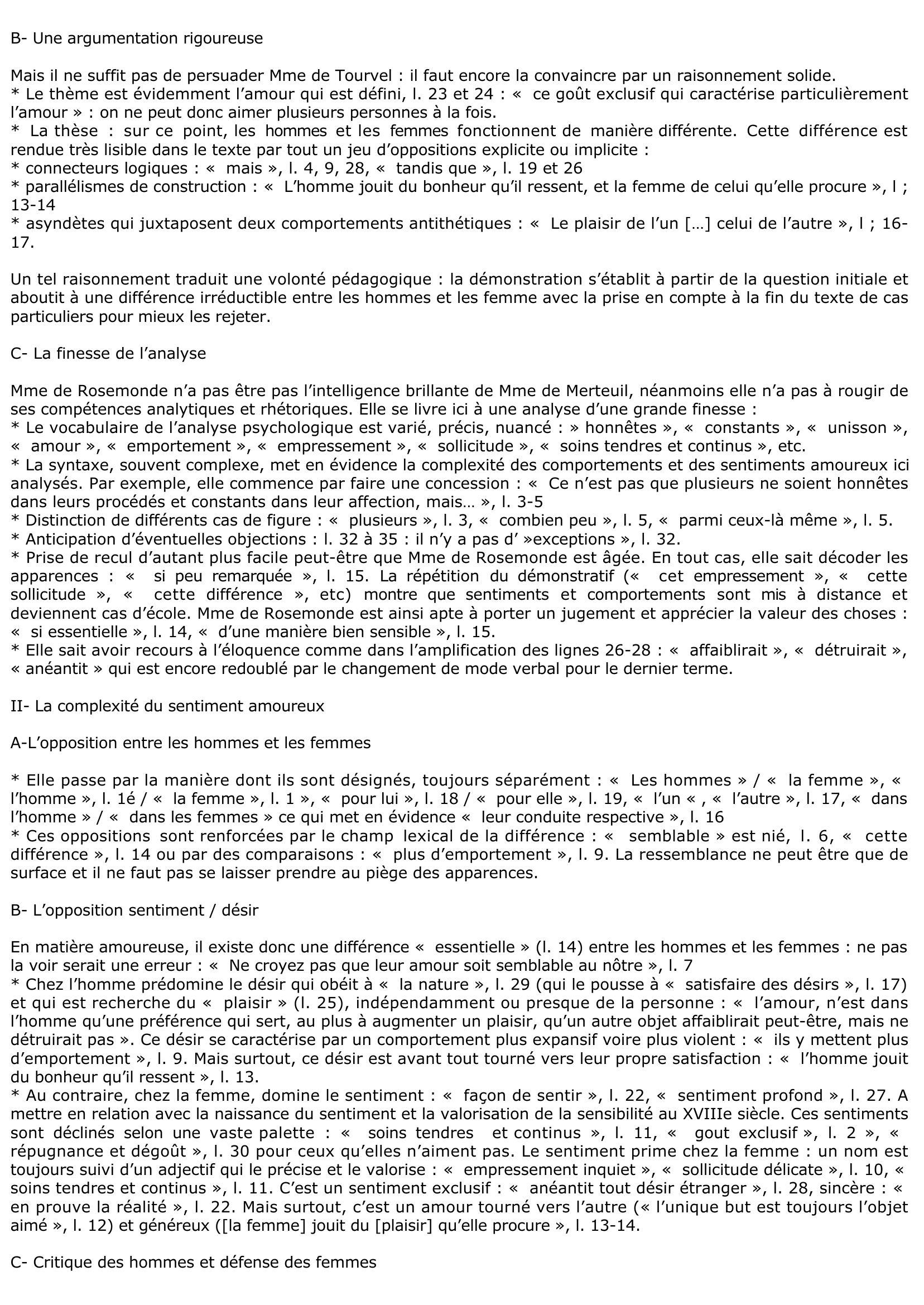Les Liaisons dangereuses : lettre CXXX
Publié le 12/09/2011

Extrait du document
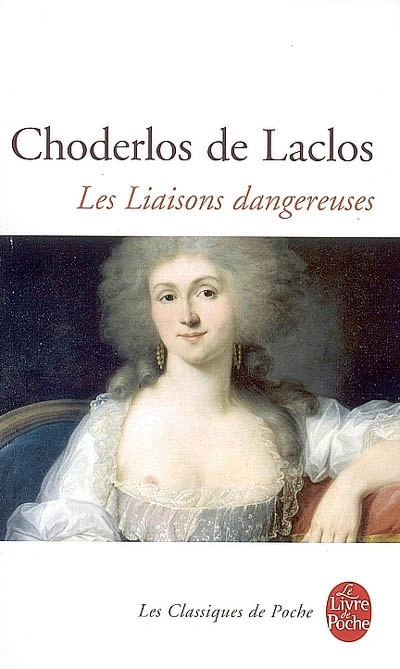
Mme de Rosemonde n’a pas être pas l’intelligence brillante de Mme de Merteuil, néanmoins elle n’a pas à rougir de ses compétences analytiques et rhétoriques. Elle se livre ici à une analyse d’une grande finesse : * Le vocabulaire de l’analyse psychologique est varié, précis, nuancé : « honnêtes «, « constants «, « unisson «, « amour «, « emportement «, « empressement «, « sollicitude «, « soins tendres et continus «, etc.
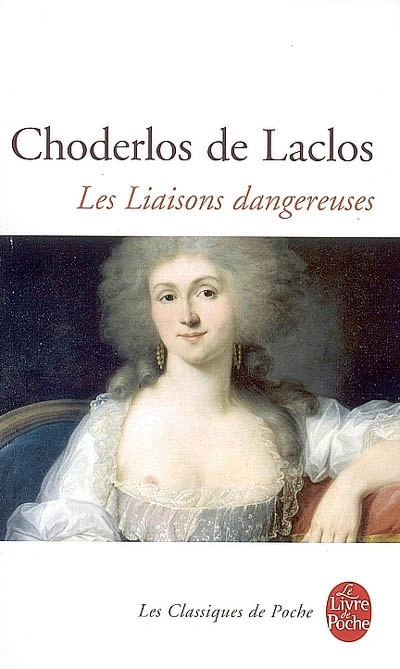
«
B- Une argumentation rigoureuse
Mais il ne suffit pas de persuader Mme de Tourvel : il faut encore la convaincre par un raisonnement solide.* Le thème est évidemment l’amour qui est défini, l.
23 et 24 : « ce goût exclusif qui caractérise particulièrementl’amour » : on ne peut donc aimer plusieurs personnes à la fois.* La thèse : sur ce point, les hommes et les femmes fonctionnent de manière différente.
Cette différence estrendue très lisible dans le texte par tout un jeu d’oppositions explicite ou implicite :* connecteurs logiques : « mais », l.
4, 9, 28, « tandis que », l.
19 et 26* parallélismes de construction : « L’homme jouit du bonheur qu’il ressent, et la femme de celui qu’elle procure », l ;13-14* asyndètes qui juxtaposent deux comportements antithétiques : « Le plaisir de l’un […] celui de l’autre », l ; 16-17.
Un tel raisonnement traduit une volonté pédagogique : la démonstration s’établit à partir de la question initiale etaboutit à une différence irréductible entre les hommes et les femme avec la prise en compte à la fin du texte de casparticuliers pour mieux les rejeter.
C- La finesse de l’analyse
Mme de Rosemonde n’a pas être pas l’intelligence brillante de Mme de Merteuil, néanmoins elle n’a pas à rougir deses compétences analytiques et rhétoriques.
Elle se livre ici à une analyse d’une grande finesse :* Le vocabulaire de l’analyse psychologique est varié, précis, nuancé : » honnêtes », « constants », « unisson »,« amour », « emportement », « empressement », « sollicitude », « soins tendres et continus », etc.* La syntaxe, souvent complexe, met en évidence la complexité des comportements et des sentiments amoureux icianalysés.
Par exemple, elle commence par faire une concession : « Ce n’est pas que plusieurs ne soient honnêtesdans leurs procédés et constants dans leur affection, mais… », l.
3-5* Distinction de différents cas de figure : « plusieurs », l.
3, « combien peu », l.
5, « parmi ceux-là même », l.
5.* Anticipation d’éventuelles objections : l.
32 à 35 : il n’y a pas d’ »exceptions », l.
32.* Prise de recul d’autant plus facile peut-être que Mme de Rosemonde est âgée.
En tout cas, elle sait décoder lesapparences : « si peu remarquée », l.
15.
La répétition du démonstratif (« cet empressement », « cettesollicitude », « cette différence », etc) montre que sentiments et comportements sont mis à distance etdeviennent cas d’école.
Mme de Rosemonde est ainsi apte à porter un jugement et apprécier la valeur des choses :« si essentielle », l.
14, « d’une manière bien sensible », l.
15.* Elle sait avoir recours à l’éloquence comme dans l’amplification des lignes 26-28 : « affaiblirait », « détruirait »,« anéantit » qui est encore redoublé par le changement de mode verbal pour le dernier terme.
II- La complexité du sentiment amoureux
A-L’opposition entre les hommes et les femmes
* Elle passe par la manière dont ils sont désignés, toujours séparément : « Les hommes » / « la femme », « l’homme », l.
1é / « la femme », l.
1 », « pour lui », l.
18 / « pour elle », l.
19, « l’un « , « l’autre », l.
17, « dansl’homme » / « dans les femmes » ce qui met en évidence « leur conduite respective », l.
16* Ces oppositions sont renforcées par le champ lexical de la différence : « semblable » est nié, l.
6, « cettedifférence », l.
14 ou par des comparaisons : « plus d’emportement », l.
9.
La ressemblance ne peut être que desurface et il ne faut pas se laisser prendre au piège des apparences.
B- L’opposition sentiment / désir
En matière amoureuse, il existe donc une différence « essentielle » (l.
14) entre les hommes et les femmes : ne pasla voir serait une erreur : « Ne croyez pas que leur amour soit semblable au nôtre », l.
7* Chez l’homme prédomine le désir qui obéit à « la nature », l.
29 (qui le pousse à « satisfaire des désirs », l.
17)et qui est recherche du « plaisir » (l.
25), indépendamment ou presque de la personne : « l’amour, n’est dansl’homme qu’une préférence qui sert, au plus à augmenter un plaisir, qu’un autre objet affaiblirait peut-être, mais nedétruirait pas ».
Ce désir se caractérise par un comportement plus expansif voire plus violent : « ils y mettent plusd’emportement », l.
9.
Mais surtout, ce désir est avant tout tourné vers leur propre satisfaction : « l’homme jouitdu bonheur qu’il ressent », l.
13.* Au contraire, chez la femme, domine le sentiment : « façon de sentir », l.
22, « sentiment profond », l.
27.
Amettre en relation avec la naissance du sentiment et la valorisation de la sensibilité au XVIIIe siècle.
Ces sentimentssont déclinés selon une vaste palette : « soins tendres et continus », l.
11, « gout exclusif », l.
2 », « répugnance et dégoût », l.
30 pour ceux qu’elles n’aiment pas.
Le sentiment prime chez la femme : un nom esttoujours suivi d’un adjectif qui le précise et le valorise : « empressement inquiet », « sollicitude délicate », l.
10, « soins tendres et continus », l.
11.
C’est un sentiment exclusif : « anéantit tout désir étranger », l.
28, sincère : « en prouve la réalité », l.
22.
Mais surtout, c’est un amour tourné vers l’autre (« l’unique but est toujours l’objetaimé », l.
12) et généreux ([la femme] jouit du [plaisir] qu’elle procure », l.
13-14.
C- Critique des hommes et défense des femmes.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Texte 4 : Les Liaisons dangereuses (1782), Choderlos de Laclos (1741- 1803) - Lettre 81
- explication linéaire lettre 81 dans les liaisons dangereuses de CHODERLOS DE LECLOS
- Lettre 81 - Les Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos,1782
- Choderlos de Laclos, Les liaisons dangereuses, Lettre 175
- Lettre 141, Les Liaisons Dangereuses, Laclos, ANALYSE