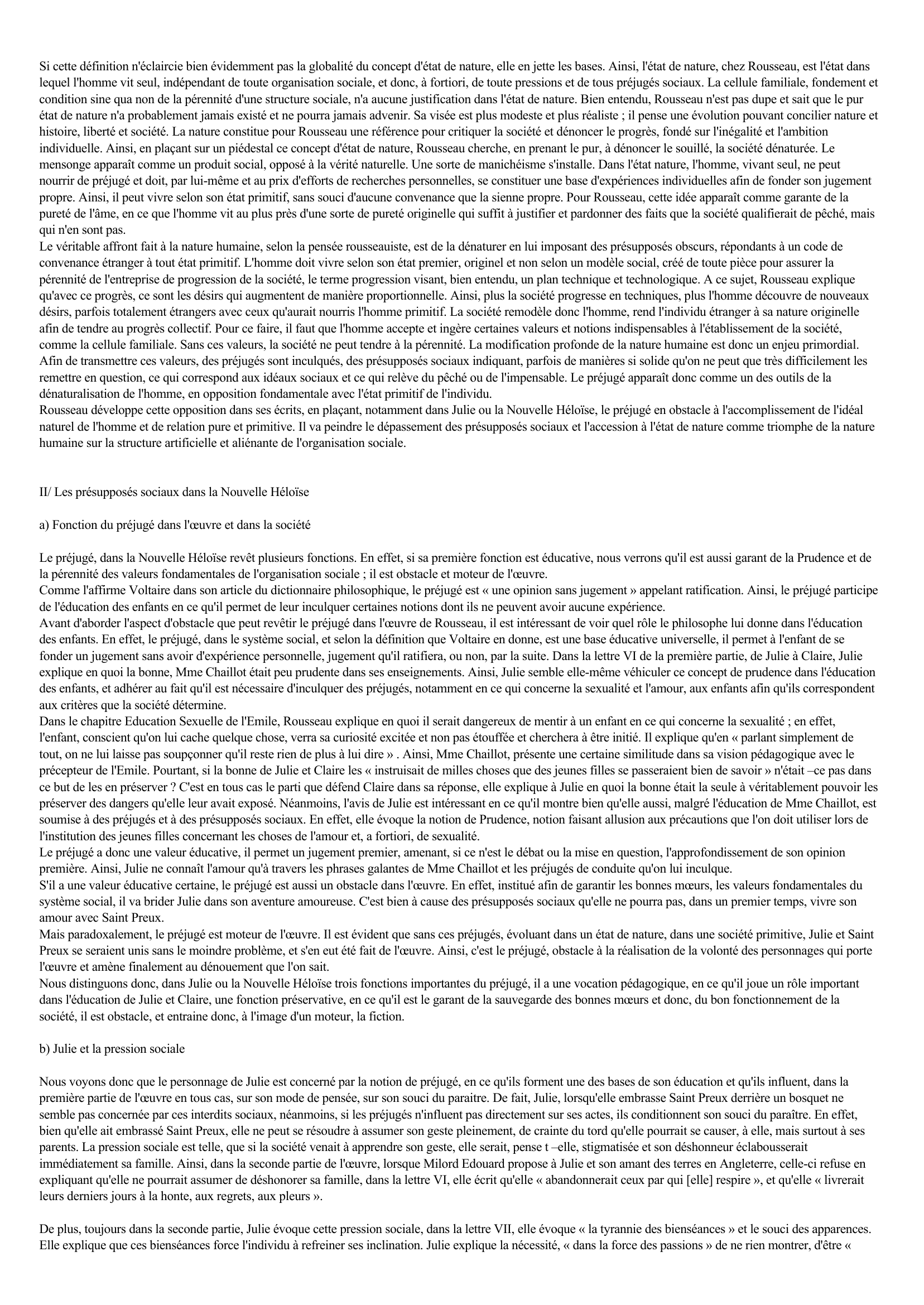Les préjugés dans La Nouvelle Héloïse de Rousseau
Publié le 17/08/2012

Extrait du document

Les personnages vont donc êtres réunis à Clarens et former une société où, selon Starobinski, « aucune volonté particulière ne peut s’isoler de la volonté générale «. Bien que différant par certains aspect de la société que Rousseau décrit dans du Contrat Social, ces deux modèles partagent quelques aspects comme la pureté des âmes et la confiance mutuelle. Starobinski, à ce propos, dit que les personnages réunis à Clarens forment un « corps social «. En effet, la transparence des âmes est telle que les personnages vivent comme un seul être, avec la possibilité, néanmoins, d’exister par eux même, de manière personnelle, grâce à la reconnaissance des autres. A Clarens, la société est, si l’on peut dire, désinstitutionnalisée, libérée des conventions et des préjugés. On vit grâce et par la nature. Ainsi, dans sa lettre à Milord Edouard , Saint Preux détaille l’économie de la maison. Il explique qu’à la richesse et au luxe on substitue la commodité et l’égalité, à l’excentricité, à l’image du marronnier d’Inde, jugé « inutile « par Saint Preux, de jeunes mûriers noirs, plus pratiques. Saint Preux le dit lui-même ; « partout on a substitué l’utile à l’agréable, et l’agréable y a presque toujours gagné «. Saint Preux explique ensuite, et cela nous rappelle sa description de l’organisation sociale Valaise, la manière dont le domaine est exploité et comment l’on y vit. Ainsi, il explique que la culture est poussée au maximum, « non pas pour faire un plus grand gain, mais pour nourrir plus d’hommes «. Il poursuit en disant que la culture des terres permet aux Wolmar de pouvoir faire subsister un grand nombre de personnes, celles qui travaillent à la journée dans leurs champs. De plus, il dit que Julie aime à donner son affection aux ouvriers pour gagner la leur. On voit donc bien que ce modèle de société rejoint celui que Rousseau expose dans certaines de ses autres œuvres comme le Contrat Social ou le Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité entre les hommes. Clarens est la réalisation d’un rêve que la société rend impossible mais que l’état de nature permet sans que subsiste le moindre mal. Cette organisation sociale, par sa pureté et sa vérité, entre en opposition radicale avec la société décriée par Rousseau qui produit le mensonge et les préjugés.

«
Si cette définition n'éclaircie bien évidemment pas la globalité du concept d'état de nature, elle en jette les bases.
Ainsi, l'état de nature, chez Rousseau, est l'état danslequel l'homme vit seul, indépendant de toute organisation sociale, et donc, à fortiori, de toute pressions et de tous préjugés sociaux.
La cellule familiale, fondement etcondition sine qua non de la pérennité d'une structure sociale, n'a aucune justification dans l'état de nature.
Bien entendu, Rousseau n'est pas dupe et sait que le purétat de nature n'a probablement jamais existé et ne pourra jamais advenir.
Sa visée est plus modeste et plus réaliste ; il pense une évolution pouvant concilier nature ethistoire, liberté et société.
La nature constitue pour Rousseau une référence pour critiquer la société et dénoncer le progrès, fondé sur l'inégalité et l'ambitionindividuelle.
Ainsi, en plaçant sur un piédestal ce concept d'état de nature, Rousseau cherche, en prenant le pur, à dénoncer le souillé, la société dénaturée.
Lemensonge apparaît comme un produit social, opposé à la vérité naturelle.
Une sorte de manichéisme s'installe.
Dans l'état nature, l'homme, vivant seul, ne peutnourrir de préjugé et doit, par lui-même et au prix d'efforts de recherches personnelles, se constituer une base d'expériences individuelles afin de fonder son jugementpropre.
Ainsi, il peut vivre selon son état primitif, sans souci d'aucune convenance que la sienne propre.
Pour Rousseau, cette idée apparaît comme garante de lapureté de l'âme, en ce que l'homme vit au plus près d'une sorte de pureté originelle qui suffit à justifier et pardonner des faits que la société qualifierait de pêché, maisqui n'en sont pas.Le véritable affront fait à la nature humaine, selon la pensée rousseauiste, est de la dénaturer en lui imposant des présupposés obscurs, répondants à un code deconvenance étranger à tout état primitif.
L'homme doit vivre selon son état premier, originel et non selon un modèle social, créé de toute pièce pour assurer lapérennité de l'entreprise de progression de la société, le terme progression visant, bien entendu, un plan technique et technologique.
A ce sujet, Rousseau expliquequ'avec ce progrès, ce sont les désirs qui augmentent de manière proportionnelle.
Ainsi, plus la société progresse en techniques, plus l'homme découvre de nouveauxdésirs, parfois totalement étrangers avec ceux qu'aurait nourris l'homme primitif.
La société remodèle donc l'homme, rend l'individu étranger à sa nature originelleafin de tendre au progrès collectif.
Pour ce faire, il faut que l'homme accepte et ingère certaines valeurs et notions indispensables à l'établissement de la société,comme la cellule familiale.
Sans ces valeurs, la société ne peut tendre à la pérennité.
La modification profonde de la nature humaine est donc un enjeu primordial.Afin de transmettre ces valeurs, des préjugés sont inculqués, des présupposés sociaux indiquant, parfois de manières si solide qu'on ne peut que très difficilement lesremettre en question, ce qui correspond aux idéaux sociaux et ce qui relève du pêché ou de l'impensable.
Le préjugé apparaît donc comme un des outils de ladénaturalisation de l'homme, en opposition fondamentale avec l'état primitif de l'individu.Rousseau développe cette opposition dans ses écrits, en plaçant, notamment dans Julie ou la Nouvelle Héloïse, le préjugé en obstacle à l'accomplissement de l'idéalnaturel de l'homme et de relation pure et primitive.
Il va peindre le dépassement des présupposés sociaux et l'accession à l'état de nature comme triomphe de la naturehumaine sur la structure artificielle et aliénante de l'organisation sociale.
II/ Les présupposés sociaux dans la Nouvelle Héloïse
a) Fonction du préjugé dans l'œuvre et dans la société
Le préjugé, dans la Nouvelle Héloïse revêt plusieurs fonctions.
En effet, si sa première fonction est éducative, nous verrons qu'il est aussi garant de la Prudence et dela pérennité des valeurs fondamentales de l'organisation sociale ; il est obstacle et moteur de l'œuvre.Comme l'affirme Voltaire dans son article du dictionnaire philosophique, le préjugé est « une opinion sans jugement » appelant ratification.
Ainsi, le préjugé participede l'éducation des enfants en ce qu'il permet de leur inculquer certaines notions dont ils ne peuvent avoir aucune expérience.Avant d'aborder l'aspect d'obstacle que peut revêtir le préjugé dans l'œuvre de Rousseau, il est intéressant de voir quel rôle le philosophe lui donne dans l'éducationdes enfants.
En effet, le préjugé, dans le système social, et selon la définition que Voltaire en donne, est une base éducative universelle, il permet à l'enfant de sefonder un jugement sans avoir d'expérience personnelle, jugement qu'il ratifiera, ou non, par la suite.
Dans la lettre VI de la première partie, de Julie à Claire, Julieexplique en quoi la bonne, Mme Chaillot était peu prudente dans ses enseignements.
Ainsi, Julie semble elle-même véhiculer ce concept de prudence dans l'éducationdes enfants, et adhérer au fait qu'il est nécessaire d'inculquer des préjugés, notamment en ce qui concerne la sexualité et l'amour, aux enfants afin qu'ils correspondentaux critères que la société détermine.Dans le chapitre Education Sexuelle de l'Emile, Rousseau explique en quoi il serait dangereux de mentir à un enfant en ce qui concerne la sexualité ; en effet,l'enfant, conscient qu'on lui cache quelque chose, verra sa curiosité excitée et non pas étouffée et cherchera à être initié.
Il explique qu'en « parlant simplement detout, on ne lui laisse pas soupçonner qu'il reste rien de plus à lui dire » .
Ainsi, Mme Chaillot, présente une certaine similitude dans sa vision pédagogique avec leprécepteur de l'Emile.
Pourtant, si la bonne de Julie et Claire les « instruisait de milles choses que des jeunes filles se passeraient bien de savoir » n'était –ce pas dansce but de les en préserver ? C'est en tous cas le parti que défend Claire dans sa réponse, elle explique à Julie en quoi la bonne était la seule à véritablement pouvoir lespréserver des dangers qu'elle leur avait exposé.
Néanmoins, l'avis de Julie est intéressant en ce qu'il montre bien qu'elle aussi, malgré l'éducation de Mme Chaillot, estsoumise à des préjugés et à des présupposés sociaux.
En effet, elle évoque la notion de Prudence, notion faisant allusion aux précautions que l'on doit utiliser lors del'institution des jeunes filles concernant les choses de l'amour et, a fortiori, de sexualité.Le préjugé a donc une valeur éducative, il permet un jugement premier, amenant, si ce n'est le débat ou la mise en question, l'approfondissement de son opinionpremière.
Ainsi, Julie ne connaît l'amour qu'à travers les phrases galantes de Mme Chaillot et les préjugés de conduite qu'on lui inculque.S'il a une valeur éducative certaine, le préjugé est aussi un obstacle dans l'œuvre.
En effet, institué afin de garantir les bonnes mœurs, les valeurs fondamentales dusystème social, il va brider Julie dans son aventure amoureuse.
C'est bien à cause des présupposés sociaux qu'elle ne pourra pas, dans un premier temps, vivre sonamour avec Saint Preux.Mais paradoxalement, le préjugé est moteur de l'œuvre.
Il est évident que sans ces préjugés, évoluant dans un état de nature, dans une société primitive, Julie et SaintPreux se seraient unis sans le moindre problème, et s'en eut été fait de l'œuvre.
Ainsi, c'est le préjugé, obstacle à la réalisation de la volonté des personnages qui portel'œuvre et amène finalement au dénouement que l'on sait.Nous distinguons donc, dans Julie ou la Nouvelle Héloïse trois fonctions importantes du préjugé, il a une vocation pédagogique, en ce qu'il joue un rôle importantdans l'éducation de Julie et Claire, une fonction préservative, en ce qu'il est le garant de la sauvegarde des bonnes mœurs et donc, du bon fonctionnement de lasociété, il est obstacle, et entraine donc, à l'image d'un moteur, la fiction.
b) Julie et la pression sociale
Nous voyons donc que le personnage de Julie est concerné par la notion de préjugé, en ce qu'ils forment une des bases de son éducation et qu'ils influent, dans lapremière partie de l'œuvre en tous cas, sur son mode de pensée, sur son souci du paraitre.
De fait, Julie, lorsqu'elle embrasse Saint Preux derrière un bosquet nesemble pas concernée par ces interdits sociaux, néanmoins, si les préjugés n'influent pas directement sur ses actes, ils conditionnent son souci du paraître.
En effet,bien qu'elle ait embrassé Saint Preux, elle ne peut se résoudre à assumer son geste pleinement, de crainte du tord qu'elle pourrait se causer, à elle, mais surtout à sesparents.
La pression sociale est telle, que si la société venait à apprendre son geste, elle serait, pense t –elle, stigmatisée et son déshonneur éclabousseraitimmédiatement sa famille.
Ainsi, dans la seconde partie de l'œuvre, lorsque Milord Edouard propose à Julie et son amant des terres en Angleterre, celle-ci refuse enexpliquant qu'elle ne pourrait assumer de déshonorer sa famille, dans la lettre VI, elle écrit qu'elle « abandonnerait ceux par qui [elle] respire », et qu'elle « livreraitleurs derniers jours à la honte, aux regrets, aux pleurs ».
De plus, toujours dans la seconde partie, Julie évoque cette pression sociale, dans la lettre VII, elle évoque « la tyrannie des bienséances » et le souci des apparences.Elle explique que ces bienséances force l'individu à refreiner ses inclination.
Julie explique la nécessité, « dans la force des passions » de ne rien montrer, d'être «.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Julie ou la Nouvelle Héloïse de Jean-Jacques Rousseau
- JULIE OU LA NOUVELLE HÉLOÏSE de Jean-Jacques Rousseau (résumé & analyse)
- LA NOUVELLE HÉLOÏSE de Rousseau (analyse détaillée)
- Julie ou la Nouvelle Héloïse (résumé & analyse) de Rousseau
- La Nouvelle Héloïse 1761 (Julie ou la Nouvelle Héloïse) de Jean-Jacques Rousseau (analyse détaillée)