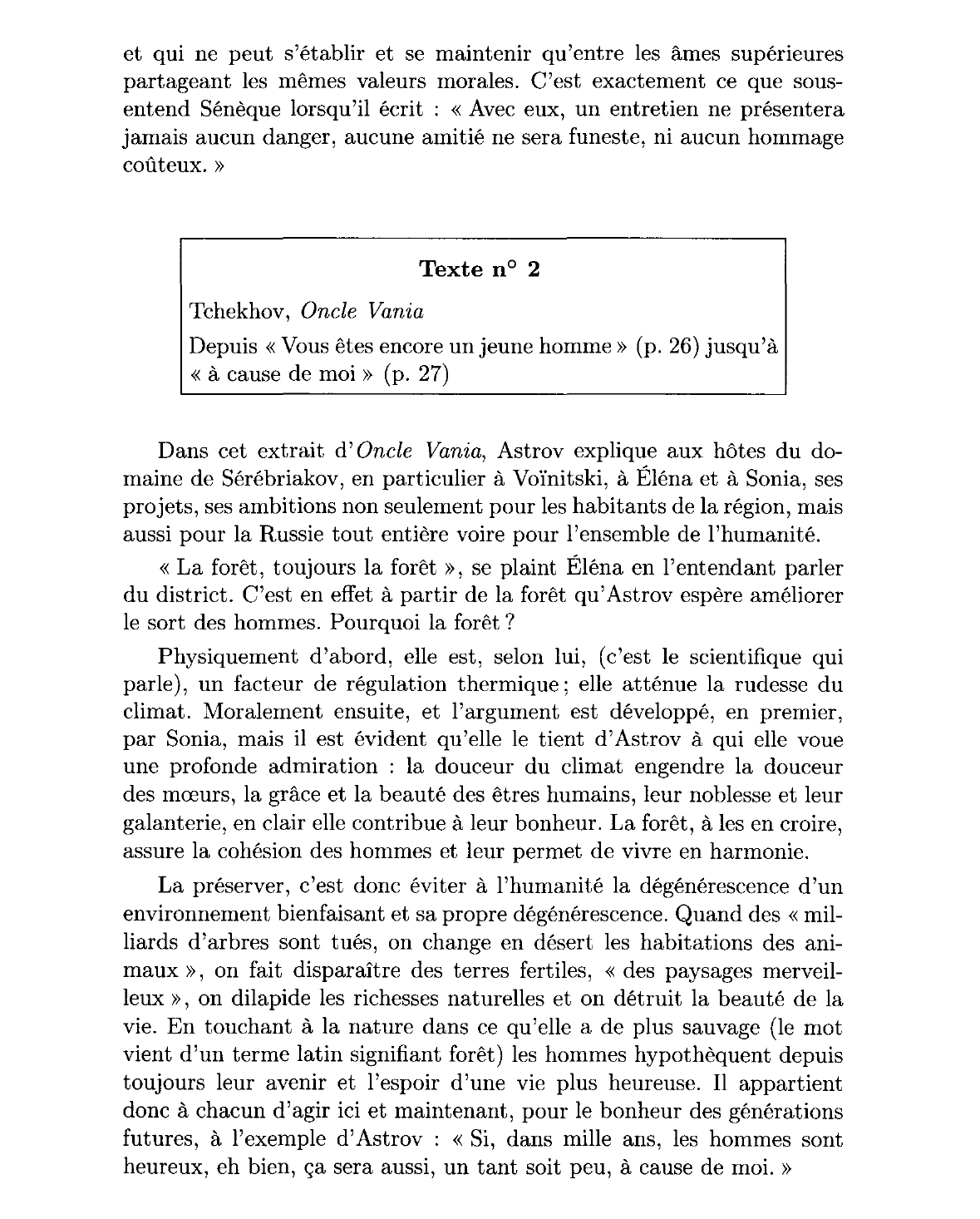« L’imaginaire du bonheur »
Publié le 05/10/2018

Extrait du document
Tchékhov, Oncle Vania
Depuis « Vous êtes encore un jeune homme » (p. 26) jusqu’à « à cause de moi » (p. 27)
Dans cet extrait d’ Oncle Vania, Astrov explique aux hôtes du domaine de Sérébriakov, en particulier à Voïnitski, à Eléna et à Sonia, ses projets, ses ambitions non seulement pour les habitants de la région, mais aussi pour la Russie tout entière voire pour l’ensemble de l’humanité.
« La forêt, toujours la forêt », se plaint Élêna en l’entendant parler du district. C’est en effet à partir de la forêt qu’Astrov espère améliorer le sort des hommes. Pourquoi la forêt ?
Physiquement d’abord, elle est, selon lui, (c’est le scientifique qui parle), un facteur de régulation thermique; elle atténue la rudesse du climat. Moralement ensuite, et l’argument est développé, en premier, par Sonia, mais il est évident qu’elle le tient d’Astrov à qui elle voue une profonde admiration : la douceur du climat engendre la douceur des mœurs, la grâce et la beauté des êtres humains, leur noblesse et leur galanterie, en clair elle contribue à leur bonheur. La forêt, à les en croire, assure la cohésion des hommes et leur permet de vivre en harmonie.
Le mot utopie a été forgé par Thomas More, écrivain humaniste du XVIe siècle. Il désigne à l’origine un pays (en l’occurrence une île dans l’œuvre de More) à l’écart de tout, sans histoire, où chacun des habitants peut s’épanouir dans l’harmonie d’une société parfaite et heureuse. Les trois extraits qui suivent montrent ainsi que la quête du bonheur, par bien des côtés, a des aspects utopiques.
Sénèque, La Brièveté de la vie
Depuis « Nous pensons que seuls » (p. 132) jusqu’à « comme à un dieu » (p. 134)
Dans cet extrait, comme dans toute La brièveté de la vie, Sénèque propose à Paulinus, et, au-delà, à tous ceux que les affaires, le travail ou les plaisirs accaparent trop, une voie d’accès au bonheur. Et c’est dans une retraite non pas oisive, mais agrémentée par la lecture des « prêtres des valeurs suprêmes », comme Zénon, Pythagore, Aristote ou d’autres, qu’il propose de trouver cette voie.
Il ne s’agit pas à proprement parler d’une utopie, puisqu’il n’imagine aucun lieu, à l’écart des tracas du monde et propice à l’épanouissement d’un bonheur individuel ou collectif. Mais il décrit ce que pourrait être une vie enrichie par la fréquentation des grands esprits du passé. Tout l’extrait, où domine le futur, insiste ainsi sur les biens qu’on peut en attendre : « Tu emporteras d’eux tout ce que tu voudras » affirme l’auteur ; et il ajoute même : « ils te donneront le chemin de l’éternité. »
Car telle est la vertu de la lecture des sages ; non seulement elle force le respect et l’admiration de tous, à chaque génération, mais elle permet aussi à chacun de « dépasser sa condition de mortel », de « s’immortaliser » pour reprendre le mot d’Aristote, à leur contact, c’est-à-dire d’avoir la possibilité d’être heureux à l’égal des dieux, débarrassés de la hantise de la mort.
C’est pourquoi lire les grands philosophes, c’est s’en faire des amis ; et leur amitié a le caractère pur et authentique que l’auteur de l'Ethique à Nicomaque reconnaît à l’amitié la plus noble, celle qui est désintéressée
Le Clézio, Le Chercheur d’or
Depuis « Mais le timonier ne parle pas » jusqu’à « dans l’eau légère. » (p. 176-177)
Au cours de la première traversée vers Rodrigues, le Zeta fait escale à Saint Brandon présentée par le timonier noir comme un véritable paradis. Cette page en offre en effet toutes les caractéristiques. Tout d’abord, le timonier s’apparente à Charon, le nocher infernal qui fait traverser l’Achéron aux âmes des défunts dans la mythologie gréco-romaine, il fait ici « franchir la passe ». Aussitôt, l’on accède alors à un monde de perfection, un nouvel espace où ce sont les îles qui se meuvent, comme des « cétacés » et non le navire.
«
et qui ne peut s'établir et se maintenir qu'entre les âmes supeneures
partageant les mêmes valeurs morales.
C'est exactement ce que sous
entend Sénèque lorsqu'il écrit : « Avec eux, un entretien ne présentera
jamais aucun danger, aucune amitié ne sera funeste, ni aucun hommage
coûteux.»
Texte n° 2
Tchekhov, Oncle Vania
Depuis «Vous êtes encore un jeune homme» (p.
26) jusqu'à
« à cause de moi » (p.
27)
Dans cet extrait d' Oncle Vania, Astrov explique aux hôtes du do
maine de Sérébriakov, en particulier à Voïnitski, à
Éléna et à Sonia, ses
projets, ses ambitions non seulement
pour les habitants de la région, mais
aussi
pour la Russie tout entière voire pour l'ensemble de l'humanité.
«La forêt, toujours la forêt», se plaint Éléna en l'entendant parler
du district.
C'est en effet à partir de la forêt qu'Astrov espère améliorer
le sort des hommes.
Pourquoi la forêt ?
Physiquement d'abord, elle est, selon lui, (c'est le scientifique qui
parle),
un facteur de régulation thermique; elle atténue la rudesse du
climat.
Moralement ensuite, et l'argument est développé, en premier,
par Sonia, mais il est évident qu'elle le tient d' Astrov à qui elle voue
une profonde admiration : la douceur du climat engendre la douceur
des mœurs,
la grâce et la beauté des êtres humains, leur noblesse et leur
galanterie,
en clair elle contribue à leur bonheur.
La forêt, à les en croire,
assure
la cohésion des hommes et leur permet de vivre en harmonie.
La préserver, c'est donc éviter à l'humanité la dégénérescence d'un
environnement bienfaisant et sa propre dégénérescence.
Quand des « mil
liards
d'arbres sont tués, on change en désert les habitations des ani
maux », on fait disparaître des terres fertiles, « des paysages merveil
leux
», on dilapide les richesses naturelles et on détruit la beauté de la
vie.
En touchant à la nature dans ce qu'elle a de plus sauvage (le mot
vient d'un terme latin signifiant forêt) les hommes hypothèquent depuis
toujours leur avenir
et l'espoir d'une vie plus heureuse.
Il appartient
donc à chacun d'agir ici et maintenant, pour le bonheur des générations
futures, à l'exemple d' Astrov :
« Si, dans mille ans, les hommes sont
heureux,
eh bien, ça sera aussi, un tant soit peu, à cause de moi.
».
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Citations utiles : « L'imaginaire du bonheur »
- AU BONHEUR DES DAMES
- Analyse linéaire de l'incipit Au Bonheur des dames
- analyse linéaire Molière - Texte 1 : Acte II scène 5 (extrait du Malade Imaginaire)
- Fiche d'oral du bac de français ( théatre le malade imaginaire)