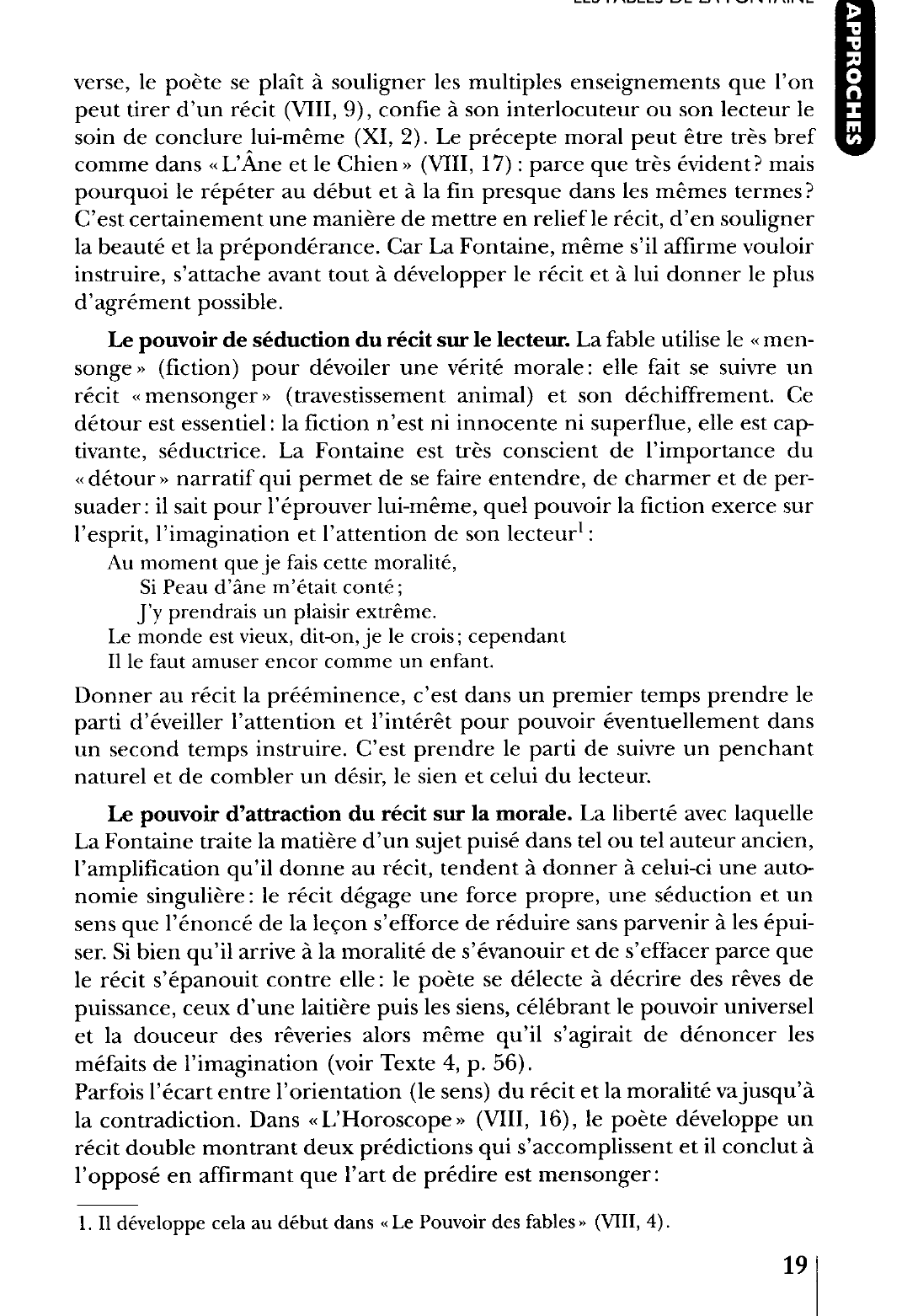L'invention de la fable poétique
Publié le 27/03/2015
Extrait du document


«
LES FABLES DE LA FONTAINE
verse, le poète se plaît à souligner les multiples enseignements que l'on
peut tirer d'un récit (VIII, 9), confie à son interlocuteur ou son lecteur le
soin
de conclure lui-même (XI, 2).
Le précepte moral peut être très bref
comme dans «L'Âne et le Chien» (VIII, 17): parce que très évîdent? mais
pourquoi le répéter au début et à la fin presque dans les mêmes termes?
C'est certainement une manière de mettre en relief le récit, d'en souligner
la beauté et la prépondérance.
Car La Fontaine, même s'il affirme vouloir
instruire, s'attache avant tout à développer le récit et à lui donner le plus
d'agrément possible.
Le pouvoir de séduction du récit sur le lecteur.
La fable utilise le «men
songe» (fiction) pour dévoiler une vérité morale: elle fait se suivre un
récit « mensonger» (travestissement animal) et son déchiffrement.
Ce
détour est essentiel: la fiction n'est ni innocente ni superflue, elle est cap
tivante,
séductrice.
La Fontaine est très conscient de l'importance du
«détour» narratif qui permet de se faire entendre, de charmer et de per
suader: il sait pour!' éprouver lui-même, quel pouvoir la fiction exerce sur
l'esprit, l'imagination et l'attention de son lecteur 1
:
Au moment que je fais cette moralité,
Si Peau d'âne m'était conté;
J'y prendrais un plaisir extrême.
Le monde est vieux, dit-on, je le crois; cependant
Il le faut amuser encor comme un enfant.
Donner au récit la prééminence, c'est dans un premier temps prendre le
parti d'éveiller l'attention et l'intérêt pour pouvoir éventuellement dans
un second temps instruire.
C'est prendre le parti de suivre un penchant
naturel et de combler un désir, le sien et celui du lecteur.
Le pouvoir d'attraction du récit sur la morale.
La liberté avec laquelle
La Fontaine traite la matière d'un sujet puisé dans tel ou tel auteur ancien,
l'amplification qu'il donne au récit, tendent à donner à celui-ci une auto
nomie singulière: le récit dégage une force propre, une séduction et un
sens que l'énoncé de la leçon s'efforce de réduire sans parvenir à les épui
ser.
Si bien qu'il arrive à la moralité de s'évanouir et de s'effacer parce que
le récit s'épanouit contre elle: le poète se délecte à décrire des rêves de
puissance, ceux d'une laitière puis les siens, célébrant le pouvoir universel
et la douceur des rêveries alors même qu'il s'agirait de dénoncer les
méfaits
de l'imagination (voir Texte 4, p.
56).
Parfois
l'écart entre!' orientation (le sens) du récit et la moralité va jusqu'à
la contradiction.
Dans «L'Horoscope» (VIII, 16), le poète développe un
récit double montrant deux prédictions qui s'accomplissent et il conclut à
l'opposé en affirmant que l'art de prédire est mensonger:
1.
Il développe cela au début dans "Le Pouvoir des fables» (VIII, 4).
19.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Madame de La Sablière reproche à Boileau d'avoir omis la fable dans son Art poétique.
- Comment l’astronomie, la navigation et le calcul bancaire sont-ils à l’origine de l’invention des logarithmes ?
- « L’homme est une invention récente » MICHEL FOUCAULT
- Le temps est invention. Bergson
- Mémoire, histoire et écriture dans l'invention du désert