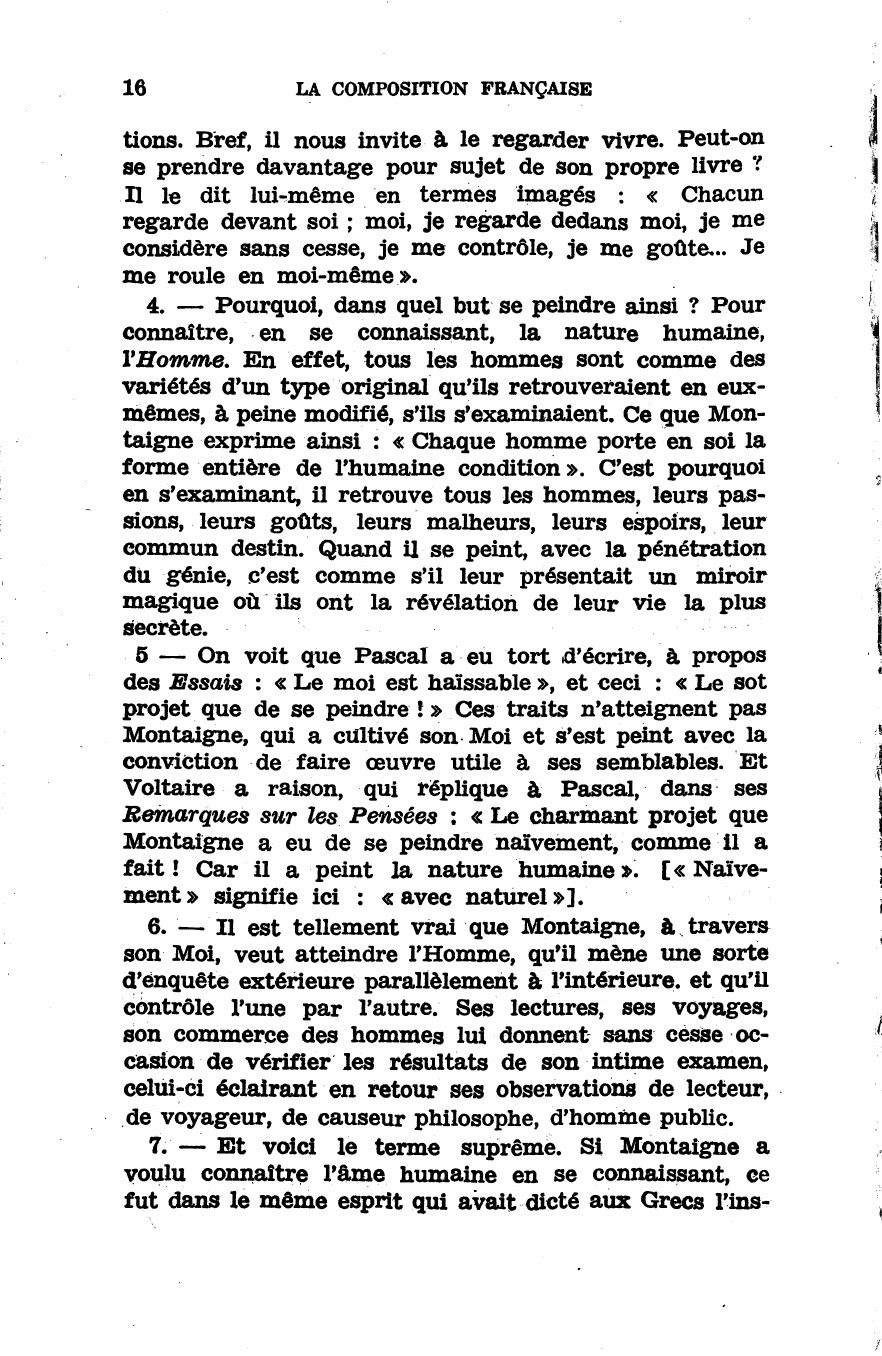Montaigne: l'homme, l'amitié - la sagesse - le voyage - la pédagogie
Publié le 07/11/2011

Extrait du document

Michel Éyquem de Montaigne, né au château de Montaigne (Périgord), d'abord magistrat, résigna sa charge à trente-sept ans, se retira dans son château périgourdin, s'installa au troisième étage d'une tour solitaire au milieu des livres de sa bibliothèque, qu'il appelle sa librairie et y commença la rédaction des Essais. Après un voyage à travers la Suisse, l'Allemagne et l'Italie, il fut maire de Bordeaux ; puis revenu s'enfermer dans sa chère librairie, il retoucha les deux oeuvres d'Essais parus, leur en ajouta un troisième, publia le tout en 1588. Sans prendre part aux luttes religieuses, il s'était rallié à Henri IV.

«
16 LA COMPOSITION FRANÇAISE
tions.
Bref, il nous invite à le regarder vivre.
Peut-on
se prendre davantage pour sujet de son propre livre 'f
D le dit lui-même en termes imagés : « Chacun regarde devant soi ; moi, je regarde dedans moi, je me considère sans cesse, je me contrôle, je me gofi.te...
Je me roule en moi-même :..
4.
- Pourquoi, dans quel but se peindre ainsi ? Pour conna.itre, .
en se connaissant, la nature humaine, l'Homme.
En effet, tous les hommes sont comme des
variétés d'un type original qu'ils retrouveraient en eux
mêmes, à peine modifié, s'ils s'examinaient.
Ce que Mon taigne exprime ainsi : « Chaque homme potte en soi la forme entière de l'humaine condition».
C'est pourquoi en s'examinant, il retrouve tous les hommes, leurs pas sions, leurs goftts, leurs malheurs, leurs e8poîrs, .
leur commun destin.
Quand il se peint, avec la pénétration
du génie, c'est comme s'il leur présentait un miroir magique où ils ont la révélation de leur vie la plus sec tète.
5 - On voit que Pascal a eu tort d'écrire, à propos
des Essais : « Le moi est haïssable :., et ceci : « Le sot projet que de se peindre ! » Ces traits n'atteignent pas Montaigne, qui a cultivé son.
Moi et s'est peint avec la conviction de faire œuvre utile à ses semblables.
Et Voltaire a raison, qui réplique à Pascal, dans ses Remarques sur les Pensées : « Le charmant projet que
Montaigne a eu de se peindre naïvement, comme il a fait ! Car il a peint la nature humaine »~ [ « Naïve ment:.
signifie ici : c avec naturel :.
] .
6.
-
n est tellement vrai que Montaigne, à.
travers son Moi, veut atteindre l'Homme, qu'il mène une sorte d'enquête extérieure parallèlement à l'intérieure.
et qu'il
contrôle l'une par l'autre.
Ses lectures, ses voyages, son commerce des hommes lui donnent sans cèsse ·oc casion de vérifier les résultats de son ·intime examen, celtii~ci éclairant· en retour ses observationS de lecteur,
de voyageur, de
causeur philosophe, d'homme public.
7.
- Et voici le terme suprême.
Si Montaigne a
voulu co~tre l'âme humaine en se connaissant, ce fut dans le même esprit qui aVait dicté aux Grecs l'ina-
l
i
1 l
1 1
j ·l'
l
{.
i
,1.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- De tous les biens que la sagesse procure à l'homme pour le rendre heureux, il n'en est point de plus grand que l'amitié. C'est en elle que l'homme, borné comme il l'est par sa nature, trouve la sûreté et son appui. [ Maximes ] Epicure. Commentez cette citation.
- Comment peut-on prétendre que les amis sont rares, dans le besoin? Mais c'est le contraire. A peine a-t-on fait amitié avec un homme, que le voilà aussitôt dans le besoin et qu'il vous emprunte de l'argent. Aphorismes sur la sagesse dans la vie (1851) Schopenhauer, Arthur. Commentez cette citation.
- De tous les biens que la sagesse procure à l'homme pour le rendre heureux, il n'en est point de plus grand que l'amitié. c'est en elle que l'homme, borné comme il l'est par sa nature, trouve la sûreté et son appui. Maximes Epicure. Commentez cette citation.
- Arthur SCHOPENHAUER / Aphorismes sur la sagesse dans la vie (1851) / Collection Quadrige / PUF 1943 « Comment peut-on prétendre que les amis sont rares, dans le besoin ? Mais c'est le contraire. À peine a-t-on fait amitié avec un homme, que le voilà aussitôt dans le besoin et qu'il vous emprunte de l'argent. ». Commentez cette citation.
- VOYAGE D’UN PAUVRE HOMME DE LETTRES (résumé & analyse de l’oeuvre)