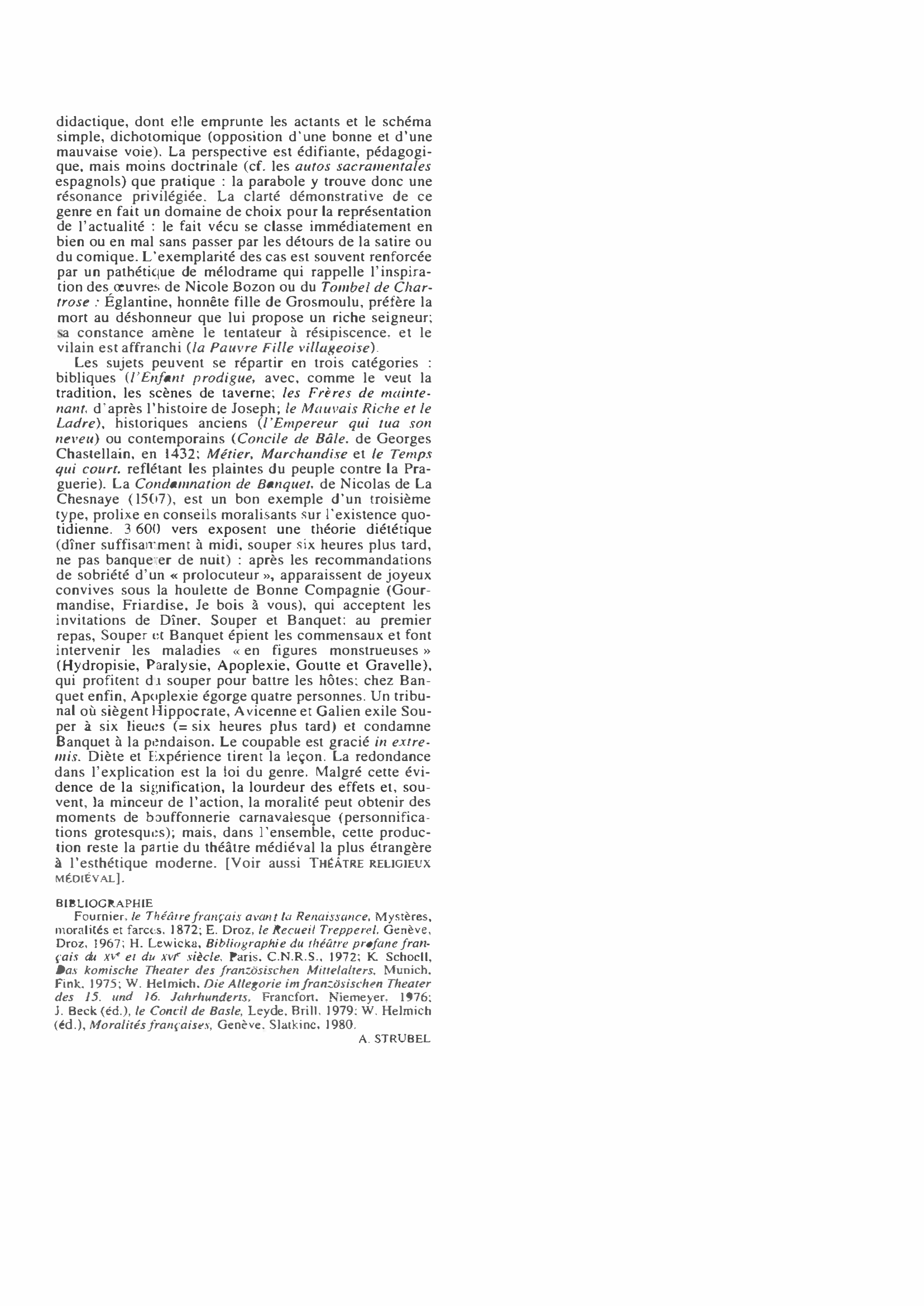MORALITÉ (genre dramatique médiéval)
Publié le 25/11/2018

Extrait du document
MORALITÉ (genre dramatique médiéval). De la fin du Moyen Âge et du début du xvie siècle subsistent quelque soixante pièces dont les acteurs sont des personnifications, du moins en grande partie. Le nombre des personnages va de quatre ou cinq à vingt (Vie et histoire du Mauvais Riche, Moralité de Charité). Bien Advenir et Mal Advenir, joué à Rennes en 1439 avec ses 8 000 vers et ses 50 rôles (Raison, Foi, Obéissance, Contrition, Rébellion...), atteint une dimension qui le rapproche du mystère. La moralité, genre théâtral le plus littéraire (beaucoup de textes ont été transmis avec le nom d’auteur), est un avatar dramatique de la tradition allégorique didactique, dont elle emprunte les actants et le schéma simple, dichotomique (opposition d'une bonne et d’une mauvaise voie). La perspective est édifiante, pédagogique, mais moins doctrinale (cf. les autos sacramentales espagnols) que pratique : la parabole y trouve donc une résonance privilégiée. La clarté démonstrative de ce genre en fait un domaine de choix pour la représentation de l’actualité : le fait vécu se classe immédiatement en bien ou en mal sans passer par les détours de la satire ou du comique. L’exemplarité des cas est souvent renforcée par un pathétique de mélodrame qui rappelle l’inspiration des œuvres de Nicole Bozon ou du Tombel de Char-trose : Églantine, honnête fille de Grosmoulu, préfère la mort au déshonneur que lui propose un riche seigneur; sa constance amène le tentateur à résipiscence, et le vilain est affranchi (la Pauvre Fille villageoise).
«
didactique,
dont elle emprunte les actants et le schéma
simple, dichotomique (opposition d'une bonne et d'une
mauvaise voie).
La perspective est édifiante, pédagogi
que, mais moins doctrinale (cf.
les autos sacramentales
espagnols) que pratique : la parabole y trouve donc une
résonance privilégiée.
La clarté démonstrative de ce
genre en fait un domaine de choix pour la représentation
de l'actualité : le fait vécu se classe immédiatement en
bien ou en mal sans passer par les détours de la satire ou
du comique.
L'exemplarité des cas est souvent renforcée
par un pathétique de mélodrame qui rappelle l'inspira
tion des œuvres de Nicole Bozon ou du Tombe/ de Char
trose : Églantine, honnête fille de Grosmoulu, préfère la
mort au déshonneur que lui propose un riche seigneur;
a constance amène le tentateur à résipiscence, et Je
vilain est affranchi (la Pauvre Fille villageoise).
Les sujets peuvent se répartir en trois catégories :
bibliques (l'Enfant prodigue, avec, comme le veut la
tradition, les scènes de taverne; les Frères de mainte
nant, d'après l'histoire de Joseph; le Mauvais Riche et le
Ladre), historiques anciens (l'Empereur qui tua son
neveu) ou contemporains (Concile de Bâle, de Georges
Chastellain, en 1432; Métier, Marchandise et le Temps
qui court, reflétant les plaintes du peuple contre la Pra
guerie).
La Condamnation de Banquet, de Nicolas de La
Chesnaye (l5Ct7), est un bon exemple d'un troisième
type, prolixe en conseils moralisants sur r existence quo
tidienne.
3 600 vers exposent une théorie diététique
(dîner suffisarr: ment à midi, souper six heures plus tard,
ne pas banque·:er de nuit) : après les recommandations
de sobriété d'un « prolocuteur », apparaissent de joyeux
convives sous la houleue de Bonne Compagnie (Gour
mandise, Friardise, Je bois à vous), qui acceptent les
invitations de Dîner, Souper et Banquet; au premier
repas, Souper et Banquet épient les commensaux et font
intervenir les maladies «en figures monstrueuses >>
(Hydropisie, Paralysie, Apoplexie, Gouue et Gravelle),
qui profitent d J souper pour battre les hôtes; chez Ban
quet enfin, Apoplexie égorge quatre personnes.
Un tribu
nal où siègent Hippocrate, Avicenne et Galien exile Sou
per à six lieut!S (= six heures plus tard) et condamne
Banquet à la p•!ndaison.
Le coupable est gracié in extre
mis.
Diète et Expérience tirent la leçon.
La redondance
dans l'explication est la loi du genre.
Malgré cette évi
dence de la signification, la lourdeur des effets et, sou
vent, la minceur de l'action, la moralité peut obtenir des
moments de bouffonnerie carnavalesque (personnifica
tions grotesqu•!s); mais, dans 1 'ensemble, cette produc
tion reste la partie du théâtre médiéval la plus étrangère
à l'esthétique moderne.
[Voir aussi TH�ÂTRE RELIGIEUX
M�Oi t::VAL].
BIBLIOGRAPHIE Fournier, le TIJéâJrefrançais avan t la Renaissance, Mystères,
m or alit és et farc.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- RACINE: Que me font, à moi, sujet paisible d'un État monarchique du XVIIIe siècle, les révolutions d'Athènes et de Rome? Quel véritable intérêt puis-je prendre à la mort d'un tyran du Péloponèse, au sacrifice d'une jeune princesse en Aulide? Il n'y a dans tout cela rien à voir pour moi, aucune moralité qui me convienne. (Essai sur le genre dramatique sérieux.) Beaumarchais.
- Beaumarchais a écrit dans son Essai sur le genre dramatique sérieux : Que me font à moi, paisible citoyen d'un état monarchique au XVIIIe siècle, le meurtre d'un tyran du Péloponnèse ou le sacrifice d'une jeune personne en Aulide ? Il n'y a là aucun intérêt, aucune moralité qui me convienne... Expliquez et commentez.
- Vous aimez sans doute le théâtre, si peut-être vous ne l'avez pas encore beaucoup fréquenté. Pourriez-vous dire le genre de plaisir que vous attendez d'une représentation dramatique ?
- Sujet : Comparez les approches intégration des femmes au développement (IFD) et Genre et Développement (GED) et dites sur quoi se fondent leurs différences au plan idéologique et ce que vous inspire vos expériences professionnelles ou de terrain.
- Dissertation Fables: II y a longtemps que les fables ne nous intéressent plus pour la moralité