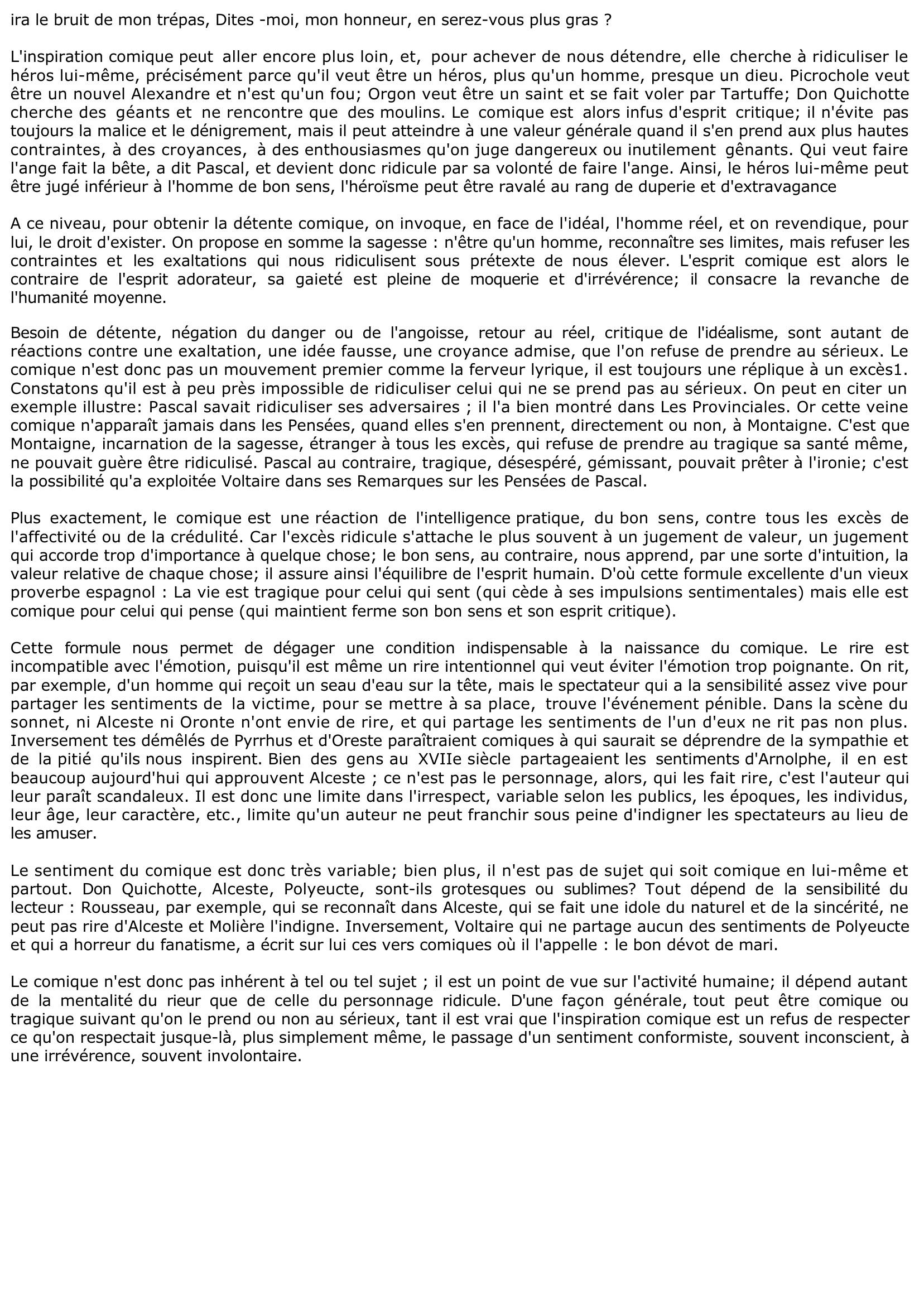NATURE DE L'INSPIRATION COMIQUE
Publié le 06/04/2011

Extrait du document
Les différentes inspirations poétiques (épique, lyrique, tragique) se proposent toutes de susciter chez le lecteur des émotions poignantes : admiration, terreur, pitié, ferveur. Le poète veut exalter son lecteur; il lui présente des héros qui prennent au sérieux, au tragique, et même au sacré, jusqu'à en mourir, une passion, un devoir, une émotion. La bravoure pour Roland, l'amour pour Hermione, la gloire pour Rodrigue ont à peu près la même importance que la foi pour Pascal. Le héros a le culte de son rôle, il s'en fait une idole, c'est de là que vient son prestige ; et le public, en sa présence, se sentirait bien médiocre, s'il ne s'exaltait avec lui. Cette exaltation poétique du lecteur a d'ailleurs des racines dans la réalité; la vie quotidienne, elle aussi, exige qu'on la prenne au moins au sérieux, sinon au tragique, qu'on fasse un perpétuel effort d'attention, de mémoire, de politesse, qu'on accepte de multiples contraintes : morale, lois, coutumes, sous peine de n'avoir aucune valeur individuelle ou sociale.
«
ira le bruit de mon trépas, Dites -moi, mon honneur, en serez-vous plus gras ?
L'inspiration comique peut aller encore plus loin, et, pour achever de nous détendre, elle cherche à ridiculiser lehéros lui-même, précisément parce qu'il veut être un héros, plus qu'un homme, presque un dieu.
Picrochole veutêtre un nouvel Alexandre et n'est qu'un fou; Orgon veut être un saint et se fait voler par Tartuffe; Don Quichottecherche des géants et ne rencontre que des moulins.
Le comique est alors infus d'esprit critique; il n'évite pastoujours la malice et le dénigrement, mais il peut atteindre à une valeur générale quand il s'en prend aux plus hautescontraintes, à des croyances, à des enthousiasmes qu'on juge dangereux ou inutilement gênants.
Qui veut fairel'ange fait la bête, a dit Pascal, et devient donc ridicule par sa volonté de faire l'ange.
Ainsi, le héros lui-même peutêtre jugé inférieur à l'homme de bon sens, l'héroïsme peut être ravalé au rang de duperie et d'extravagance
A ce niveau, pour obtenir la détente comique, on invoque, en face de l'idéal, l'homme réel, et on revendique, pourlui, le droit d'exister.
On propose en somme la sagesse : n'être qu'un homme, reconnaître ses limites, mais refuser lescontraintes et les exaltations qui nous ridiculisent sous prétexte de nous élever.
L'esprit comique est alors lecontraire de l'esprit adorateur, sa gaieté est pleine de moquerie et d'irrévérence; il consacre la revanche del'humanité moyenne.
Besoin de détente, négation du danger ou de l'angoisse, retour au réel, critique de l'idéalisme, sont autant deréactions contre une exaltation, une idée fausse, une croyance admise, que l'on refuse de prendre au sérieux.
Lecomique n'est donc pas un mouvement premier comme la ferveur lyrique, il est toujours une réplique à un excès1.Constatons qu'il est à peu près impossible de ridiculiser celui qui ne se prend pas au sérieux.
On peut en citer unexemple illustre: Pascal savait ridiculiser ses adversaires ; il l'a bien montré dans Les Provinciales.
Or cette veinecomique n'apparaît jamais dans les Pensées, quand elles s'en prennent, directement ou non, à Montaigne.
C'est queMontaigne, incarnation de la sagesse, étranger à tous les excès, qui refuse de prendre au tragique sa santé même,ne pouvait guère être ridiculisé.
Pascal au contraire, tragique, désespéré, gémissant, pouvait prêter à l'ironie; c'estla possibilité qu'a exploitée Voltaire dans ses Remarques sur les Pensées de Pascal.
Plus exactement, le comique est une réaction de l'intelligence pratique, du bon sens, contre tous les excès del'affectivité ou de la crédulité.
Car l'excès ridicule s'attache le plus souvent à un jugement de valeur, un jugementqui accorde trop d'importance à quelque chose; le bon sens, au contraire, nous apprend, par une sorte d'intuition, lavaleur relative de chaque chose; il assure ainsi l'équilibre de l'esprit humain.
D'où cette formule excellente d'un vieuxproverbe espagnol : La vie est tragique pour celui qui sent (qui cède à ses impulsions sentimentales) mais elle estcomique pour celui qui pense (qui maintient ferme son bon sens et son esprit critique).
Cette formule nous permet de dégager une condition indispensable à la naissance du comique.
Le rire estincompatible avec l'émotion, puisqu'il est même un rire intentionnel qui veut éviter l'émotion trop poignante.
On rit,par exemple, d'un homme qui reçoit un seau d'eau sur la tête, mais le spectateur qui a la sensibilité assez vive pourpartager les sentiments de la victime, pour se mettre à sa place, trouve l'événement pénible.
Dans la scène dusonnet, ni Alceste ni Oronte n'ont envie de rire, et qui partage les sentiments de l'un d'eux ne rit pas non plus.Inversement tes démêlés de Pyrrhus et d'Oreste paraîtraient comiques à qui saurait se déprendre de la sympathie etde la pitié qu'ils nous inspirent.
Bien des gens au XVIIe siècle partageaient les sentiments d'Arnolphe, il en estbeaucoup aujourd'hui qui approuvent Alceste ; ce n'est pas le personnage, alors, qui les fait rire, c'est l'auteur quileur paraît scandaleux.
Il est donc une limite dans l'irrespect, variable selon les publics, les époques, les individus,leur âge, leur caractère, etc., limite qu'un auteur ne peut franchir sous peine d'indigner les spectateurs au lieu deles amuser.
Le sentiment du comique est donc très variable; bien plus, il n'est pas de sujet qui soit comique en lui-même etpartout.
Don Quichotte, Alceste, Polyeucte, sont-ils grotesques ou sublimes? Tout dépend de la sensibilité dulecteur : Rousseau, par exemple, qui se reconnaît dans Alceste, qui se fait une idole du naturel et de la sincérité, nepeut pas rire d'Alceste et Molière l'indigne.
Inversement, Voltaire qui ne partage aucun des sentiments de Polyeucteet qui a horreur du fanatisme, a écrit sur lui ces vers comiques où il l'appelle : le bon dévot de mari.
Le comique n'est donc pas inhérent à tel ou tel sujet ; il est un point de vue sur l'activité humaine; il dépend autantde la mentalité du rieur que de celle du personnage ridicule.
D'une façon générale, tout peut être comique outragique suivant qu'on le prend ou non au sérieux, tant il est vrai que l'inspiration comique est un refus de respecterce qu'on respectait jusque-là, plus simplement même, le passage d'un sentiment conformiste, souvent inconscient, àune irrévérence, souvent involontaire..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Dans Les grenouilles (405 av. J.-C.), le comique grec Aristophane imagine un dialogue entre Euripide et Eschyle. Le premier reproche au second d'avoir dépeint dans un style emphatique des êtres qui ne sont pas vrais, parce qu'ils sont plus grands que nature. « Euripide. — Mais enfin, oui ou non, est-il inventé ce sujet que j'ai traité, celui de Phèdre 1 ? Eschyle.— Hélas non, il est réel ; mais le poète se doit de laisser dans l'ombre ce qui est mal, de ne pas le mettre en scène, de
- Commentez et discutez cette phrase de l'écrivain allemand Henri Heine sur l'inspiration el la création artistique : « Ce n'est que dans l'hiver qu'on reconnaît la, nature du printemps et c'est derrière le poêle qu'on retrouve les meilleures chansons de mai ».
- Vis comica / La force comique
- Philo l'homme face à la nature
- La nature, le climat et les problèmes écologiques : faut-il donner la personnalité juridique à la nature (aux animaux) pour les protéger ?