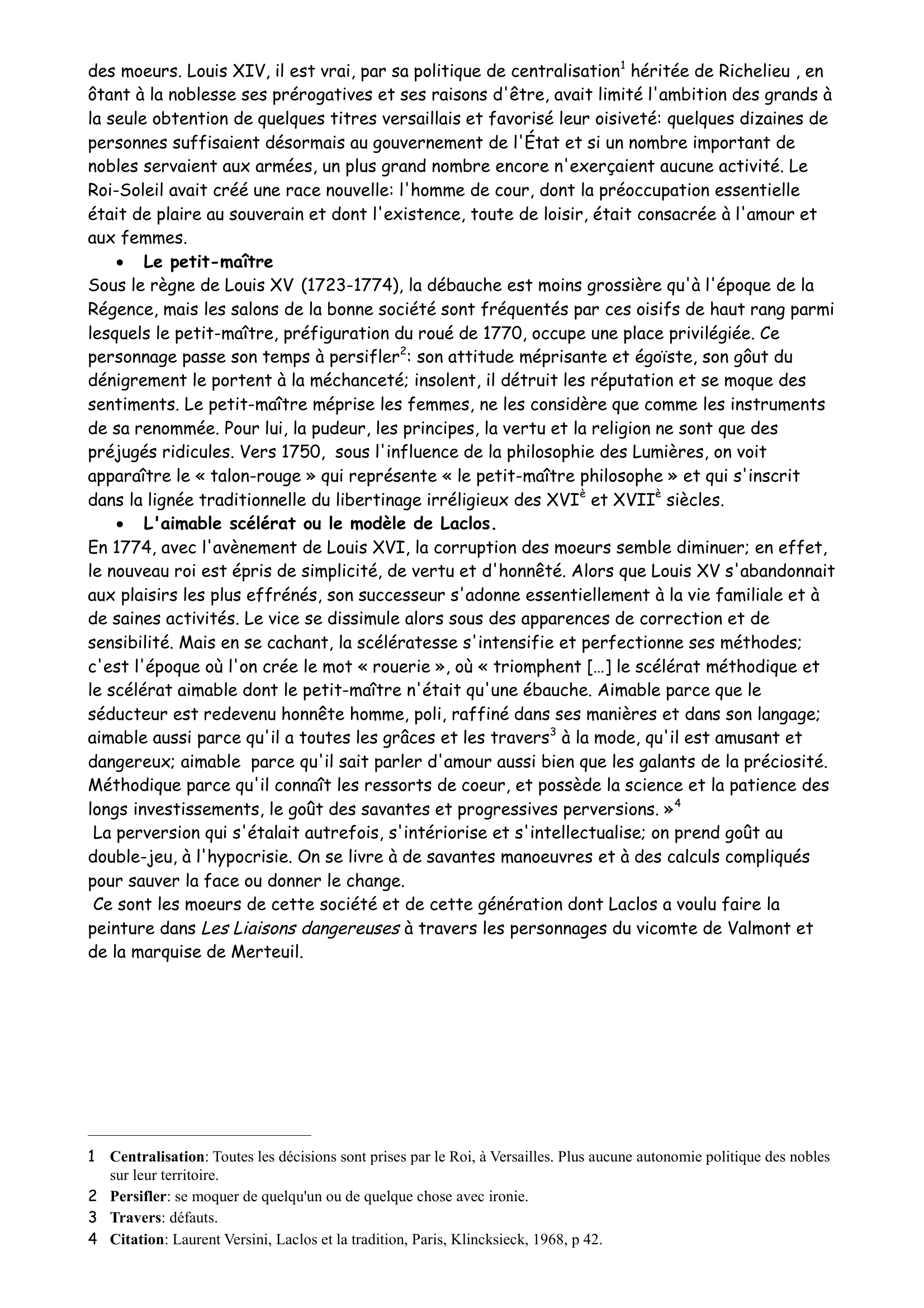PETITE HISTOIRE DU LIBERTINAGE
Publié le 27/02/2012

Extrait du document


«
des moeurs.
Louis XIV, il est vrai, par sa politique de centralisation 1héritée de Richelieu , en
ôtant à la noblesse ses prérogatives et ses raisons d'être, avait limité l'ambition des grands à
la seule obtention de quelques titres versaillais et favorisé leur oisiveté: quelques dizaines de
personnes suffisaient désormais au gouvernement de l'État et si un nombre important de
nobles servaient aux armées, un plus grand nombre encore n'exerçaient aucune activité.
Le
Roi-Soleil avait créé une race nouvelle: l'homme de cour, dont la préoccupation essentielle
était de plaire au souverain et dont l'existence, toute de loisir, était consacrée à l'amour et
aux femmes.
Le petit-maître
Sous le règne de Louis XV (1723-1774), la débauche est moins grossière qu'à l'époque de la
Régence, mais les salons de la bonne société sont fréquentés par ces oisifs de haut rang parmi
lesquels le petit-maître, préfiguration du roué de 1770, occupe une place privilégiée.
Ce
personnage passe son temps à persifler 2: son attitude méprisante et égoïste, son gôut du
dénigrement le portent à la méchanceté; insolent, il détruit les réputation et se moque des
sentiments.
Le petit-maître méprise les femmes, ne les considère que comme les instruments
de sa renommée.
Pour lui, la pudeur, les principes, la vertu et la religion ne sont que des
préjugés ridicules.
Vers 1750, sous l'influence de la philosophie des Lumières, on voit
apparaître le « talon-rouge » qui représente « le petit-maître philosophe » et qui s'inscrit
dans la lignée traditionnelle du libertinage irréligieux des XVI èet XVII èsiècles.
L'aimable scélérat ou le modèle de Laclos.
En 1774, avec l'avènement de Louis XVI, la corruption des moeurs semble diminuer; en effet,
le nouveau roi est épris de simplicité, de vertu et d'honnêté.
Alors que Louis XV s'abandonnait
aux plaisirs les plus effrénés, son successeur s'adonne essentiellement à la vie familiale et à
de saines activités.
Le vice se dissimule alors sous des apparences de correction et de
sensibilité.
Mais en se cachant, la scélératesse s'intensifie et perfectionne ses méthodes;
c'est l'époque où l'on crée le mot « rouerie », où « triomphent […] le scélérat méthodique et
le scélérat aimable dont le petit-maître n'était qu'une ébauche.
Aimable parce que le
séducteur est redevenu honnête homme, poli, raffiné dans ses manières et dans son langage;
aimable aussi parce qu'il a toutes les grâces et les travers 3à la mode, qu'il est amusant et
dangereux; aimable parce qu'il sait parler d'amour aussi bien que les galants de la préciosité.
Méthodique parce qu'il connaît les ressorts de coeur, et possède la science et la patience des
longs investissements, le goût des savantes et progressives perversions.
» 4
La perversion qui s'étalait autrefois, s'intériorise et s'intellectualise; on prend goût au
double-jeu, à l'hypocrisie.
On se livre à de savantes manoeuvres et à des calculs compliqués
pour sauver la face ou donner le change.
Ce sont les moeurs de cette société et de cette génération dont Laclos a voulu faire la
peinture dans Les Liaisons dangereuses à travers les personnages du vicomte de Valmont et
de la marquise de Merteuil.
1 Centralisation : Toutes les décisions sont prises par le Roi, à Versailles.
Plus aucune autonomie politique des nobles
sur leur territoire.
2 Persifler : se moquer de quelqu'un ou de quelque chose avec ironie.
3 Travers : défauts.
4 Citation : Laurent Versini, Laclos et la tradition, Paris, Klincksieck, 1968, p 42..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- William Makepeace Thackeray par Raymond Las Vergnas Professeur à la Sorbonne De son vivant, William Makepeace Thackeray a été si souvent mis en parallèle avec Charles Dickens que la petite histoire littéraire abonde en anecdotes fondées sur un chevauchement ironique de leurs noms.
- Introduction : La Corée petite péninsule située entre le géant Russe et l’ogre Chinois, à l’extrémité du continent asiatique a une histoire bien perturbée.
- Petite Histoire de la presse(1)
- Petite histoire de la subjectivité
- Cours d'histoire-géographie 2nd