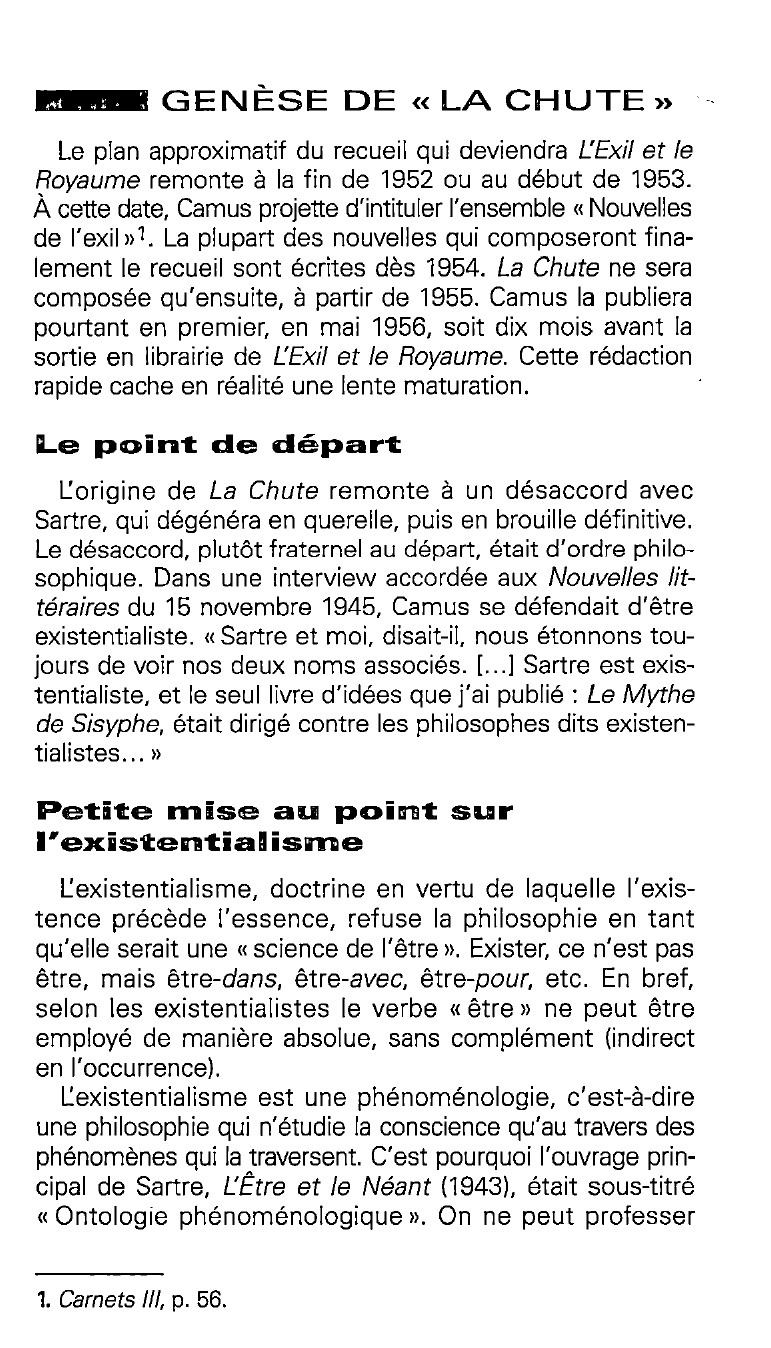Place de La Chute dans l'œuvre de Camus
Publié le 10/01/2020

Extrait du document
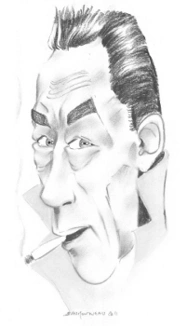
l'existentialisme : il se vérifie par un engagement quotidien dans l'existence. Pour cette raison, la littérature, présentant des personnages concrets aux prises avec des situations inspirées de la réalité, ainsi que la politique, qui exige un investissement personnel de chacun, sont, mieux que la philosophie traditionnelle, des domaines d'expression du penseur existentialiste.
À vrai dire, littérature et politique sont liées : Sartre et sa revue des Temps modernes feront beaucoup pour imposer le concept d'une littérature engagée. On ne saurait réduire la littérature engagée à ce qu'on appelait jadis la littérature à thèse : celle-ci suppose que l'écrivain a préalablement une doctrine ou des idées que son roman ou sa pièce a pour mission de refléter et de défendre. À l'inverse, l'écrivain engagé tel que le conçoit Sartre agit en écrivant son œuvre, et à mesure qu'il l'écrit, celle-ci modifie sa personnalité ou ses positions.
Pourquoi Camus n'est pas existentialiste, Sartre l'explique dans une interview donnée après la publication du Mythe de Sisyphe : « La philosophie de Camus est une philosophie de l'absurde, et l'absurde naît pour lui du rapport de l'homme et du monde, des exigences raisonnables de l'homme et de l'irrationalité du monde. Les thèmes qu'il en tire sont ceux du pessimiste classique. Il n'y a pas pour moi d'absurde au sens de scandale et de déception au sens où l'entend Camus. Ce que j'appelle absurde est une chose très différente : c'est la contingence universelle de l'être, qui est, mais qui n'est pas le fondement de son être; c'est ce qu'il y a dans l'être de donné, d’injustifiable, de toujours premier.»1 Par «contingence de l'être», il faut entendre qu'il n'y a pas de sens donné à la vie : ce qui est pourrait tout aussi bien ne pas être. Aux yeux des existentialistes, du moment que l'homme pourrait aussi bien ne pas être, il ne peut être considéré comme sa propre fin ; il doit inventer quelque chose qui le dépasse, qui constitue ce que les philosophes nomment sa transcendance. Aux yeux de Camus, au contraire, l'homme est sa propre fin.
1. Cité dans Roger Grenier. Albert Camus. Soleil et ombre, p. 112-113.
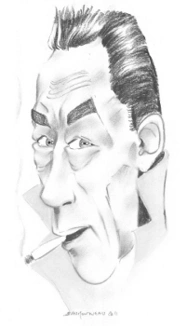
«
MW 1 GENÈSE DE« LA CHUTE»
Le plan approximatif du recueil qui deviendra /:Exil et le
Royaume remonte à la fin de 1952 ou au début de 1953.
À cette date, Camus projette d'intituler l'ensemble« Nouvelles
de l'exil»1.
La plupart des nouvelles qui composeront fina
lement le recueil sont écrites dès 1954.
La Chute ne sera
composée qu'ensuite, à partir de 1955.
Camus la publiera
pourtant en premier, en mai 1956, soit dix mois avant la
sortie en librairie de L.:Exil et le Royaume.
Cette rédaction
rapide cache en réalité une lente maturation.
!Le point de départ
L'.origine de La Chute remonte à un désaccord avec
Sartre, qui dégénéra en querelle, puis en brouille définitive.
Le désaccord, plutôt fraternel au départ, était d'ordre philo
sophique.
Dans une interview accordée aux Nouvelles lit
téraires du 15 novembre 1945, Camus se défendait d'être
existentialiste.
«Sartre et moi, disait-il, nous étonnons tou
jours de voir nos deux noms associés.
[.
..
] Sartre est exis
tentialiste, et le seul livre d'idées que j'ai publié : Le Mythe
de Sisyphe, était dirigé contre les philosophes dits existen
tialistes ...
»
Petite mise au point sur
1' exiisil::entian isme
L'.existentialisme, doctrine en vertu de laquelle l'exis
tence précède l'essence, refuse la philosophie en tant
qu'elle serait une «science de l'être».
Exister, ce n'est pas
être, mais être-dans, être-avec, être-pour, etc.
En bref,
selon les existentialistes le verbe «être» ne peut être
employé de manière absolue, sans complément (indirect
en l'occurrence).
L'.existentialisme est une phénoménologie, c'est-à-dire
une philosophie qui n'étudie la conscience qu'au travers des
phénomènes qui la traversent.
C'est pourquoi l'ouvrage prin
cipal de Sartre, /:Être et le Néant (1943).
était sous-titré
«Ontologie phénoménologique».
On ne peut professer
1.
Carnets Ill, p.
56..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- La Chute de Camus : Fiche de lecture
- CHUTE (La). Albert Camus (résumé)
- Résumé de La Chute de Camus
- CHUTE (La) Albert Camus (résumé & analyse)
- HOMME RÉVOLTÉ (L'), 1951. Albert Camus - étude de l'œuvre