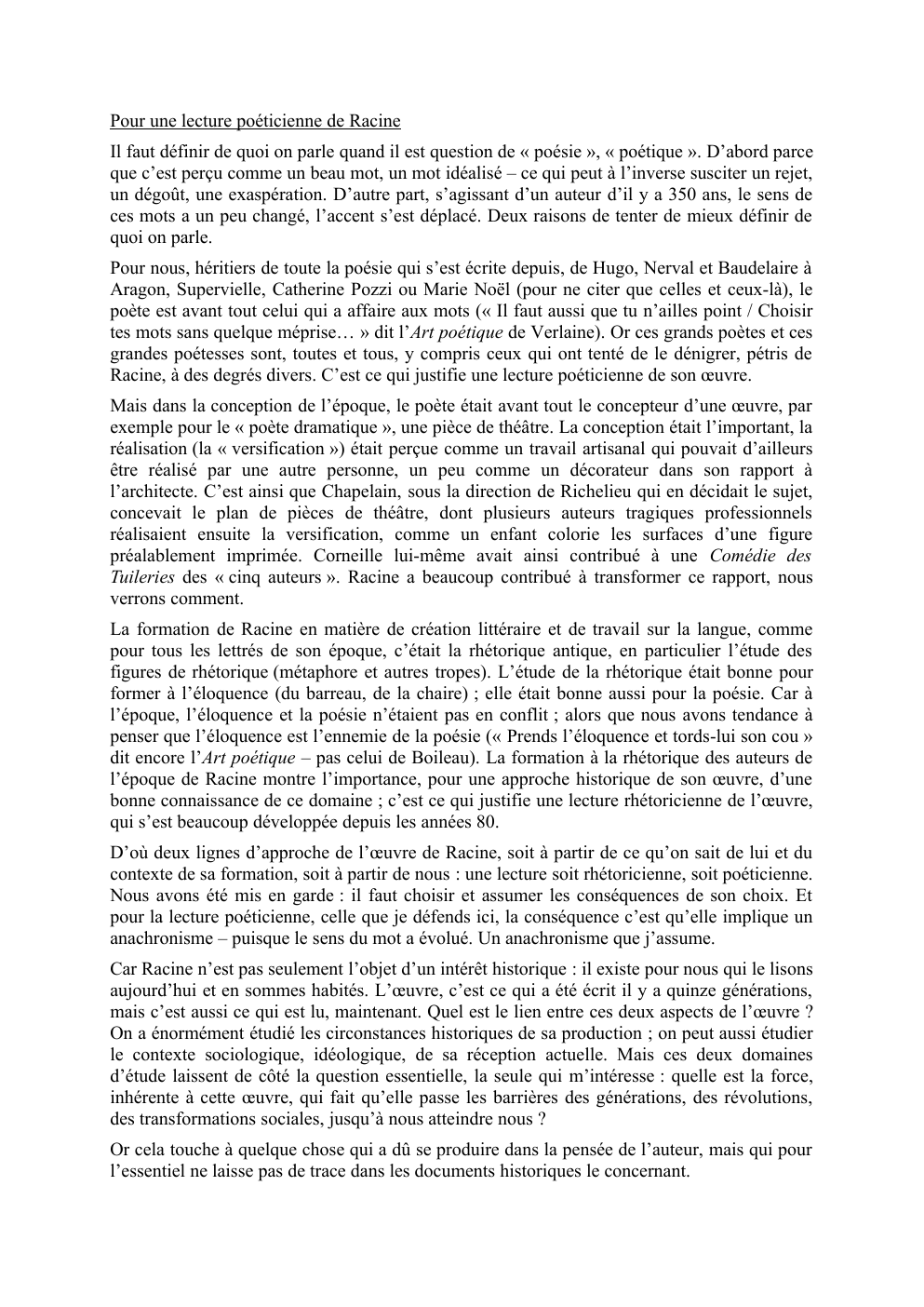Pour une lecture poéticienne de Racine
Publié le 25/12/2022
Extrait du document
«
Pour une lecture poéticienne de Racine
Il faut définir de quoi on parle quand il est question de « poésie », « poétique ».
D’abord parce
que c’est perçu comme un beau mot, un mot idéalisé – ce qui peut à l’inverse susciter un rejet,
un dégoût, une exaspération.
D’autre part, s’agissant d’un auteur d’il y a 350 ans, le sens de
ces mots a un peu changé, l’accent s’est déplacé.
Deux raisons de tenter de mieux définir de
quoi on parle.
Pour nous, héritiers de toute la poésie qui s’est écrite depuis, de Hugo, Nerval et Baudelaire à
Aragon, Supervielle, Catherine Pozzi ou Marie Noël (pour ne citer que celles et ceux-là), le
poète est avant tout celui qui a affaire aux mots (« Il faut aussi que tu n’ailles point / Choisir
tes mots sans quelque méprise… » dit l’Art poétique de Verlaine).
Or ces grands poètes et ces
grandes poétesses sont, toutes et tous, y compris ceux qui ont tenté de le dénigrer, pétris de
Racine, à des degrés divers.
C’est ce qui justifie une lecture poéticienne de son œuvre.
Mais dans la conception de l’époque, le poète était avant tout le concepteur d’une œuvre, par
exemple pour le « poète dramatique », une pièce de théâtre.
La conception était l’important, la
réalisation (la « versification ») était perçue comme un travail artisanal qui pouvait d’ailleurs
être réalisé par une autre personne, un peu comme un décorateur dans son rapport à
l’architecte.
C’est ainsi que Chapelain, sous la direction de Richelieu qui en décidait le sujet,
concevait le plan de pièces de théâtre, dont plusieurs auteurs tragiques professionnels
réalisaient ensuite la versification, comme un enfant colorie les surfaces d’une figure
préalablement imprimée.
Corneille lui-même avait ainsi contribué à une Comédie des
Tuileries des « cinq auteurs ».
Racine a beaucoup contribué à transformer ce rapport, nous
verrons comment.
La formation de Racine en matière de création littéraire et de travail sur la langue, comme
pour tous les lettrés de son époque, c’était la rhétorique antique, en particulier l’étude des
figures de rhétorique (métaphore et autres tropes).
L’étude de la rhétorique était bonne pour
former à l’éloquence (du barreau, de la chaire) ; elle était bonne aussi pour la poésie.
Car à
l’époque, l’éloquence et la poésie n’étaient pas en conflit ; alors que nous avons tendance à
penser que l’éloquence est l’ennemie de la poésie (« Prends l’éloquence et tords-lui son cou »
dit encore l’Art poétique – pas celui de Boileau).
La formation à la rhétorique des auteurs de
l’époque de Racine montre l’importance, pour une approche historique de son œuvre, d’une
bonne connaissance de ce domaine ; c’est ce qui justifie une lecture rhétoricienne de l’œuvre,
qui s’est beaucoup développée depuis les années 80.
D’où deux lignes d’approche de l’œuvre de Racine, soit à partir de ce qu’on sait de lui et du
contexte de sa formation, soit à partir de nous : une lecture soit rhétoricienne, soit poéticienne.
Nous avons été mis en garde : il faut choisir et assumer les conséquences de son choix.
Et
pour la lecture poéticienne, celle que je défends ici, la conséquence c’est qu’elle implique un
anachronisme – puisque le sens du mot a évolué.
Un anachronisme que j’assume.
Car Racine n’est pas seulement l’objet d’un intérêt historique : il existe pour nous qui le lisons
aujourd’hui et en sommes habités.
L’œuvre, c’est ce qui a été écrit il y a quinze générations,
mais c’est aussi ce qui est lu, maintenant.
Quel est le lien entre ces deux aspects de l’œuvre ?
On a énormément étudié les circonstances historiques de sa production ; on peut aussi étudier
le contexte sociologique, idéologique, de sa réception actuelle.
Mais ces deux domaines
d’étude laissent de côté la question essentielle, la seule qui m’intéresse : quelle est la force,
inhérente à cette œuvre, qui fait qu’elle passe les barrières des générations, des révolutions,
des transformations sociales, jusqu’à nous atteindre nous ?
Or cela touche à quelque chose qui a dû se produire dans la pensée de l’auteur, mais qui pour
l’essentiel ne laisse pas de trace dans les documents historiques le concernant.
Pour aborder ces questions, quel était l’équipement dont je disposais ? Je me suis appuyé sur
les textes de plusieurs auteurs en matière de théorie poétique : Yves Bonnefoy, T.S.
Eliot,
Jean Cohen ; et sur les définitions de Jakobson sur les fonctions du langage (dont la fonction
poétique).
J’ai prolongé les analyses de Bonnefoy et celles de Jakobson pour éclairer la notion
de fonction poétique, en développant le lien qui existe entre cette fonction telle qu’elle se
manifeste dans les œuvres poétiques réalisées, et cette même fonction poétique telle qu’elle
est présente dans la parole ordinaire.
Je résume très brièvement.
Pour Bonnefoy, la poésie est « une constante du fait humain (...)
aussi ancienne que la parole, et qui durera autant qu’elle ».
Car « la parole souffre d’une
contradiction intérieure elle aussi toujours la même, et que les poètes tentent de dénouer ou à
tout le moins de rendre plus supportable.
Cette contradiction ? C’est que pour penser et agir
nous avons besoin de concepts, alors que ceux-ci ne se constituent qu’en prenant appui sur
des aspects qu’ils séparent de la totalité de la chose, ce qui nous prive du plein de celle-ci au
moment même où nous exerçons sur elle cette prise.
Les concepts s’organisent en chaînes
signifiantes qui substituent une appréhension de simples schèmes à la relation antérieure
d’intimité à la chose.
Le monde s’est fait énigme, voilà ce que la poésie essaie de réparer »1.
Le propos de Bonnefoy suggère l’idée d’une nostalgie d’un état supposé d’immédiateté,
antérieur à l’instauration du langage ; un état qu’il faudrait donc situer dans le passé.
J’ai
proposé – ce dont Bonnefoy se garde bien – d’interpréter ce rapport au passé dans le sens
d’une histoire du devenir individuel, s’agissant, puisque c’est de cela qu’il est question, de
l’entrée dans la vie du langage, qui prend pour chacun des voies si différentes et chaque fois si
originales.
Il vaut la peine de le tenter2, entre autres pour souligner la dimension de jeu qui s’y
manifeste – jeu sur le son des mots, sur le retour des sons, jeu sur le rythme de ce retour des
sons, et aussi jeu sur les innombrables malentendus qui peuvent surgir à l’occasion de
l’étrange correspondance censée devoir s’établir entre des bruits faits avec la bouche et des
objets du monde.
Pourquoi dit-on que la poésie est « la parole première » ? Sans doute parce qu’elle porte la
trace des récits qui nous paraissent les plus anciens de l’humanité : « mythes, épopées,
oracles, voix des mystères et des mystiques… »3, chants rituels, formules incantatoires
accompagnant des pratiques de sorcellerie ; mais peut-être aussi parce que, pour chacun, elle
garde l’empreinte des premières étapes sur la voie de l’acquisition du langage.
Cela amène à s’interroger sur la genèse de la fonction poétique du langage, dans ses rapports
avec les autres fonctions : référentielle (communiquer sur les objets du monde), conative
(exercer une action sur l’interlocuteur), expressive (manifester un sentiment) ; dans toute
parole, ces fonctions sont impliquées et se combinent à des degrés différents (sur les six
fonctions du langage décrites par Jakobson4, je laisse ici de côté les fonctions phatique –
entretenir la relation avec l’interlocuteur – et métalinguistique – se mettre d’accord sur le
code, le sens des mots).
Dans la parole ordinaire, on ne fait pas attention aux manifestations de cette fonction poétique
du langage ; ni celui qui parle ni ceux qui la reçoivent n’y font attention.
La fonction poétique
Yves Bonnefoy, « Quelques propositions quant aux Sonnets de Shakespeare » (Shakespeare poète, Actes des
congrès de la Société française Shakespeare, 24|2007, p.
13 à 38).
2
On peut s’appuyer pour cela sur Jeu et réalité : l’espace potentiel de Donald Winnicott (Paris, Gallimard, 1975
pour le traduction française) ainsi que sur la notion d’accordage précoce, selon les développements dus à Daniel
Stern (Le Monde interpersonnel du nourrisson, Paris, PUF, 2003).
3
Les volumes de la collection de poésie Orphée (éditeur E.L.A.
La Différence) portent chaque fois, sur la
quatrième de couverture, un court texte définissant les objectifs de la collection, et commençant par les mots
« La poésie est la première parole ».
4
Roman Jakobson, Essais de linguistique générale, Paris, Minuit, 1963, rééd.
Seuil, Points, 1970
1
peut toutefois être perceptible quand elle se manifeste par telle manière de dire plutôt que telle
autre, plus ou moins équivalente quant aux autres fonctions.
C’est la présence de cette
fonction poétique de la parole qui fait que chacun parle d’une manière qui lui est propre, tout
en respectant les règles qui font que sa parole peut être reçue par les autres membres de la
communauté à laquelle il appartient.
La fonction poétique se manifeste donc par le fait que
c’est quelqu’un, de bien identifié, dont on reconnaît la voix, lui ou elle et pas un ou une autre,
qui parle.
Mais encore une fois, la plupart du temps, cette fonction du langage passe
inaperçue.
Il me semble que, pour la percevoir, il faut être amoureux de celui ou celle qui parle.
L’amoureux trouve un charme unique dans la parole de l’aimé(e), dans sa voix, dans la
moindre des inflexions de sa parole ; je suis amené à penser qu’en percevant ce charme qu’il
est seul à connaître, en fait il voit juste : il y a dans la parole de l’aimé, du fait que s’y exerce
la fonction poétique, un charme unique.
Comme d’ailleurs dans toute parole ! Mais seul
l’amoureux connaît ce charme.
L’amour trompe : il fait voir dans l’autre quelque chose qui
appartient à l’amoureux lui-même (éventuellement sous forme de ce qui lui manque et que
l’autre vient merveilleusement combler ; or ce manque, ainsi que l’impression que l’autre
vient si parfaitement le combler, lui appartiennent à lui), mais il croit le découvrir chez l’objet
aimé : reconnaissance et méconnaissance à la fois.
Mais là où l’amour ne trompe pas, c’est
qu’il fait percevoir, dans la parole de l’aimé, sous forme de ce charme unique, la présence de
cette fonction poétique qu’autrement on ne perçoit pas : il en résulte une connaissance
intuitive, qui n’est pas de nature scientifique, mais qui n’en est pas moins une vraie
connaissance, et que l’amoureux est seul à détenir.
Mais là où il se trompe encore, c’est qu’il
croit que ce qu’il perçoit est exclusivement propre à l’aimé – et finalement à lui-même
puisqu’il a le bonheur exclusif de percevoir ce charme chez l’autre, qui de son côté semble ne
rien en savoir.
La fonction poétique se manifeste par tout ce qui, dans la parole, n’est pas communication,
expression, action exercée sur l’interlocuteur, qui en sont les buts apparents ; en même temps,
elle ne se manifeste pas indépendamment de ces objectifs de la parole, elle leur est toujours
associée.
Elle apparaît donc comme une sorte de halo ou d’enveloppe autour des mots
prononcés, qui donne à la parole de chaque individu son caractère particulier, sa voix unique
et immédiatement reconnaissable.
Or cette enveloppe ou halo par où s’exerce la fonction
poétique porte la trace, la séquelle, de la période de la vie où la correspondance entre sons
émis et objets du monde n’est pas encore pleinement établie, est incertaine, où la fonction
référentielle se met en place par tâtonnements.
D’où le fait que la fonction poétique peut se
jouer des malentendus, des fausses routes de cette correspondance, et s’enrichir de tout ce que
la fonction référentielle laisse de côté.
La fonction conative, elle, est par contre d’emblée et
constamment présente, et avec elle la fonction expressive, puisque le cri, les larmes, servent à
ce que le parent nourricier apporte l’apaisement au mal de l’enfant.
Mais la fonction poétique garde aussi de cette période (ou d’une période plus ancienne
encore) le sens du rythme.
Car c’est celle où s’effectue l’accordage premier, entre le rythme
des sons de l’enfant et ceux du parent nourricier ; rythme du retour des sons ; rythme du
bercement.
Pourquoi ce besoin de répétition ? Cela doit avoir son origine dans le fait que,
dans le bercement, il y a un mouvement : on quitte une position initiale, mais on y revient,
inlassablement (sinon cela signifierait que le parent jette l’enfant loin de lui).
Et ce
mouvement s’accompagne de sons, répétitifs eux aussi.
Cette unité initiale du couple enfant-parent est destinée à être dissoute et remplacée par
d’autres modalités de relation ; cette dissolution prend chaque fois des voies différentes,
marquées par des ruptures plus ou moins traumatiques ; de même que les chemins qui mènent
à l’instauration du langage conceptuel sont chaque fois uniques (comme on le perçoit
lorsqu’on est en relation avec des enfants d’avant l’âge scolaire ou préscolaire).
Cette origine
de la fonction poétique dans les premières manifestations de son exercice est aussi ce qui fait
que le charme perçu chez l’ami par l’amoureux est lui aussi, par nature et par principe,
unique : ici encore, la perception de l’amoureux est juste : elle tient à ce que le chemin de
l’entrée dans la vie du langage est chaque fois originale.
La fonction poétique garde la trace de son origine, d’où une dimension de jeu gratuit en ce
sens qu’elle reste indifférente, ou du moins ne se plie pas strictement, à l’obligation de
correspondance entre sons et objets du monde que veut imposer la fonction référentielle ; elle
joue avec les imprécisions, les ratés de cette....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Fiche de lecture : RACINE ET SHAKESPEARE de Stendhal
- Fiche de lecture : PLAIDEURS (Les) de Jean Racine
- Fiche de lecture : PHÈDRE de Jean Racine
- BAJAZET de Jean Racine (fiche de lecture et critique)
- BÉRÉNICE de Jean Racine (fiche de lecture et critique)