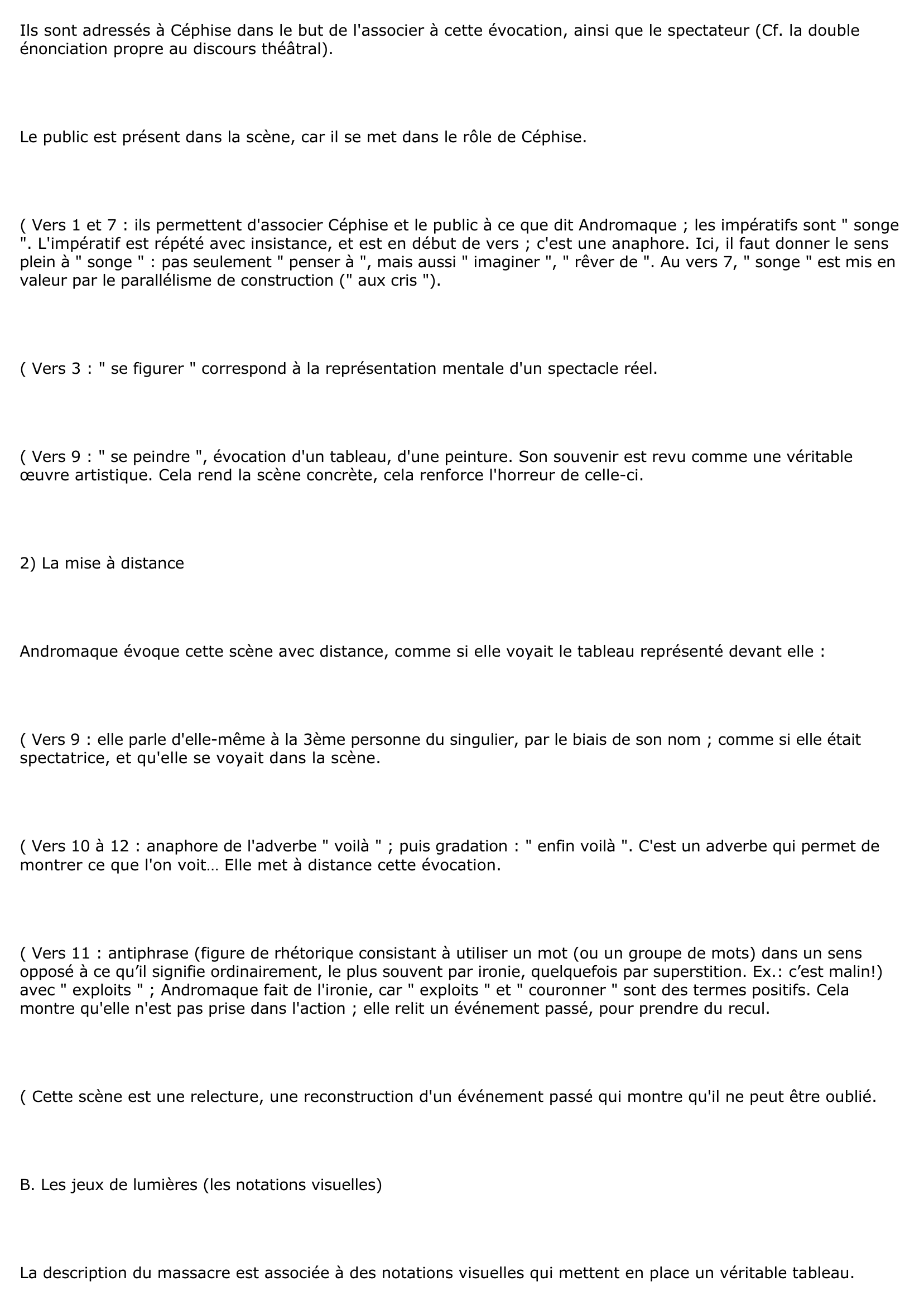RACINE, AndromaqueActe III, scène 8
Publié le 17/01/2022

Extrait du document
Plan : I) La puissance évocatrice de la parole A. La reconstruction du souvenir 1) Les impératifs adressés à Céphise 2) La mise à distance B. Les jeux de lumières (les notations visuelles) C. Le registre pathétique II) La crise tragique : une délibération suspendue A. Les étapes de la délibération 1) Vers 13-14 : ne pas céder à Pyrrhus 2) Vers 41 et 43 : " Allons trouver Pyrrhus "
«
Ils sont adressés à Céphise dans le but de l'associer à cette évocation, ainsi que le spectateur (Cf.
la doubleénonciation propre au discours théâtral).
Le public est présent dans la scène, car il se met dans le rôle de Céphise.
( Vers 1 et 7 : ils permettent d'associer Céphise et le public à ce que dit Andromaque ; les impératifs sont " songe".
L'impératif est répété avec insistance, et est en début de vers ; c'est une anaphore.
Ici, il faut donner le sensplein à " songe " : pas seulement " penser à ", mais aussi " imaginer ", " rêver de ".
Au vers 7, " songe " est mis envaleur par le parallélisme de construction (" aux cris ").
( Vers 3 : " se figurer " correspond à la représentation mentale d'un spectacle réel.
( Vers 9 : " se peindre ", évocation d'un tableau, d'une peinture.
Son souvenir est revu comme une véritableœuvre artistique.
Cela rend la scène concrète, cela renforce l'horreur de celle-ci.
2) La mise à distance
Andromaque évoque cette scène avec distance, comme si elle voyait le tableau représenté devant elle :
( Vers 9 : elle parle d'elle-même à la 3ème personne du singulier, par le biais de son nom ; comme si elle étaitspectatrice, et qu'elle se voyait dans la scène.
( Vers 10 à 12 : anaphore de l'adverbe " voilà " ; puis gradation : " enfin voilà ".
C'est un adverbe qui permet demontrer ce que l'on voit… Elle met à distance cette évocation.
( Vers 11 : antiphrase (figure de rhétorique consistant à utiliser un mot (ou un groupe de mots) dans un sensopposé à ce qu’il signifie ordinairement, le plus souvent par ironie, quelquefois par superstition.
Ex.: c’est malin!)avec " exploits " ; Andromaque fait de l'ironie, car " exploits " et " couronner " sont des termes positifs.
Celamontre qu'elle n'est pas prise dans l'action ; elle relit un événement passé, pour prendre du recul.
( Cette scène est une relecture, une reconstruction d'un événement passé qui montre qu'il ne peut être oublié.
B.
Les jeux de lumières (les notations visuelles)
La description du massacre est associée à des notations visuelles qui mettent en place un véritable tableau..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Dénouement de Bérénice. Comparer la scène III de l'acte V de la Bérénice, de Racine et la scène V de l’acte V de Tite et Bérénice, de Corneille.
- Acte III, scène 6 de Phèdre de Jean Racine (résumé et commentaire)
- Acte III, scène 5Acte III, scène 4 de Phèdre de Jean Racine (résumé et commentaire)
- Acte III, scène 4 de Phèdre de Jean Racine (résumé et commentaire)
- Acte III, scène 3 de Phèdre de Jean Racine (résumé et commentaire)