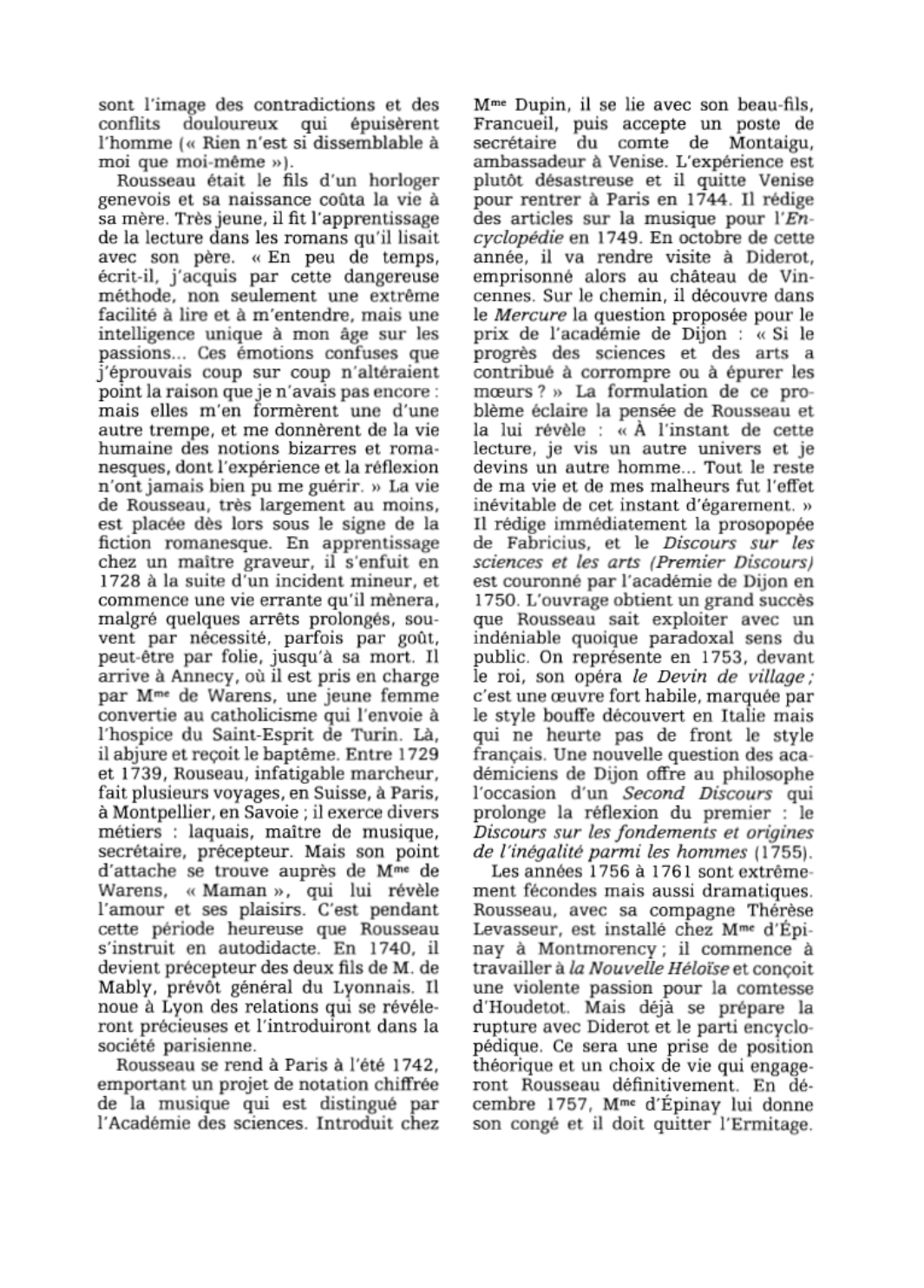ROUSSEAU (Jean Jacques)
Publié le 10/05/2019
Extrait du document

ROUSSEAU (Jean Jacques), écrivain et philosophe français (Genève 1712-Ermenonville 1778). Au Panthéon répu blicain, nulle ombre ne s'est vu accorder de place plus centrale que celle de Rousseau ; aucune pensée ne fut plus détestée que la sienne par les adversaires de la République. Le « Citoyen », inventeur de la liberté, est rendu responsable de la Terreur, voire du totalitarisme. Lui qui chercha à être sincère, jusqu'à la provocation, qui voulut enfin être soi-même, élargissant sans relâche la sphère du sujet, il est victime de la calomnie, de la suspicion et de la légende qu'il a contribué à construire. Mais, si la réception de l’œuvre et sa fortune sont organisées par ces paradoxes, c'est qu'ils sont l'image des contradictions et des conflits douloureux qui épuisèrent l'homme (« Rien n'est si dissemblable à moi que moi-même »).
Rousseau était le fils d'un horloger genevois et sa naissance coûta la vie à sa mère. Très jeune, il fit l'apprentissage de la lecture dans les romans qu'il lisait avec son père. « En peu de temps, écrit-il, j'acquis par cette dangereuse méthode, non seulement une extrême facilité à lire et à m'entendre, mais une intelligence unique à mon âge sur les passions... Ces émotions confuses que j'éprouvais coup sur coup n'altéraient point la raison que je n'avais pas encore : mais elles m'en formèrent une d'une autre trempe, et me donnèrent de la vie humaine des notions bizarres et romanesques, dont l'expérience et la réflexion n’ont jamais bien pu me guérir. » La vie de Rousseau, très largement au moins, est placée dès lors sous le signe de la fiction romanesque. En apprentissage chez un maître graveur, il s'enfuit en 1728 à la suite d'un incident mineur, et commence une vie errante qu'il mènera, malgré quelques arrêts prolongés, souvent par nécessité, parfois par goût, peut-être par folie, jusqu'à sa mort. Il arrive à Annecy, où il est pris en charge par Mme de Warens, une jeune femme convertie au catholicisme qui l'envoie à l'hospice du Saint-Esprit de Turin. Là, il abjure et reçoit le baptême. Entre 1729 et 1739, Rouseau, infatigable marcheur, fait plusieurs voyages, en Suisse, à Paris, à Montpellier, en Savoie ; il exerce divers métiers : laquais, maître de musique, secrétaire, précepteur. Mais son point d'attache se trouve auprès de Mm« de Warens, « Maman », qui lui révèle l'amour et ses plaisirs. C'est pendant cette période heureuse que Rousseau s'instruit en autodidacte. En 1740, il devient précepteur des deux fils de M. de Mably, prévôt général du Lyonnais. Il noue à Lyon des relations qui se révéleront précieuses et l'introduiront dans la société parisienne.
Rousseau se rend à Paris à l'été 1742, emportant un projet de notation chiffrée de la musique qui est distingué par T Académie des sciences. Introduit chez
Mme Dupin, il se lie avec son beau-fils, Francueil, puis accepte un poste de secrétaire du comte de Montaigu, ambassadeur à Venise. L'expérience est plutôt désastreuse et il quitte Venise pour rentrer à Paris en 1744. Il rédige des articles sur la musique pour VEncyclopédie en 1749. En octobre de cette année, il va rendre visite à Diderot, emprisonné alors au château de Vin-cennes. Sur le chemin, il découvre dans le Mercure la question proposée pour le prix de l'académie de Dijon : « Si le progrès des sciences et des arts a contribué à corrompre ou à épurer les mœurs ?» La formulation de ce problème éclaire la pensée de Rousseau et la lui révèle : « À l'instant de cette lecture, je vis un autre univers et je devins un autre homme... Tout le reste de ma vie et de mes malheurs fut l'effet inévitable de cet instant d'égarement. » Il rédige immédiatement la prosopopée de Fabricius, et le Discours sur les sciences et les arts (Premier Discours) est couronné par l’académie de Dijon en 1750. L'ouvrage obtient un grand succès que Rousseau sait exploiter avec un indéniable quoique paradoxal sens du public. On représente en 1753, devant le roi, son opéra le Devin de village; c’est une œuvre fort habile, marquée par le style bouffe découvert en Italie mais qui ne heurte pas de front le style français. Une nouvelle question des aca démiciens de Dijon offre au philosophe l'occasion d'un Second Discours qui prolonge la réflexion du premier : le Discours sur les fondements et origines de l'inégalité parmi les hommes (1755).
Les années 1756 à 1761 sont extrême ment fécondes mais aussi dramatiques. Rousseau, avec sa compagne Thérèse Levasseur, est installé chez Mme d'Épi nay à Montmorency ; il commence à travailler à la Nouvelle Héloïse et conçoit une violente passion pour la comtesse d’Houdetot. Mais déjà se prépare la rupture avec Diderot et le parti encyclopédique. Ce sera une prise de position théorique et un choix de vie qui engageront Rousseau définitivement. En décembre 1757, Mme d'Épinay lui donne son congé et il doit quitter l'Ermitage.
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- TEXTE D’ETUDE : Jean-Jacques Rousseau, Emile ou De l’Education, 1762, chapitre III
- Le due memorie di Jean-Jacques Rousseau
- Julie ou la Nouvelle Héloïse de Jean-Jacques Rousseau
- DISCOURS SUR LES SCIENCES ET LES ARTS, 1750. Jean-Jacques Rousseau - résumé de l'œuvre
- Confessions (les) de jean-Jacques Rousseau (résume et analyse complète)