VERHAEREN (Émile)
Publié le 21/05/2019

Extrait du document
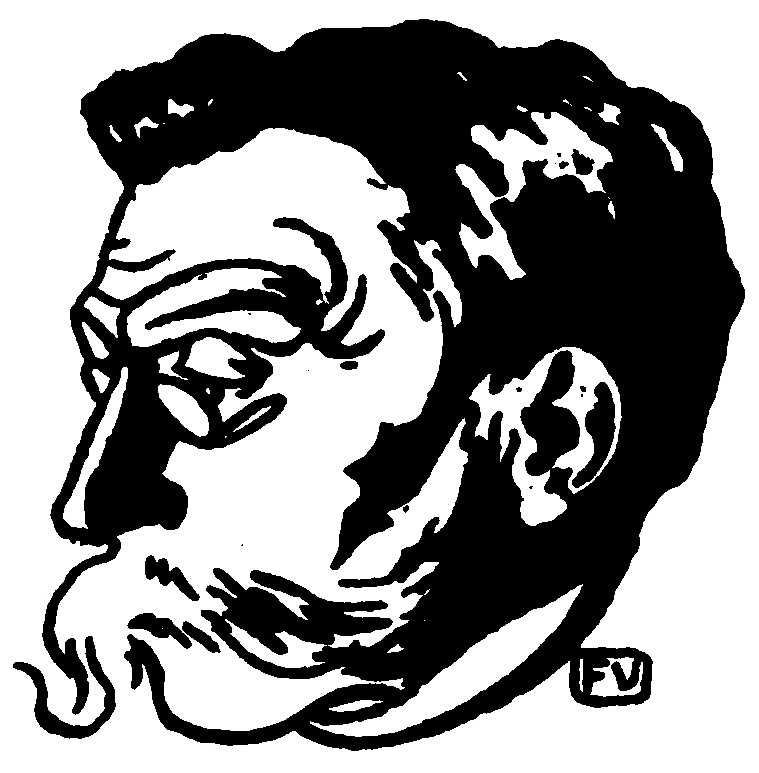
VERHAEREN (Émile), écrivain belge d'expression française (Sint-Amands 1855 - Rouen 1916). Après une enfance passée dans la plaine flamande, au bord de l'Escaut, il fit ses études secondaires au collège Sainte-Barbe à Gand, où il se lia d'amitié avec Georges Rodenbach. Docteur en droit de l'université de Louvain, avocat stagiaire chez Edmond Picard, il délaissa très vite le barreau pour se consacrer entièrement à la
littérature. Collaborateur à l'Art moderne de Picard et à la Jeune Belgique de Max Waller, il fréquenta Ensor, Rops et Van Rysselberghe et publia ses premiers recueils de poèmes (les Flamandes, 1883 ; les Moines, 1886) fortement tributaires de l'esthétique parnassienne. Une crise morale, qu'aggrava la mort de ses parents et qui dura jusqu'à la rencontre, quelques années plus tard, de sa future femme, le peintre Marthe Massin, l'amena à la composition d'une poésie d'inspiration mélancolique, souvent hantée par le désespoir, voire par le spectre de la folie, mais où la tendance encore très descriptive des livres précédents fait place à un vers beaucoup plus visionnaire (les Soirs, 1887 ; les Débâcles, 1888 ; les Flambeaux noirs, 1891). Si, par les thèmes qu'ils pratiquent, ces recueils doivent beaucoup au symbolisme, l'expression y est devenue très personnelle, elle s'est dotée de rythmes particuliers et d'une virtuosité verbale qui ne craignent ni le néologisme ni l'originalité de l'image. Au sortir de cette période dépressive (« Fermons la porte du cloaque, écrit-il, et revenons vers la vie »), le poète se tourne peu à peu vers le spectacle des innombrables transformations qu'entraîne la révolution industrielle, qu'il s'agisse du déclin du vieux monde des campagnes (les Campagnes hallucinées, 1893 ; les Villages illusoires, 1895), ou du gigantisme de la cité moderne au sein de laquelle il voit l'avenir se forger (les Villes tentaculaires, 1895). Il a lu Walt Whitman qu'il admire, partage les idéaux socialisants de son ancien maître Picard et exalte, dans une vision panthéiste, une société de demain où l’homme dominera la planète et ses énergies fabuleuses. Célébrant le dynamisme et l'enthousiasme, il brasse les rythmes et les images avec un lyrisme prophétique aux résonances souvent expressionnistes. Sa première pièce de théâtre, les Aubes (1899), évoque cette naissance d'une ère inédite que chantent de nombreux recueils (les Visages de la vie, 1899 ; les Forces tumultueuses, 1902 ; la Multiple Splendeur, 1908 ; les Rythmes souverains, 1910). Installé à Saint-Cloud
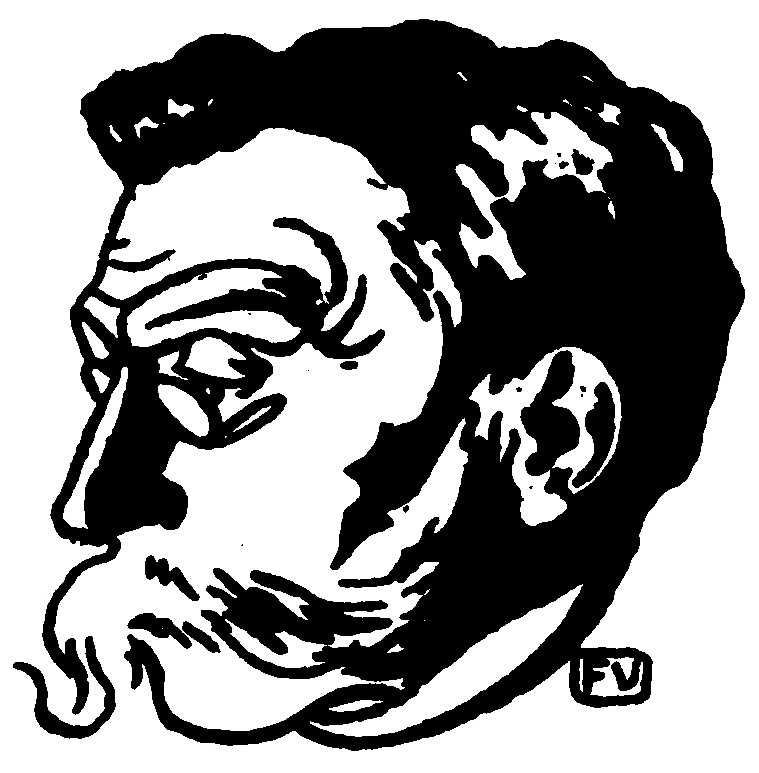
«
(1899),
il passe tous les étés au « Caillou
q ui-bi qu e », une maisonnette de Roisin,
cachée dans la verdure, en tre Mons et
Valenciennes.
Devenu célèbre, il voyage,
donne des conférences, reçoit de nom
breux visiteurs, dont Stefan Zweig, qui
écrivit sur lui un livre vibrant d'admir a
tion.
D'autres pièces voient le jour, d'une
théâtralité sans doute peu ori ginale mais
où su bsi sten t encore certaines hantises :
le Cloitre (1900), que Lugné-Poe monta
au théâtre de l'Œuvre, Philippe Il ( 190 1),
repr ésen té dans le même théâtre, Hélène
de Sparte (1912).
S'il se con sa cre égale
ment à la critique d'art (Rembrandt,
1905 ; James Ensor, 1908 ; Pierre-Paul
Rubens, 1910), c'est à la poésie qu'il
continue à donn er le meilleur de lui
même : tout en chantant l'ère nouvelle,
il consacre à sa terre nat al e, de !904 à
1911.
cinq recueils rassemblés sous le
titre Toute la Flandre, où il célèbre Je
paysage de l'Escaut avec la fuite du
fleuve ver s J'ailleurs infini, les plages de
la mer du Nord, les larges plai nes qui
entourent les Villes à pignons (1910) et
leurs héros légendaires, tandis que les
Heures claires (1896), les Heures
d'a près-midi ( 1905) et les Heures du soir
( 1911) évoquent longuement le bonheur
d 'aimer et la jo ie prof ond e et paisible de
la vie du couple.
Son ton et ses rythmes
s e sont as sag is , il a renoncé peu à peu
aux audaces stylistiques et aux tours
trop expressionnistes, et apporte à la
réédition des recueils de sa « péri ode
noire >l, ou des premiers livres exaltant
la transformation du monde, des correc
tions à cet égard significatives.
La guerre
et l'invasion de la Belgique trouvent en
lui un témoin désolé et indigné (la
Belgique sanglante, 1915; les Ailes rou
ges de la guerre, 1916).
qui visite le front
de l'Yser et se dépense pour sa pa tri e
occupée.
Il mourra tragiquement, écrasé
par un train en gare de Rouen.
Onze ans
plus tard, en 1927, son corps sera
ramené à Sint-Amands, au bord de cet
Escaut don t il avait été le chantre et dont
l e paysage avait tant nourri son
imaginaire..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- VILLES TENTACULAIRES (les) d'Émile Verhaeren (résumé & analyse)
- VILLES TENTACULAIRES (les) d'Émile Verhaeren
- VILLES TENTACULAIRES (Les) d'Émile Verhaeren : Fiche de lecture
- FORCES TUMULTUEUSES (Les). d’Émile Verhaeren (résumé et analyse)
- HEURES CLAIRES (Les) d’Émile Verhaeren

































