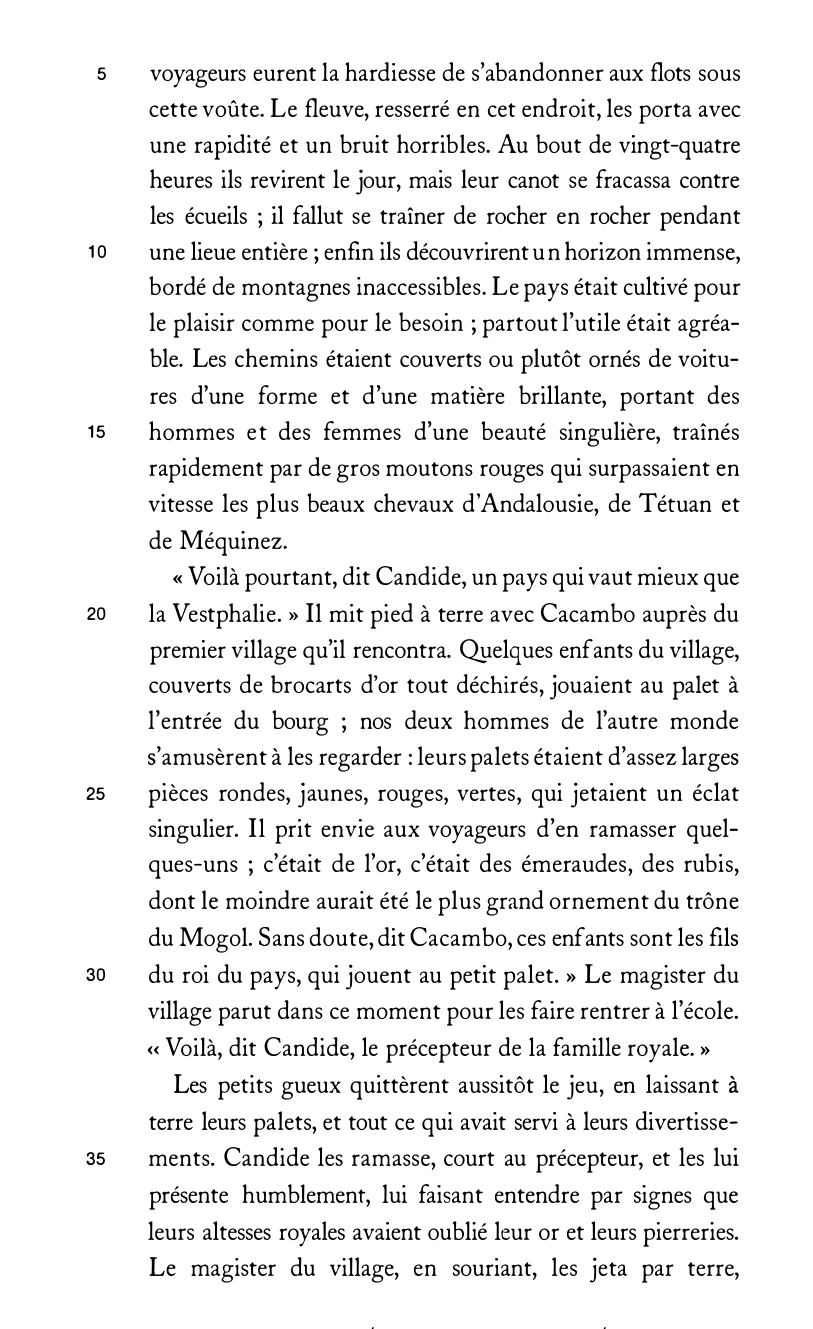Voltaire, Candide, chapitre 17 (commentaire)
Publié le 06/10/2018
Extrait du document

Ceux-ci sont entraînés dans une longue navigation, qui les éloigne peu à peu du monde des hommes. L’accumulation initiale (« entre des bords tantôt fleuris, tantôt arides, tantôt unis, tantôt escarpés ») marquée par les antithèses souligne la longueur du trajet effectué. Le jeu des temps le montre aussi : on passe du passé simple, qui souligne le moment initial du voyage, à l’imparfait « s’élargissait ”, à valeur durative, accompagné par l’adverbe « toujours ”, puis repris par « enfin elle se perdait ». Les indications spatiales sont redoublées par les indications temporelles \" au bout de vingt-quatre heures\". L’éloignement est accentué par le thème de la grotte traversée au fil du courant, que l’on retrouve dans Les Mile et une Nuits, dans l’histoire de Sindbad le marin. Le terme « voûte » est ainsi repris à plusieurs reprises (« une voûte de rochers épouvantables ”, sous cette voûte »). C’est d’ailleurs lors de la rencontre avec la caverne qu’apparaît le thème du danger, autre façon de souligner que le pays est inaccessible. Les hyperboles « la rivière s’élargissait toujours ”, « une voûte de rochers épouvantables qui s’élevaient jusqu’au ciel » renforcent le caractère merveilleux de l’aventure. Le narrateur nous invite à partager l’effroi des personnages. Le champ lexical de l’effrayant est alors omniprésent : les « rochers épouvantables » effraient puisqu’il faut avoir de la « hardiesse » pour les affronter, le courant les porte avec « une rapidité et un bruit horribles \", c’est-à-dire qui provoque l’effroi (comme l’indique l’étymologie latine horribilis).
Candide est écrit en 1759, et il s’inscrit dans la série des contes philosophiques (Micromégas, Zadig) qui permettent à Voltaire d’exprimer ses idées. En effet, le conte philosophique est un conte divertissant, qui comporte une histoire brève et une accumulation de péripéties et parfois du merveilleux. C’est aussi, comme le dit Voltaire à propos de Zadig, « un petit morceau de philosophie allégorique » ; une vérité se cache derrière le récit, et sous une apparence légère, le conteur aborde les sujets les plus ardus : le bonheur de l’homme, l’existence du mal dans le monde, la relativité... Le conte philosophique veut donc apprendre et faire réfléchir. Dans Candide, le héros éponyme très naïf apprend au cours de ses voyages que son maître qui prétend que tout est bien ne connaît rien à la réalité du monde, où souvent les hommes sont méchants. Candide a dû ainsi affronter la guerre, le fanatisme, l’égoïsme, et il se trouve à ce moment-ci en Amérique, avec son fidèle serviteur Cacambo, confrontés à de nouveaux ennemis. Le passage suivant nous présente l’arrivée de Candide et de Cacambo au pays d’Eldorado, après leur dangereux trajet en barque. Ce texte présente manifestement une utopie, un pays de nulle part, où tout échappe aux lois du monde qu’a appris à connaître Candide. Cela signifie-t-il que nous sommes coupés du réel que dénonçait Voltaire dans tout le conte ou plutôt que, dans cette antithèse au monde réel hostile, l’auteur propose une nouvelle critique de celui-ci ? Pour répondre à cette question, nous verrons dans un premier temps comment il s’agit d’un pays nettement coupé du monde réel. Puis nous étudierons la mise en scène de ce pays utopique, pour nous interroger enfin sur la leçon que ce pays donne à Candide, Cacambo et le lecteur.
Voltaire présente ici un mythe très connu à l’époque, le fabuleux pays de l’Eldorado, à la richesse immense qu’espéraient découvrir les conquistadors Voltaire s’inspire aussi de conte merveilleux, que Les Mile et une Nuits traduites par Galland en 1704 ont mis à la mode.
Le narrateur qui prend en charge le récit des aventures de Candide propose tout d’abord au lecteur de contempler le voyage dangereux

«
5
voyageurs eurent la har diesse de s'abandonner aux flots sous
cette voûte.
Le fleuve, resserré en cet endroit, les porta avec
une rapidité et un bruit horribles.
Au bout de vingt-quatre
heures ils revirent le jour, mais leur canot se fracassa contre
les écueils ; il fallut se traîner de rocher en rocher pendant
10 une lieue entière ; enfin ils découvrirent un horizon immense,
bo rdé de mo ntagnes inaccessibles.
Le pays était cultivé pour
le plaisir comme pour le besoin ; partout l'utile était agréa
ble.
Les chemins étaient couverts ou plutôt ornés de voitu
res d'une forme et d'une matière brillante, portant des
15 hommes et des femmes d'une beauté singulière, traînés
ra pidement par de gros moutons rouges qui surpassaient en
vit esse les plus beaux chevaux d'Andal ousie, de Tétuan et
de Méq uinez.
>Il mit pied à terre avec Cacambo auprès du
premier village qu'il rencontra.
Qyelques enfants du village,
couverts de broca rts d'or tout déchir és, jouaient au palet à
l'e ntrée du bourg ; nos deux hommes de l'autre monde
s'amusèrent à les regarder : leurs palets étaient d'assez larges
25 pièces rondes, jaunes, rouges, verte s, qui jetaient un éclat
singulier.
Il prit envie aux voyageurs d'en ramasser quel
que s-uns ; c'était de l'or, c'était des émer audes, des rubis,
dont le moi ndre aurait été le plus grand ornement du trône
du Mogol.
Sans doute, dit Cacambo, ces enfants sont les fils
30 du roi du pays, qui jouent au petit palet.
» Le magister du
village parut dans ce moment pour les faire rentrer à l'école..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Chapitre 19 de Candide de Voltaire (commentaire)
- Commentaire chapitre 3 de Candide de Voltaire
- Commentaire de Candide Voltaire chapitre 3
- Commentaire du chapitre 1 de Candide de Voltaire
- Commentaire littéraire de Candide de Voltaire, Chapitre 3