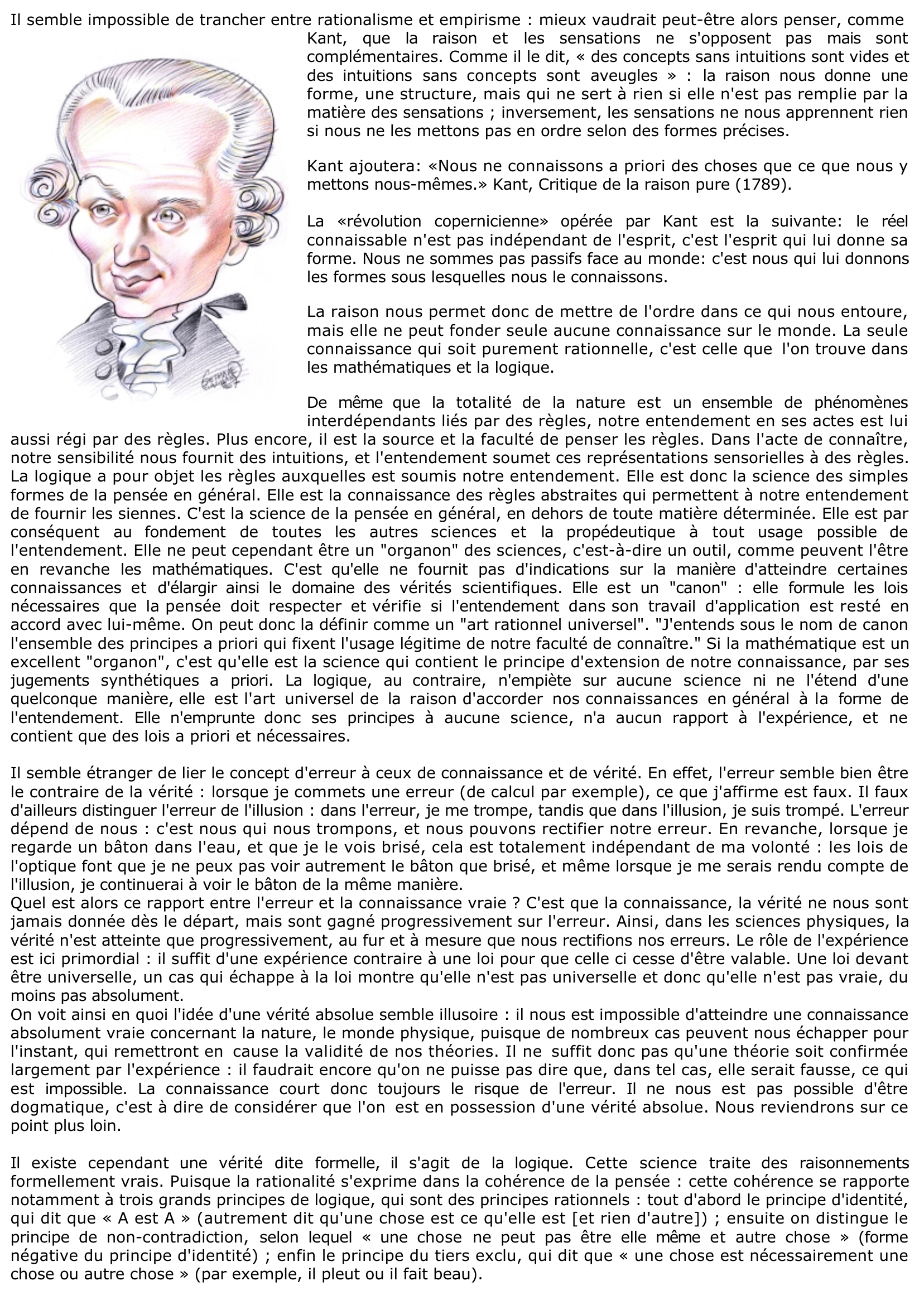A quelle vérité la raison nous mène-t-elle ?
Publié le 27/02/2008

Extrait du document
«
Il semble impossible de trancher entre rationalisme et empirisme : mieux vaudrait peut-être alors penser, comme Kant, que la raison et les sensations ne s'opposent pas mais sontcomplémentaires.
Comme il le dit, « des concepts sans intuitions sont vides etdes intuitions sans concepts sont aveugles » : la raison nous donne uneforme, une structure, mais qui ne sert à rien si elle n'est pas remplie par lamatière des sensations ; inversement, les sensations ne nous apprennent riensi nous ne les mettons pas en ordre selon des formes précises.
Kant ajoutera: «Nous ne connaissons a priori des choses que ce que nous ymettons nous-mêmes.» Kant, Critique de la raison pure (1789).
La «révolution copernicienne» opérée par Kant est la suivante: le réelconnaissable n'est pas indépendant de l'esprit, c'est l'esprit qui lui donne saforme.
Nous ne sommes pas passifs face au monde: c'est nous qui lui donnonsles formes sous lesquelles nous le connaissons.
La raison nous permet donc de mettre de l'ordre dans ce qui nous entoure,mais elle ne peut fonder seule aucune connaissance sur le monde.
La seuleconnaissance qui soit purement rationnelle, c'est celle que l'on trouve dansles mathématiques et la logique.
De même que la totalité de la nature est un ensemble de phénomènesinterdépendants liés par des règles, notre entendement en ses actes est lui aussi régi par des règles.
Plus encore, il est la source et la faculté de penser les règles.
Dans l'acte de connaître,notre sensibilité nous fournit des intuitions, et l'entendement soumet ces représentations sensorielles à des règles.La logique a pour objet les règles auxquelles est soumis notre entendement.
Elle est donc la science des simplesformes de la pensée en général.
Elle est la connaissance des règles abstraites qui permettent à notre entendementde fournir les siennes.
C'est la science de la pensée en général, en dehors de toute matière déterminée.
Elle est parconséquent au fondement de toutes les autres sciences et la propédeutique à tout usage possible del'entendement.
Elle ne peut cependant être un "organon" des sciences, c'est-à-dire un outil, comme peuvent l'êtreen revanche les mathématiques.
C'est qu'elle ne fournit pas d'indications sur la manière d'atteindre certainesconnaissances et d'élargir ainsi le domaine des vérités scientifiques.
Elle est un "canon" : elle formule les loisnécessaires que la pensée doit respecter et vérifie si l'entendement dans son travail d'application est resté enaccord avec lui-même.
On peut donc la définir comme un "art rationnel universel".
"J'entends sous le nom de canonl'ensemble des principes a priori qui fixent l'usage légitime de notre faculté de connaître." Si la mathématique est unexcellent "organon", c'est qu'elle est la science qui contient le principe d'extension de notre connaissance, par sesjugements synthétiques a priori.
La logique, au contraire, n'empiète sur aucune science ni ne l'étend d'unequelconque manière, elle est l'art universel de la raison d'accorder nos connaissances en général à la forme del'entendement.
Elle n'emprunte donc ses principes à aucune science, n'a aucun rapport à l'expérience, et necontient que des lois a priori et nécessaires.
Il semble étranger de lier le concept d'erreur à ceux de connaissance et de vérité.
En effet, l'erreur semble bien êtrele contraire de la vérité : lorsque je commets une erreur (de calcul par exemple), ce que j'affirme est faux.
Il fauxd'ailleurs distinguer l'erreur de l'illusion : dans l'erreur, je me trompe, tandis que dans l'illusion, je suis trompé.
L'erreurdépend de nous : c'est nous qui nous trompons, et nous pouvons rectifier notre erreur.
En revanche, lorsque jeregarde un bâton dans l'eau, et que je le vois brisé, cela est totalement indépendant de ma volonté : les lois del'optique font que je ne peux pas voir autrement le bâton que brisé, et même lorsque je me serais rendu compte del'illusion, je continuerai à voir le bâton de la même manière.Quel est alors ce rapport entre l'erreur et la connaissance vraie ? C'est que la connaissance, la vérité ne nous sontjamais donnée dès le départ, mais sont gagné progressivement sur l'erreur.
Ainsi, dans les sciences physiques, lavérité n'est atteinte que progressivement, au fur et à mesure que nous rectifions nos erreurs.
Le rôle de l'expérienceest ici primordial : il suffit d'une expérience contraire à une loi pour que celle ci cesse d'être valable.
Une loi devantêtre universelle, un cas qui échappe à la loi montre qu'elle n'est pas universelle et donc qu'elle n'est pas vraie, dumoins pas absolument.On voit ainsi en quoi l'idée d'une vérité absolue semble illusoire : il nous est impossible d'atteindre une connaissanceabsolument vraie concernant la nature, le monde physique, puisque de nombreux cas peuvent nous échapper pourl'instant, qui remettront en cause la validité de nos théories.
Il ne suffit donc pas qu'une théorie soit confirméelargement par l'expérience : il faudrait encore qu'on ne puisse pas dire que, dans tel cas, elle serait fausse, ce quiest impossible.
La connaissance court donc toujours le risque de l'erreur.
Il ne nous est pas possible d'êtredogmatique, c'est à dire de considérer que l'on est en possession d'une vérité absolue.
Nous reviendrons sur cepoint plus loin.
Il existe cependant une vérité dite formelle, il s'agit de la logique.
Cette science traite des raisonnementsformellement vrais.
Puisque la rationalité s'exprime dans la cohérence de la pensée : cette cohérence se rapportenotamment à trois grands principes de logique, qui sont des principes rationnels : tout d'abord le principe d'identité,qui dit que « A est A » (autrement dit qu'une chose est ce qu'elle est [et rien d'autre]) ; ensuite on distingue leprincipe de non-contradiction, selon lequel « une chose ne peut pas être elle même et autre chose » (formenégative du principe d'identité) ; enfin le principe du tiers exclu, qui dit que « une chose est nécessairement unechose ou autre chose » (par exemple, il pleut ou il fait beau)..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- "L'Idée est en vérité ce qui mène les peuples et le monde, et c'est l'Esprit, sa volonté raisonnable et nécessaire, qui a guidé et continue de guider les événements du monde." Hegel, La Raison dans l'Histoire. Commentez cette citation. ?
- Semblable à Mercure, le conducteur des âmes, l'Idée est en vérité ce qui mène les peuples et le monde, et c'est l'Esprit, sa volonté raisonnable et nécessaire, qui a guidé et continue de guider les événements du monde. Hegel, La raison dans l'Histoire. 10/18 page 39. Commentez cette citation.
- IDEE ET HISTOIRE "L'Idée est en vérité ce qui mène les peuples et le monde, et c'est l'Esprit, sa volonté raisonnable et nécessaire, qui a guidé et continue de guider les événements du monde." Hegel, La Raison dans l'Histoire, 1832. Commentez cette citation.
- Descartes, Discours de la méthode. Pour bien conduire sa raison, et chercher la vérité dans les sciences, 1ère partie (GF, p. 75-76)
- DISCOURS DE LA MÉTHODE POUR BIEN CONDUIRE SA RAISON ET CHERCHER LA VÉRITÉ DANS LES SCIENCES René Descartes. Traité philosophique