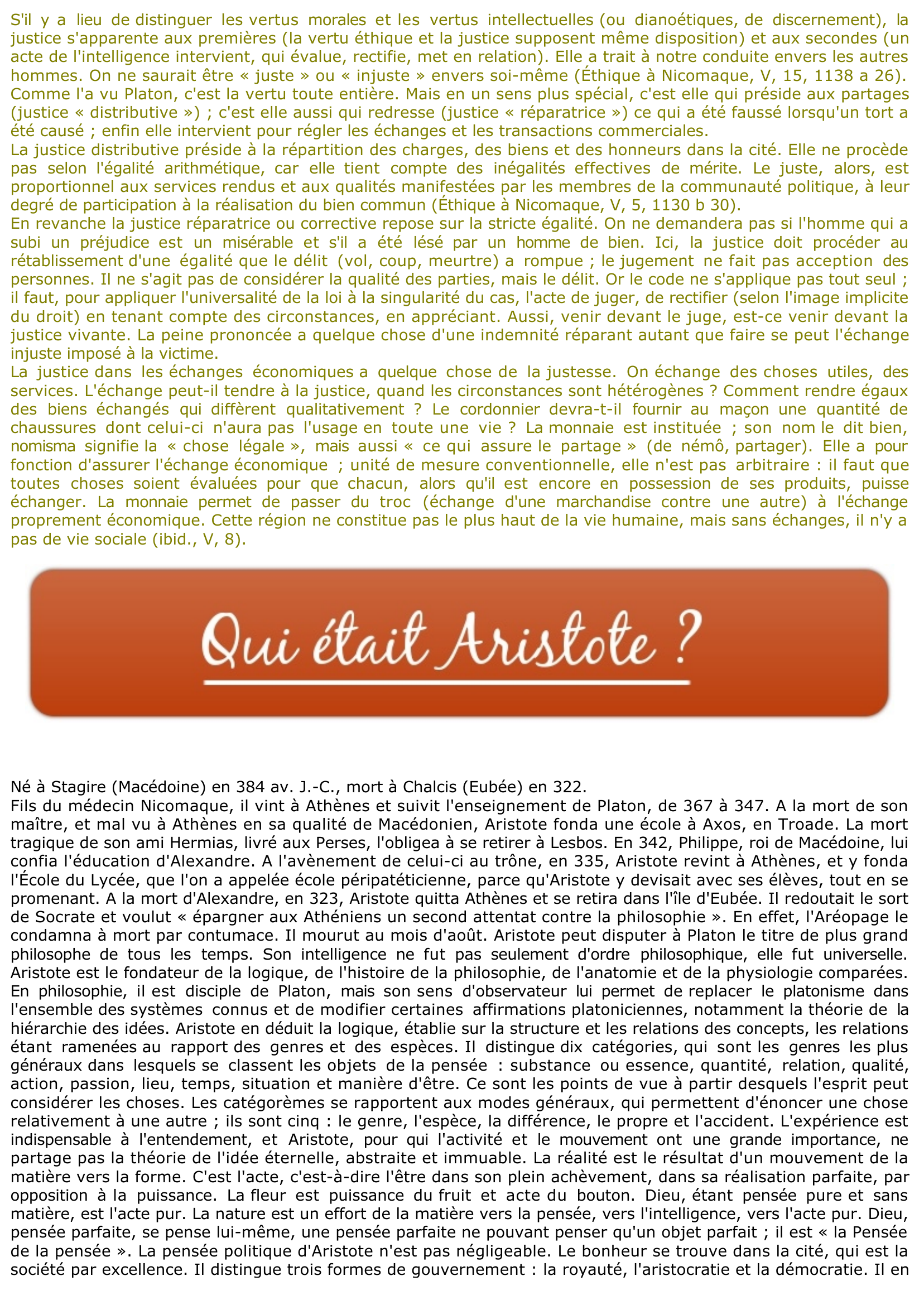Aristote: De la justice particuliere
Publié le 15/04/2005

Extrait du document


«
S'il y a lieu de distinguer les vertus morales et les vertus intellectuelles (ou dianoétiques, de discernement), lajustice s'apparente aux premières (la vertu éthique et la justice supposent même disposition) et aux secondes (unacte de l'intelligence intervient, qui évalue, rectifie, met en relation).
Elle a trait à notre conduite envers les autreshommes.
On ne saurait être « juste » ou « injuste » envers soi-même (Éthique à Nicomaque, V, 15, 1138 a 26).Comme l'a vu Platon, c'est la vertu toute entière.
Mais en un sens plus spécial, c'est elle qui préside aux partages(justice « distributive ») ; c'est elle aussi qui redresse (justice « réparatrice ») ce qui a été faussé lorsqu'un tort aété causé ; enfin elle intervient pour régler les échanges et les transactions commerciales.La justice distributive préside à la répartition des charges, des biens et des honneurs dans la cité.
Elle ne procèdepas selon l'égalité arithmétique, car elle tient compte des inégalités effectives de mérite.
Le juste, alors, estproportionnel aux services rendus et aux qualités manifestées par les membres de la communauté politique, à leurdegré de participation à la réalisation du bien commun (Éthique à Nicomaque, V, 5, 1130 b 30).En revanche la justice réparatrice ou corrective repose sur la stricte égalité.
On ne demandera pas si l'homme qui asubi un préjudice est un misérable et s'il a été lésé par un homme de bien.
Ici, la justice doit procéder aurétablissement d'une égalité que le délit (vol, coup, meurtre) a rompue ; le jugement ne fait pas acception despersonnes.
Il ne s'agit pas de considérer la qualité des parties, mais le délit.
Or le code ne s'applique pas tout seul ;il faut, pour appliquer l'universalité de la loi à la singularité du cas, l'acte de juger, de rectifier (selon l'image implicitedu droit) en tenant compte des circonstances, en appréciant.
Aussi, venir devant le juge, est-ce venir devant lajustice vivante.
La peine prononcée a quelque chose d'une indemnité réparant autant que faire se peut l'échangeinjuste imposé à la victime.La justice dans les échanges économiques a quelque chose de la justesse.
On échange des choses utiles, desservices.
L'échange peut-il tendre à la justice, quand les circonstances sont hétérogènes ? Comment rendre égauxdes biens échangés qui diffèrent qualitativement ? Le cordonnier devra-t-il fournir au maçon une quantité dechaussures dont celui-ci n'aura pas l'usage en toute une vie ? La monnaie est instituée ; son nom le dit bien,nomisma signifie la « chose légale », mais aussi « ce qui assure le partage » (de némô, partager).
Elle a pourfonction d'assurer l'échange économique ; unité de mesure conventionnelle, elle n'est pas arbitraire : il faut quetoutes choses soient évaluées pour que chacun, alors qu'il est encore en possession de ses produits, puisseéchanger.
La monnaie permet de passer du troc (échange d'une marchandise contre une autre) à l'échangeproprement économique.
Cette région ne constitue pas le plus haut de la vie humaine, mais sans échanges, il n'y apas de vie sociale (ibid., V, 8).
Né à Stagire (Macédoine) en 384 av.
J.-C., mort à Chalcis (Eubée) en 322.Fils du médecin Nicomaque, il vint à Athènes et suivit l'enseignement de Platon, de 367 à 347.
A la mort de sonmaître, et mal vu à Athènes en sa qualité de Macédonien, Aristote fonda une école à Axos, en Troade.
La morttragique de son ami Hermias, livré aux Perses, l'obligea à se retirer à Lesbos.
En 342, Philippe, roi de Macédoine, luiconfia l'éducation d'Alexandre.
A l'avènement de celui-ci au trône, en 335, Aristote revint à Athènes, et y fondal'École du Lycée, que l'on a appelée école péripatéticienne, parce qu'Aristote y devisait avec ses élèves, tout en sepromenant.
A la mort d'Alexandre, en 323, Aristote quitta Athènes et se retira dans l'île d'Eubée.
Il redoutait le sortde Socrate et voulut « épargner aux Athéniens un second attentat contre la philosophie ».
En effet, l'Aréopage lecondamna à mort par contumace.
Il mourut au mois d'août.
Aristote peut disputer à Platon le titre de plus grandphilosophe de tous les temps.
Son intelligence ne fut pas seulement d'ordre philosophique, elle fut universelle.Aristote est le fondateur de la logique, de l'histoire de la philosophie, de l'anatomie et de la physiologie comparées.En philosophie, il est disciple de Platon, mais son sens d'observateur lui permet de replacer le platonisme dansl'ensemble des systèmes connus et de modifier certaines affirmations platoniciennes, notamment la théorie de lahiérarchie des idées.
Aristote en déduit la logique, établie sur la structure et les relations des concepts, les relationsétant ramenées au rapport des genres et des espèces.
Il distingue dix catégories, qui sont les genres les plusgénéraux dans lesquels se classent les objets de la pensée : substance ou essence, quantité, relation, qualité,action, passion, lieu, temps, situation et manière d'être.
Ce sont les points de vue à partir desquels l'esprit peutconsidérer les choses.
Les catégorèmes se rapportent aux modes généraux, qui permettent d'énoncer une choserelativement à une autre ; ils sont cinq : le genre, l'espèce, la différence, le propre et l'accident.
L'expérience estindispensable à l'entendement, et Aristote, pour qui l'activité et le mouvement ont une grande importance, nepartage pas la théorie de l'idée éternelle, abstraite et immuable.
La réalité est le résultat d'un mouvement de lamatière vers la forme.
C'est l'acte, c'est-à-dire l'être dans son plein achèvement, dans sa réalisation parfaite, paropposition à la puissance.
La fleur est puissance du fruit et acte du bouton.
Dieu, étant pensée pure et sansmatière, est l'acte pur.
La nature est un effort de la matière vers la pensée, vers l'intelligence, vers l'acte pur.
Dieu,pensée parfaite, se pense lui-même, une pensée parfaite ne pouvant penser qu'un objet parfait ; il est « la Penséede la pensée ».
La pensée politique d'Aristote n'est pas négligeable.
Le bonheur se trouve dans la cité, qui est lasociété par excellence.
Il distingue trois formes de gouvernement : la royauté, l'aristocratie et la démocratie.
Il en.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Aristote, Ethique à Nicomaque, Livre V - LA JUSTICE.
- Commenter cette idée d'Aristote : « Si l'homme civilisé et raisonnable est le premier des animaux, il en est aussi le dernier, quand il vit sans lois et sans justice. » ?
- Pensez-vous, comme Aristote, que l'équité soit une forme supérieure de justice ?
- Aristote Justice et droit
- ARISTOTE: On ne devient juste qu'en pratiquant la justice.