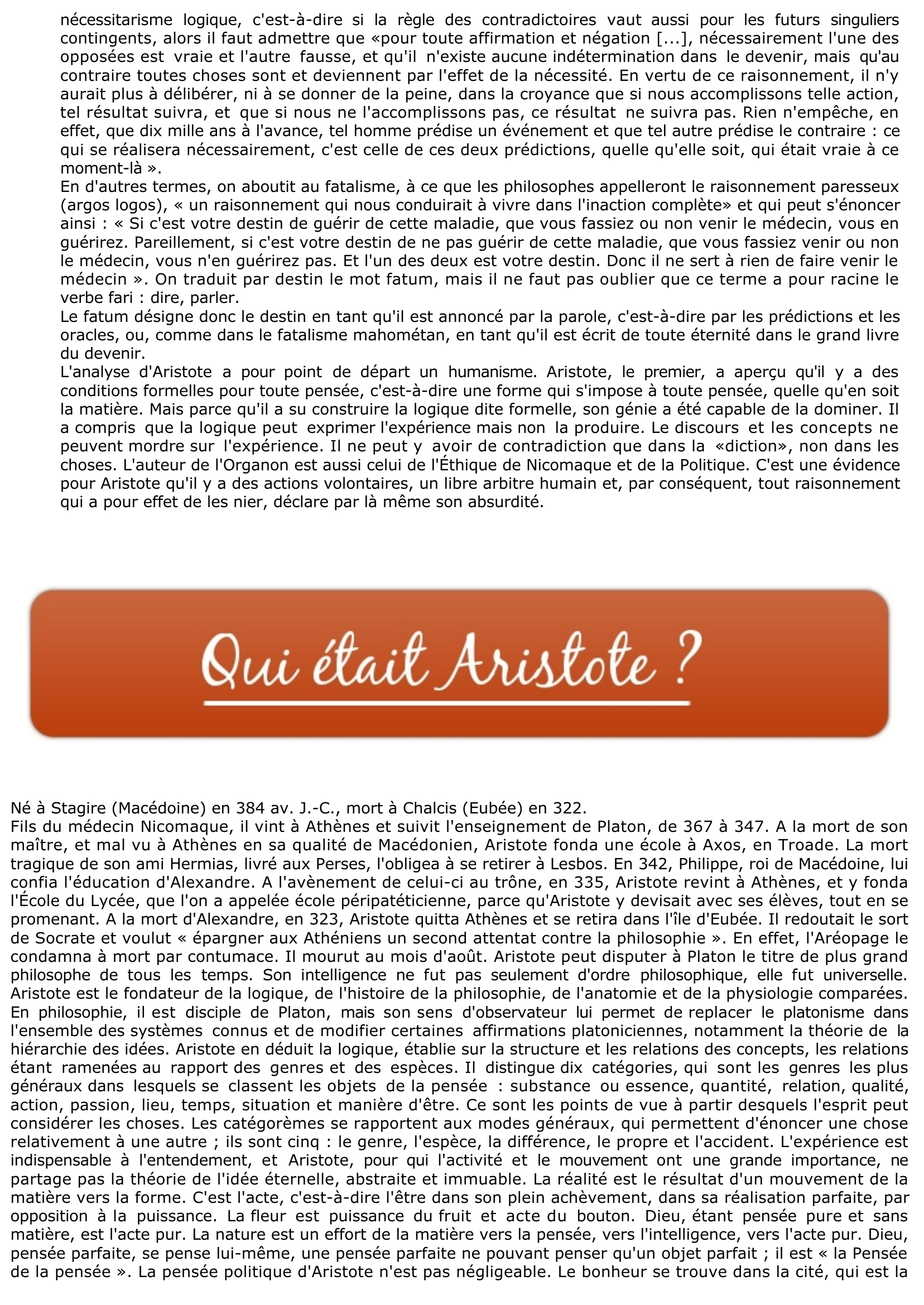Aristote et le tiers exclu
Publié le 15/04/2005

Extrait du document


«
nécessitarisme logique, c'est-à-dire si la règle des contradictoires vaut aussi pour les futurs singulierscontingents, alors il faut admettre que «pour toute affirmation et négation [...], nécessairement l'une desopposées est vraie et l'autre fausse, et qu'il n'existe aucune indétermination dans le devenir, mais qu'aucontraire toutes choses sont et deviennent par l'effet de la nécessité.
En vertu de ce raisonnement, il n'yaurait plus à délibérer, ni à se donner de la peine, dans la croyance que si nous accomplissons telle action,tel résultat suivra, et que si nous ne l'accomplissons pas, ce résultat ne suivra pas.
Rien n'empêche, eneffet, que dix mille ans à l'avance, tel homme prédise un événement et que tel autre prédise le contraire : cequi se réalisera nécessairement, c'est celle de ces deux prédictions, quelle qu'elle soit, qui était vraie à cemoment-là ».En d'autres termes, on aboutit au fatalisme, à ce que les philosophes appelleront le raisonnement paresseux(argos logos), « un raisonnement qui nous conduirait à vivre dans l'inaction complète» et qui peut s'énoncerainsi : « Si c'est votre destin de guérir de cette maladie, que vous fassiez ou non venir le médecin, vous enguérirez.
Pareillement, si c'est votre destin de ne pas guérir de cette maladie, que vous fassiez venir ou nonle médecin, vous n'en guérirez pas.
Et l'un des deux est votre destin.
Donc il ne sert à rien de faire venir lemédecin ».
On traduit par destin le mot fatum, mais il ne faut pas oublier que ce terme a pour racine leverbe fari : dire, parler.Le fatum désigne donc le destin en tant qu'il est annoncé par la parole, c'est-à-dire par les prédictions et lesoracles, ou, comme dans le fatalisme mahométan, en tant qu'il est écrit de toute éternité dans le grand livredu devenir.L'analyse d'Aristote a pour point de départ un humanisme.
Aristote, le premier, a aperçu qu'il y a desconditions formelles pour toute pensée, c'est-à-dire une forme qui s'impose à toute pensée, quelle qu'en soitla matière.
Mais parce qu'il a su construire la logique dite formelle, son génie a été capable de la dominer.
Ila compris que la logique peut exprimer l'expérience mais non la produire.
Le discours et les concepts nepeuvent mordre sur l'expérience.
Il ne peut y avoir de contradiction que dans la «diction», non dans leschoses.
L'auteur de l'Organon est aussi celui de l'Éthique de Nicomaque et de la Politique.
C'est une évidencepour Aristote qu'il y a des actions volontaires, un libre arbitre humain et, par conséquent, tout raisonnementqui a pour effet de les nier, déclare par là même son absurdité.
Né à Stagire (Macédoine) en 384 av.
J.-C., mort à Chalcis (Eubée) en 322.Fils du médecin Nicomaque, il vint à Athènes et suivit l'enseignement de Platon, de 367 à 347.
A la mort de sonmaître, et mal vu à Athènes en sa qualité de Macédonien, Aristote fonda une école à Axos, en Troade.
La morttragique de son ami Hermias, livré aux Perses, l'obligea à se retirer à Lesbos.
En 342, Philippe, roi de Macédoine, luiconfia l'éducation d'Alexandre.
A l'avènement de celui-ci au trône, en 335, Aristote revint à Athènes, et y fondal'École du Lycée, que l'on a appelée école péripatéticienne, parce qu'Aristote y devisait avec ses élèves, tout en sepromenant.
A la mort d'Alexandre, en 323, Aristote quitta Athènes et se retira dans l'île d'Eubée.
Il redoutait le sortde Socrate et voulut « épargner aux Athéniens un second attentat contre la philosophie ».
En effet, l'Aréopage lecondamna à mort par contumace.
Il mourut au mois d'août.
Aristote peut disputer à Platon le titre de plus grandphilosophe de tous les temps.
Son intelligence ne fut pas seulement d'ordre philosophique, elle fut universelle.Aristote est le fondateur de la logique, de l'histoire de la philosophie, de l'anatomie et de la physiologie comparées.En philosophie, il est disciple de Platon, mais son sens d'observateur lui permet de replacer le platonisme dansl'ensemble des systèmes connus et de modifier certaines affirmations platoniciennes, notamment la théorie de lahiérarchie des idées.
Aristote en déduit la logique, établie sur la structure et les relations des concepts, les relationsétant ramenées au rapport des genres et des espèces.
Il distingue dix catégories, qui sont les genres les plusgénéraux dans lesquels se classent les objets de la pensée : substance ou essence, quantité, relation, qualité,action, passion, lieu, temps, situation et manière d'être.
Ce sont les points de vue à partir desquels l'esprit peutconsidérer les choses.
Les catégorèmes se rapportent aux modes généraux, qui permettent d'énoncer une choserelativement à une autre ; ils sont cinq : le genre, l'espèce, la différence, le propre et l'accident.
L'expérience estindispensable à l'entendement, et Aristote, pour qui l'activité et le mouvement ont une grande importance, nepartage pas la théorie de l'idée éternelle, abstraite et immuable.
La réalité est le résultat d'un mouvement de lamatière vers la forme.
C'est l'acte, c'est-à-dire l'être dans son plein achèvement, dans sa réalisation parfaite, paropposition à la puissance.
La fleur est puissance du fruit et acte du bouton.
Dieu, étant pensée pure et sansmatière, est l'acte pur.
La nature est un effort de la matière vers la pensée, vers l'intelligence, vers l'acte pur.
Dieu,pensée parfaite, se pense lui-même, une pensée parfaite ne pouvant penser qu'un objet parfait ; il est « la Penséede la pensée ».
La pensée politique d'Aristote n'est pas négligeable.
Le bonheur se trouve dans la cité, qui est la.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- tiers exclu (principe du).
- L'argument du tiers exclu
- « Qui peut le plus peut le moins » ARISTOTE
- « L’amitié est une âme en deux corps » ATTRIBUÉ À ARISTOTE
- « Il n’y a point de génie sans un grain de folie » ATTRIBUÉ À ARISTOTE