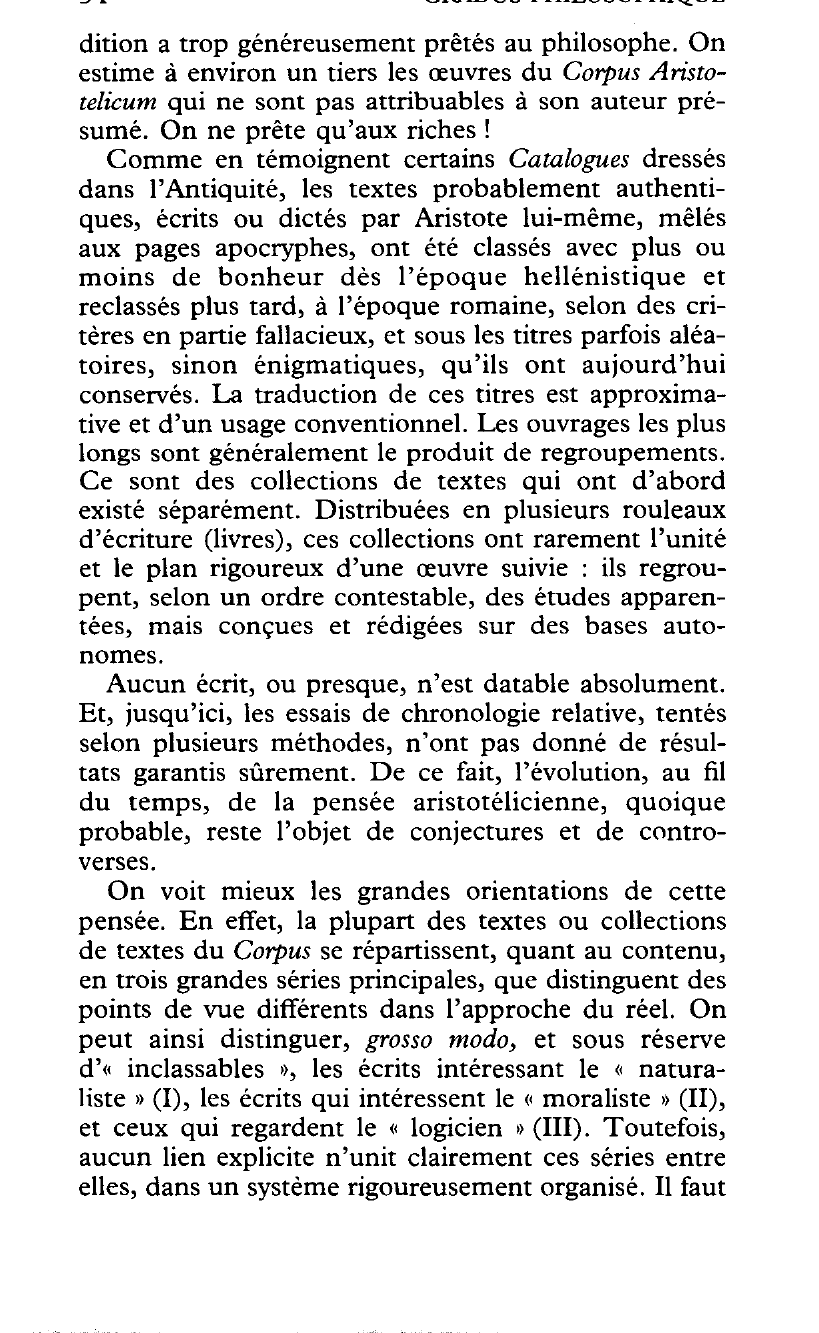ARISTOTE : Le « Corpus »
Publié le 13/10/2013
Extrait du document

Aristote ne s'est pas intéressé, sinon de loin, aux techniques de production qui fournissent les biens extérieurs, lesquels, pour le philosophe, ne constituent pas le bonheur et n'en sont que la condition. Mais il a fait une exception au profit de l'art libéral qui assume (en grec) le nom générique de ces techniques productives et, sous le titre de Poétique2, un texte, probablement très mutilé, s'efforce de dégager les règles de composition qui président à l'élaboration des oeuvres réussies, spécialement dans le genre épique et dans le genre tragique. Ces règles, pour Aristote, ne sont ni esthétiques ni morales, au sens où nous l'entendons. Ce sont celles qui conduisent à une oeuvre susceptible de produire efficacement la crainte et la pitié chez ceux à qui elle s'adresse. D'où l'idée, ultracélèbre mais passablement obscure, d'une épuration (catharsis) des passions par l'effet qu'engendre, chez le spectateur, l'« imitation « poétique. Il est fait allusion à cet effet dans le programme d'éducation libérale esquissé par le philosophe, où tous les arts musicaux tiennent une place primordiale et visent à la formation de l'âme irrationnelle.

«
34 GRADUS PHILOSOPHIQUE
dition a trop généreusement prêtés au philosophe.
On
estime à environ un tiers les œuvres du Corpus Aristo
telicum
qui ne sont pas attribuables à son auteur pré
sumé.
On ne prête qu'aux riches !
Comme en témoignent certains Catalogues dressés
dans !'Antiquité, les textes probablement authenti
ques, écrits ou dictés par Aristote lui-même, mêlés
aux pages apocryphes, ont été classés avec plus ou
moins de bonheur dès l'époque hellénistique et
reclassés plus tard, à l'époque romaine, selon des cri
tères
en partie fallacieux, et sous les titres parfois aléa
toires,
sinon énigmatiques, qu'ils ont aujourd'hui
conservés.
La traduction de ces titres est approxima
tive
et d'un usage conventionnel.
Les ouvrages les plus
longs
sont généralement le produit de regroupements.
Ce sont des collections de textes qui ont d'abord
existé séparément.
Distribuées en plusieurs rouleaux
d'écriture (livres), ces collections ont rarement l'unité
et le plan rigoureux d'une œuvre suivie : ils regrou
pent, selon un ordre contestable, des études apparen
tées, mais conçues et rédigées sur des bases auto
nomes.
Aucun écrit, ou presque, n'est datable absolument.
Et, jusqu'ici, les essais de chronologie relative, tentés
selon plusieurs méthodes,
n'ont pas donné de résul
tats garantis sûrement.
De ce fait, l'évolution, au fil
du temps, de la pensée aristotélicienne, quoique
probable, reste l'objet de conjectures et de contro
verses.
On voit mieux les grandes orientations de cette
pensée.
En effet, la plupart des textes ou collections
de textes du Corpus se répartissent, quant au contenu,
en trois grandes séries principales, que distinguent des
points
de vue différents dans l'approche du réel.
On
peut ainsi distinguer, grosso modo, et sous réserve
d'« inclassables », les écrits intéressant le « natura
liste » (l), les écrits qui intéressent le « moraliste » (Il),
et ceux qui regardent le
« logicien »(III).
Toutefois,
aucun lien explicite n'unit clairement ces séries entre
elles, dans un système rigoureusement organisé.
Il faut.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- « Qui peut le plus peut le moins » ARISTOTE
- « L’amitié est une âme en deux corps » ATTRIBUÉ À ARISTOTE
- « Il n’y a point de génie sans un grain de folie » ATTRIBUÉ À ARISTOTE
- Méthode expérimentale; CHAPITRE 2 ARISTOTE : LOGIQUE ET RHÉTORIQUE
- Réalisation d'un projet de constitution de corpus et de publication web