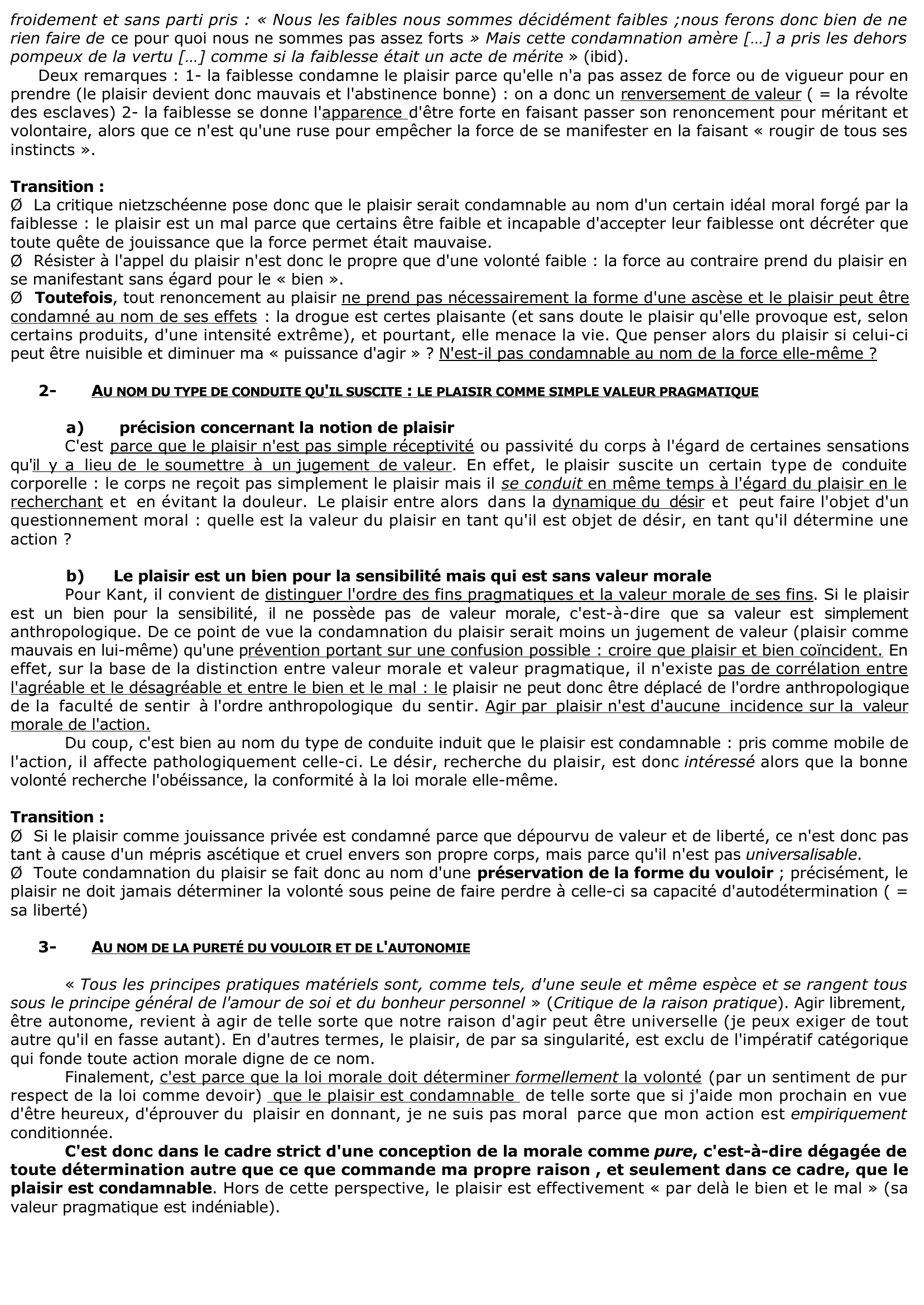Au nom de quoi condamne-t-on le plaisir ?
Publié le 13/08/2005

Extrait du document
Le plaisir peut à la fois être nuisible comme il peut être bon. D’un point de vue strictement physique : le plaisir est une sensation agréable qui nous signale l’utilité d’une chose. Toutefois cette utilité n’est pas systématique : le drogué cherche et trouve du plaisir dans la consommation de produits qui détruisent sa santé et donc menacent sa vie. De par cette ambiguïté, le plaisir a souvent été condamné par la philosophie : il faut lui préférer le bien connu par la raison. Toutefois, une telle condamnation du plaisir sans exception (en repos comme absence de douleur – ne pas avoir soif – en mouvement comme celui de boire) est problématique : de quel droit rejeter tous les plaisirs ? N’est-ce pas jeter le bébé avec l’eau du bain ? Au nom de quoi le plaisir serait-il condamnable ? Ne serait-ce pas au nom de présupposés arbitrairement haineux à l’égard du corps et de la chair ? Mais ne peut-on pas condamner le plaisir sans verser dans le renoncement morbide propre à l’ascèse ? Car, le plaisir pris comme fin en soi et bien suprême rend-il vraiment heureux ? Si le plaisir est condamnable, n’est-ce pas au nom de la façon dont il peut affecter l’autonomie ?
«
froidement et sans parti pris : « Nous les faibles nous sommes décidément faibles ;nous ferons donc bien de nerien faire de ce pour quoi nous ne sommes pas assez forts » Mais cette condamnation amère […] a pris les dehors pompeux de la vertu […] comme si la faiblesse était un acte de mérite » (ibid). Deux remarques : 1- la faiblesse condamne le plaisir parce qu'elle n'a pas assez de force ou de vigueur pour en prendre (le plaisir devient donc mauvais et l'abstinence bonne) : on a donc un renversement de valeur ( = la révolte des esclaves) 2- la faiblesse se donne l' apparence d'être forte en faisant passer son renoncement pour méritant et volontaire, alors que ce n'est qu'une ruse pour empêcher la force de se manifester en la faisant « rougir de tous sesinstincts ».
Transition :Ø La critique nietzschéenne pose donc que le plaisir serait condamnable au nom d'un certain idéal moral forgé par lafaiblesse : le plaisir est un mal parce que certains être faible et incapable d'accepter leur faiblesse ont décréter quetoute quête de jouissance que la force permet était mauvaise.Ø Résister à l'appel du plaisir n'est donc le propre que d'une volonté faible : la force au contraire prend du plaisir ense manifestant sans égard pour le « bien ».Ø Toutefois , tout renoncement au plaisir ne prend pas nécessairement la forme d'une ascèse et le plaisir peut être condamné au nom de ses effets : la drogue est certes plaisante (et sans doute le plaisir qu'elle provoque est, selon certains produits, d'une intensité extrême), et pourtant, elle menace la vie.
Que penser alors du plaisir si celui-cipeut être nuisible et diminuer ma « puissance d'agir » ? N'est-il pas condamnable au nom de la force elle-même ? 2- AU NOM DU TYPE DE CONDUITE QU 'IL SUSCITE : LE PLAISIR COMME SIMPLE VALEUR PRAGMATIQUE a) précision concernant la notion de plaisir C'est parce que le plaisir n'est pas simple réceptivité ou passivité du corps à l'égard de certaines sensations qu'il y a lieu de le soumettre à un jugement de valeur .
En effet, le plaisir suscite un certain type de conduite corporelle : le corps ne reçoit pas simplement le plaisir mais il se conduit en même temps à l'égard du plaisir en le recherchant et en évitant la douleur.
Le plaisir entre alors dans la dynamique du désir et peut faire l'objet d'un questionnement moral : quelle est la valeur du plaisir en tant qu'il est objet de désir, en tant qu'il détermine uneaction ? b) Le plaisir est un bien pour la sensibilité mais qui est sans valeur morale Pour Kant, il convient de distinguer l'ordre des fins pragmatiques et la valeur morale de ses fins .
Si le plaisir est un bien pour la sensibilité, il ne possède pas de valeur morale, c'est-à-dire que sa valeur est simplementanthropologique.
De ce point de vue la condamnation du plaisir serait moins un jugement de valeur (plaisir commemauvais en lui-même) qu'une p révention portant sur une confusion possible : croire que plaisir et bien coïncident. En effet, sur la base de la distinction entre valeur morale et valeur pragmatique, il n'existe pas de corrélation entre l'agréable et le désagréable et entre le bien et le mal : le plaisir ne peut donc être déplacé de l'ordre anthropologique de la faculté de sentir à l'ordre anthropologique du sentir.
Agir par plaisir n'est d'aucune incidence sur la valeur morale de l'action. Du coup, c'est bien au nom du type de conduite induit que le plaisir est condamnable : pris comme mobile de l'action, il affecte pathologiquement celle-ci.
Le désir, recherche du plaisir, est donc intéressé alors que la bonne volonté recherche l'obéissance, la conformité à la loi morale elle-même. Transition :Ø Si le plaisir comme jouissance privée est condamné parce que dépourvu de valeur et de liberté, ce n'est donc pastant à cause d'un mépris ascétique et cruel envers son propre corps, mais parce qu'il n'est pas universalisable . Ø Toute condamnation du plaisir se fait donc au nom d'une préservation de la forme du vouloir ; précisément, le plaisir ne doit jamais déterminer la volonté sous peine de faire perdre à celle-ci sa capacité d'autodétermination ( =sa liberté) 3- AU NOM DE LA PURETÉ DU VOULOIR ET DE L 'AUTONOMIE « Tous les principes pratiques matériels sont, comme tels, d'une seule et même espèce et se rangent tous sous le principe général de l'amour de soi et du bonheur personnel » ( Critique de la raison pratique ).
Agir librement, être autonome, revient à agir de telle sorte que notre raison d'agir peut être universelle (je peux exiger de toutautre qu'il en fasse autant).
En d'autres termes, le plaisir, de par sa singularité, est exclu de l'impératif catégoriquequi fonde toute action morale digne de ce nom. Finalement, c'est parce que la loi morale doit déterminer formellement la volonté (par un sentiment de pur respect de la loi comme devoir) que le plaisir est condamnable de telle sorte que si j'aide mon prochain en vue d'être heureux, d'éprouver du plaisir en donnant, je ne suis pas moral parce que mon action est empiriquement conditionnée. C'est donc dans le cadre strict d'une conception de la morale comme pure , c'est-à-dire dégagée de toute détermination autre que ce que commande ma propre raison , et seulement dans ce cadre, que leplaisir est condamnable .
Hors de cette perspective, le plaisir est effectivement « par delà le bien et le mal » (sa valeur pragmatique est indéniable)..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Au nom de quoi condamne-t-on le plaisir ?
- Au nom de quoi le plaisir serait-il condamnable ?
- Si le désir n'a pas le plaisir pour norme, ce n'est pas au nom d'un Manque intérieur qui serait impossible à combler, mais au contraire en vertu de sa positivité, c'est à dire du plan de consistance qu'il trace au cours de son procès. G. Deleuze, Dialogues, Flammarion. page 120. Commentez cette citation.
- Sujet : Le bonheur est-il une succession de plaisir ?
- Lien entre le plaisir et le bonheur