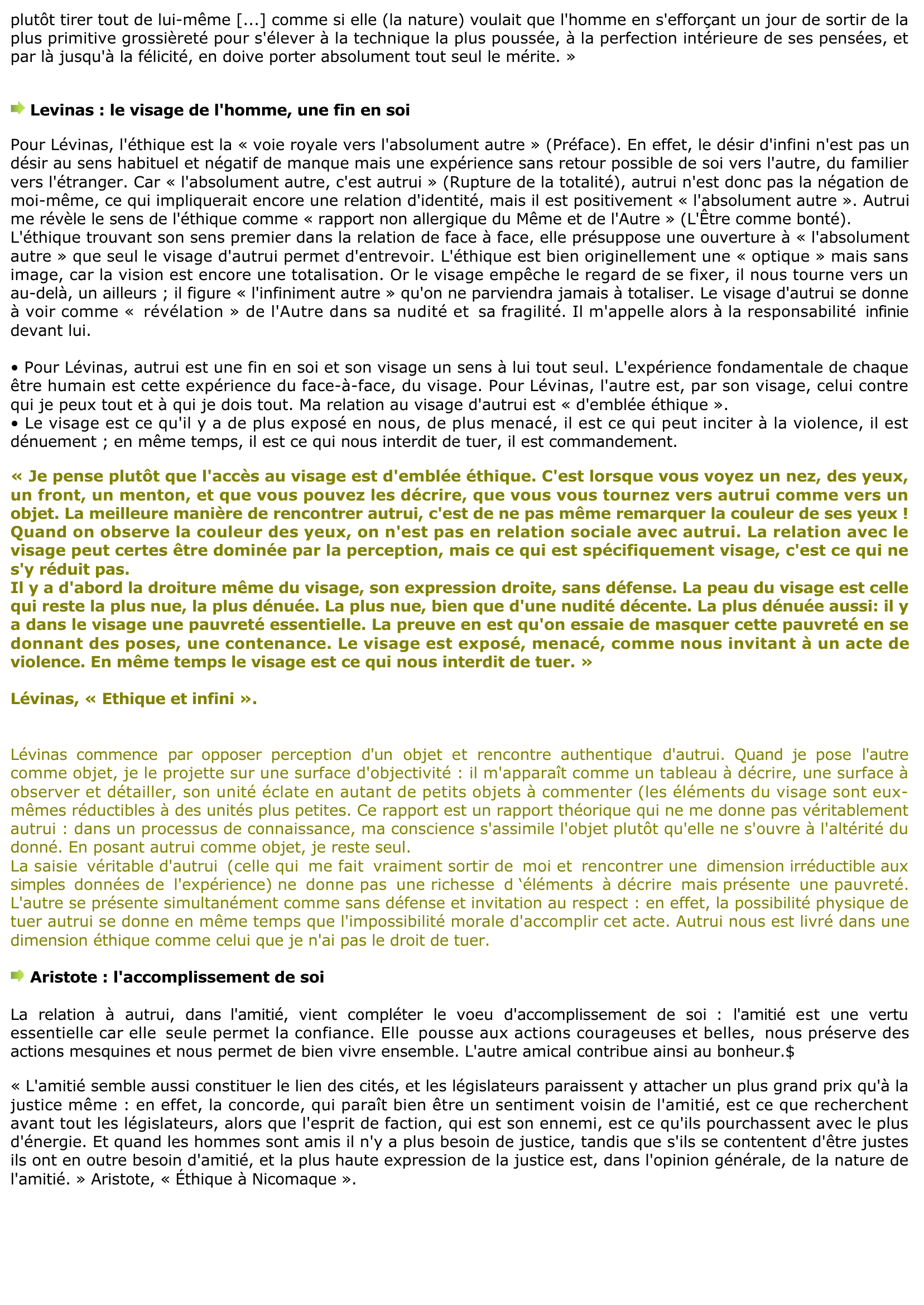Autrui est il une fin ou un moyen ?
Publié le 14/08/2005
Extrait du document
• L'homme a tendance à la fois à s'associer à d'autres hommes pour se renforcer, mais aussi à s'isoler pour rechercher son intérêt propre. Cette dernière propension le pousse à résister à autrui pour s'imposer. Ainsi trouve-t-il des forces qui le mènent peu à peu vers la culture. • Cet antagonisme en l'homme se résume dans une « insociable sociabilité « : l'homme ne peut ni se passer d'autrui, ni vivre harmonieusement avec autrui. Cette double postulation au sein de la société humaine fait d'autrui un moyen paradoxal de civilisation et sert ainsi les desseins de la nature qui poursuit ses fins supra-humaines à travers nous.
«
plutôt tirer tout de lui-même [...] comme si elle (la nature) voulait que l'homme en s'efforçant un jour de sortir de laplus primitive grossièreté pour s'élever à la technique la plus poussée, à la perfection intérieure de ses pensées, etpar là jusqu'à la félicité, en doive porter absolument tout seul le mérite.
»
Levinas : le visage de l'homme, une fin en soi
Pour Lévinas, l'éthique est la « voie royale vers l'absolument autre » (Préface).
En effet, le désir d'infini n'est pas undésir au sens habituel et négatif de manque mais une expérience sans retour possible de soi vers l'autre, du familiervers l'étranger.
Car « l'absolument autre, c'est autrui » (Rupture de la totalité), autrui n'est donc pas la négation demoi-même, ce qui impliquerait encore une relation d'identité, mais il est positivement « l'absolument autre ».
Autruime révèle le sens de l'éthique comme « rapport non allergique du Même et de l'Autre » (L'Être comme bonté).L'éthique trouvant son sens premier dans la relation de face à face, elle présuppose une ouverture à « l'absolumentautre » que seul le visage d'autrui permet d'entrevoir.
L'éthique est bien originellement une « optique » mais sansimage, car la vision est encore une totalisation.
Or le visage empêche le regard de se fixer, il nous tourne vers unau-delà, un ailleurs ; il figure « l'infiniment autre » qu'on ne parviendra jamais à totaliser.
Le visage d'autrui se donneà voir comme « révélation » de l'Autre dans sa nudité et sa fragilité.
Il m'appelle alors à la responsabilité infiniedevant lui.
• Pour Lévinas, autrui est une fin en soi et son visage un sens à lui tout seul.
L'expérience fondamentale de chaqueêtre humain est cette expérience du face-à-face, du visage.
Pour Lévinas, l'autre est, par son visage, celui contrequi je peux tout et à qui je dois tout.
Ma relation au visage d'autrui est « d'emblée éthique ».• Le visage est ce qu'il y a de plus exposé en nous, de plus menacé, il est ce qui peut inciter à la violence, il estdénuement ; en même temps, il est ce qui nous interdit de tuer, il est commandement.
« Je pense plutôt que l'accès au visage est d'emblée éthique.
C'est lorsque vous voyez un nez, des yeux,un front, un menton, et que vous pouvez les décrire, que vous vous tournez vers autrui comme vers unobjet.
La meilleure manière de rencontrer autrui, c'est de ne pas même remarquer la couleur de ses yeux !Quand on observe la couleur des yeux, on n'est pas en relation sociale avec autrui.
La relation avec levisage peut certes être dominée par la perception, mais ce qui est spécifiquement visage, c'est ce qui nes'y réduit pas.Il y a d'abord la droiture même du visage, son expression droite, sans défense.
La peau du visage est cellequi reste la plus nue, la plus dénuée.
La plus nue, bien que d'une nudité décente.
La plus dénuée aussi: il ya dans le visage une pauvreté essentielle.
La preuve en est qu'on essaie de masquer cette pauvreté en sedonnant des poses, une contenance.
Le visage est exposé, menacé, comme nous invitant à un acte deviolence.
En même temps le visage est ce qui nous interdit de tuer.
»
Lévinas, « Ethique et infini ».
Lévinas commence par opposer perception d'un objet et rencontre authentique d'autrui.
Quand je pose l'autrecomme objet, je le projette sur une surface d'objectivité : il m'apparaît comme un tableau à décrire, une surface àobserver et détailler, son unité éclate en autant de petits objets à commenter (les éléments du visage sont eux-mêmes réductibles à des unités plus petites.
Ce rapport est un rapport théorique qui ne me donne pas véritablementautrui : dans un processus de connaissance, ma conscience s'assimile l'objet plutôt qu'elle ne s'ouvre à l'altérité dudonné.
En posant autrui comme objet, je reste seul.La saisie véritable d'autrui (celle qui me fait vraiment sortir de moi et rencontrer une dimension irréductible auxsimples données de l'expérience) ne donne pas une richesse d ‘éléments à décrire mais présente une pauvreté.L'autre se présente simultanément comme sans défense et invitation au respect : en effet, la possibilité physique detuer autrui se donne en même temps que l'impossibilité morale d'accomplir cet acte.
Autrui nous est livré dans unedimension éthique comme celui que je n'ai pas le droit de tuer.
Aristote : l'accomplissement de soi
La relation à autrui, dans l'amitié, vient compléter le voeu d'accomplissement de soi : l'amitié est une vertuessentielle car elle seule permet la confiance.
Elle pousse aux actions courageuses et belles, nous préserve desactions mesquines et nous permet de bien vivre ensemble.
L'autre amical contribue ainsi au bonheur.$
« L'amitié semble aussi constituer le lien des cités, et les législateurs paraissent y attacher un plus grand prix qu'à lajustice même : en effet, la concorde, qui paraît bien être un sentiment voisin de l'amitié, est ce que recherchentavant tout les législateurs, alors que l'esprit de faction, qui est son ennemi, est ce qu'ils pourchassent avec le plusd'énergie.
Et quand les hommes sont amis il n'y a plus besoin de justice, tandis que s'ils se contentent d'être justesils ont en outre besoin d'amitié, et la plus haute expression de la justice est, dans l'opinion générale, de la nature del'amitié.
» Aristote, « Éthique à Nicomaque »..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- L’Europe à la fin du Moyen-Age (fin du XIIIème – fin XVème siècle)
- Texte n°1: Ferdinand Lot, « La fin du monde antique et le début du Moyen Age »
- ART RELIGIEUX DU XIIe SIÈCLE, — DU XIIIe SIÈCLE , — ET DE LA FIN DU MOYEN AGE EN FRANCE (résumé & analyse)
- L’amour est-il un moyen en vue du bien ou une fin en soi?
- Le royaume de France Capétiens et Valois (de 987 à 1498) par Jean Favier Professeur à la Faculté des Lettres et Sciences humaines, Rouen L'idée que donne du royaume de France l'examen rapide d'une carte est, pour la fin du Moyen Âge, singulièrement illusoire.