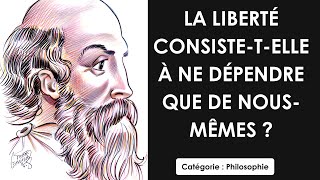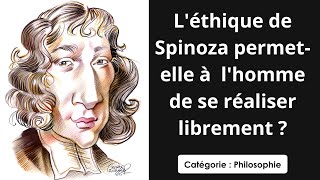Bernard Williams
Publié le 22/02/2012
Extrait du document
Philosophe anglais ayant enseigné à Cambridge et Oxford, il se distingue par son refus de l'objectivisme en morale. Il n'y a pas de théorie morale rationnelle qui puisse indiquer définitivement quel est le bien et ce qu'il faut faire : ce n'est pas l'argumentation ni l'esprit de système qui convainquent d'agir. Les moteurs de l'action sont d'abord passionnels, et une bonne éducation consiste à intégrer les normes morales. Aussi la morale est d'abord ancrée dans une culture : aboutit-on à un relativisme moral ? Non, si ce jugement : " les morales sont relatives " n'a lui-même aucune signification morale. Il peut y avoir des conflits entre morales différentes, mais une comparaison n'est possible que dans le cas de cultures proches. Ces conceptions l'amènent à refuser l'utilitarisme et toute forme de volontarisme moral : l'action dépend de bien d'autres facteurs que la volonté et la décision. Œuvres : Problems of the Self (1973), Moral luck (1981), Ethics and the limits of philosophy (1985), Shame and necessity (1993), Making sense of humanity (1995).
Liens utiles
- Bernard Lahire Commentaire
- Claude Bernard : Introduction à l'étude de la médecine expérimentale (fiche de lecture)
- Bernard, Les Faux Monnayeurs
- PREMIERS MOTS (Les) de Bernard Noël
- DEGRÉS DE L'HUMILITÉ ET DE L’ORGUEIL (Des) (résumé & analyse) de saint Bernard de Clairvaux