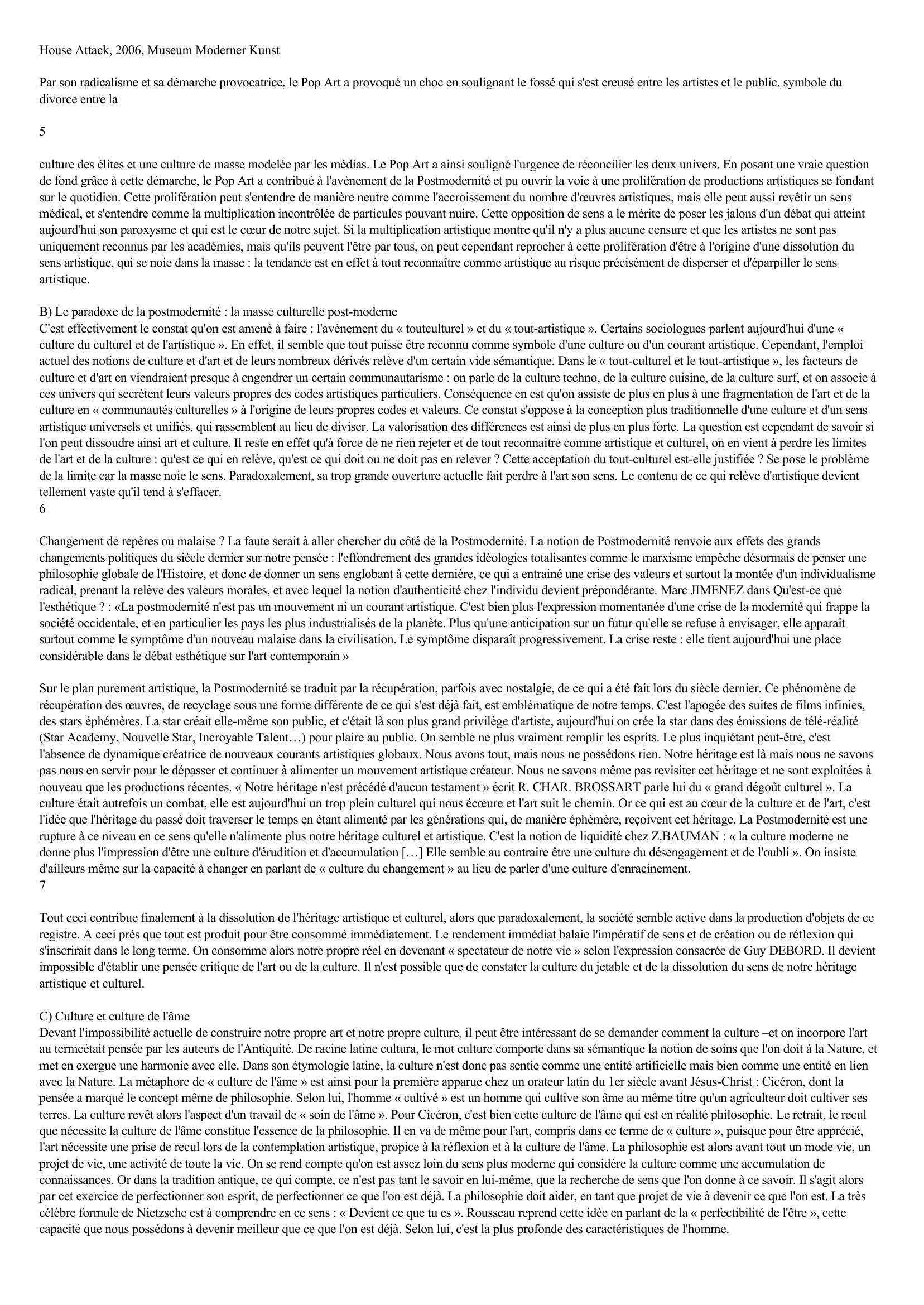Comment savoir si c'est de l'Art ou pas ?
Publié le 13/08/2012

Extrait du document
Conclusion Dans le cadre de notre problématique de recherche, on conclut donc que peuvent être considérées comme artistiques les œuvres envisagées comme moyen de donner sens à la vie, à même de susciter chez qui les contemple la satisfaction désintéressée de la contemplation, et qui nous arrachent au temps linéaire pour nous faire basculer dans un ailleurs dans lequel le temps est autre, et où celui qui contemple ressent l'élan de création de l'artiste. Alors seulement peut-on effleurer la magie inépuisable de l'art. Il est maintenant possible de compléter ces réflexions au travers certaines problématiques artistiques contemporaines. III – Perspectives de réflexion dans le cadre de problématiques contemporaines A) La beauté du Laid Quelques exemples de laideur artistique... Dans les chants de Maldoror, Lautréamont exploite le répugnant et le sale dans la description à la première personne d'un cadavre : « Je suis sale. Les poux me rongent. Les pourceaux, quand ils me regardent, vomissent. Les croutes et les escarres de la lèpre ont écaillé ma peau, couverte de pus jaunâtre. […] Sur ma nuque, comme sur un fumier, pousse un énorme champignon aux pédoncules ombellifères. Assis sur un meuble informe, je n'ai pas bougé mes membres depuis quatre siècles. Mes pieds ont pris racines dans le sol et composent jusqu'à mon ventre une sorte de végétation vivace, rempli d'ignobles parasites, qui ne dérive pas encore de la plante qui n'est plus de la chair. Cependant mon cœur bat. […] Sous mon aisselle
«
House Attack, 2006, Museum Moderner Kunst
Par son radicalisme et sa démarche provocatrice, le Pop Art a provoqué un choc en soulignant le fossé qui s'est creusé entre les artistes et le public, symbole dudivorce entre la
5
culture des élites et une culture de masse modelée par les médias.
Le Pop Art a ainsi souligné l'urgence de réconcilier les deux univers.
En posant une vraie questionde fond grâce à cette démarche, le Pop Art a contribué à l'avènement de la Postmodernité et pu ouvrir la voie à une prolifération de productions artistiques se fondantsur le quotidien.
Cette prolifération peut s'entendre de manière neutre comme l'accroissement du nombre d'œuvres artistiques, mais elle peut aussi revêtir un sensmédical, et s'entendre comme la multiplication incontrôlée de particules pouvant nuire.
Cette opposition de sens a le mérite de poser les jalons d'un débat qui atteintaujourd'hui son paroxysme et qui est le cœur de notre sujet.
Si la multiplication artistique montre qu'il n'y a plus aucune censure et que les artistes ne sont pasuniquement reconnus par les académies, mais qu'ils peuvent l'être par tous, on peut cependant reprocher à cette prolifération d'être à l'origine d'une dissolution dusens artistique, qui se noie dans la masse : la tendance est en effet à tout reconnaître comme artistique au risque précisément de disperser et d'éparpiller le sensartistique.
B) Le paradoxe de la postmodernité : la masse culturelle post-moderneC'est effectivement le constat qu'on est amené à faire : l'avènement du « toutculturel » et du « tout-artistique ».
Certains sociologues parlent aujourd'hui d'une «culture du culturel et de l'artistique ».
En effet, il semble que tout puisse être reconnu comme symbole d'une culture ou d'un courant artistique.
Cependant, l'emploiactuel des notions de culture et d'art et de leurs nombreux dérivés relève d'un certain vide sémantique.
Dans le « tout-culturel et le tout-artistique », les facteurs deculture et d'art en viendraient presque à engendrer un certain communautarisme : on parle de la culture techno, de la culture cuisine, de la culture surf, et on associe àces univers qui secrètent leurs valeurs propres des codes artistiques particuliers.
Conséquence en est qu'on assiste de plus en plus à une fragmentation de l'art et de laculture en « communautés culturelles » à l'origine de leurs propres codes et valeurs.
Ce constat s'oppose à la conception plus traditionnelle d'une culture et d'un sensartistique universels et unifiés, qui rassemblent au lieu de diviser.
La valorisation des différences est ainsi de plus en plus forte.
La question est cependant de savoir sil'on peut dissoudre ainsi art et culture.
Il reste en effet qu'à force de ne rien rejeter et de tout reconnaitre comme artistique et culturel, on en vient à perdre les limitesde l'art et de la culture : qu'est ce qui en relève, qu'est ce qui doit ou ne doit pas en relever ? Cette acceptation du tout-culturel est-elle justifiée ? Se pose le problèmede la limite car la masse noie le sens.
Paradoxalement, sa trop grande ouverture actuelle fait perdre à l'art son sens.
Le contenu de ce qui relève d'artistique devienttellement vaste qu'il tend à s'effacer.6
Changement de repères ou malaise ? La faute serait à aller chercher du côté de la Postmodernité.
La notion de Postmodernité renvoie aux effets des grandschangements politiques du siècle dernier sur notre pensée : l'effondrement des grandes idéologies totalisantes comme le marxisme empêche désormais de penser unephilosophie globale de l'Histoire, et donc de donner un sens englobant à cette dernière, ce qui a entrainé une crise des valeurs et surtout la montée d'un individualismeradical, prenant la relève des valeurs morales, et avec lequel la notion d'authenticité chez l'individu devient prépondérante.
Marc JIMENEZ dans Qu'est-ce quel'esthétique ? : «La postmodernité n'est pas un mouvement ni un courant artistique.
C'est bien plus l'expression momentanée d'une crise de la modernité qui frappe lasociété occidentale, et en particulier les pays les plus industrialisés de la planète.
Plus qu'une anticipation sur un futur qu'elle se refuse à envisager, elle apparaîtsurtout comme le symptôme d'un nouveau malaise dans la civilisation.
Le symptôme disparaît progressivement.
La crise reste : elle tient aujourd'hui une placeconsidérable dans le débat esthétique sur l'art contemporain »
Sur le plan purement artistique, la Postmodernité se traduit par la récupération, parfois avec nostalgie, de ce qui a été fait lors du siècle dernier.
Ce phénomène derécupération des œuvres, de recyclage sous une forme différente de ce qui s'est déjà fait, est emblématique de notre temps.
C'est l'apogée des suites de films infinies,des stars éphémères.
La star créait elle-même son public, et c'était là son plus grand privilège d'artiste, aujourd'hui on crée la star dans des émissions de télé-réalité(Star Academy, Nouvelle Star, Incroyable Talent…) pour plaire au public.
On semble ne plus vraiment remplir les esprits.
Le plus inquiétant peut-être, c'estl'absence de dynamique créatrice de nouveaux courants artistiques globaux.
Nous avons tout, mais nous ne possédons rien.
Notre héritage est là mais nous ne savonspas nous en servir pour le dépasser et continuer à alimenter un mouvement artistique créateur.
Nous ne savons même pas revisiter cet héritage et ne sont exploitées ànouveau que les productions récentes.
« Notre héritage n'est précédé d'aucun testament » écrit R.
CHAR.
BROSSART parle lui du « grand dégoût culturel ».
Laculture était autrefois un combat, elle est aujourd'hui un trop plein culturel qui nous écœure et l'art suit le chemin.
Or ce qui est au cœur de la culture et de l'art, c'estl'idée que l'héritage du passé doit traverser le temps en étant alimenté par les générations qui, de manière éphémère, reçoivent cet héritage.
La Postmodernité est unerupture à ce niveau en ce sens qu'elle n'alimente plus notre héritage culturel et artistique.
C'est la notion de liquidité chez Z.BAUMAN : « la culture moderne nedonne plus l'impression d'être une culture d'érudition et d'accumulation […] Elle semble au contraire être une culture du désengagement et de l'oubli ».
On insisted'ailleurs même sur la capacité à changer en parlant de « culture du changement » au lieu de parler d'une culture d'enracinement.7
Tout ceci contribue finalement à la dissolution de l'héritage artistique et culturel, alors que paradoxalement, la société semble active dans la production d'objets de ceregistre.
A ceci près que tout est produit pour être consommé immédiatement.
Le rendement immédiat balaie l'impératif de sens et de création ou de réflexion quis'inscrirait dans le long terme.
On consomme alors notre propre réel en devenant « spectateur de notre vie » selon l'expression consacrée de Guy DEBORD.
Il devientimpossible d'établir une pensée critique de l'art ou de la culture.
Il n'est possible que de constater la culture du jetable et de la dissolution du sens de notre héritageartistique et culturel.
C) Culture et culture de l'âmeDevant l'impossibilité actuelle de construire notre propre art et notre propre culture, il peut être intéressant de se demander comment la culture –et on incorpore l'artau termeétait pensée par les auteurs de l'Antiquité.
De racine latine cultura, le mot culture comporte dans sa sémantique la notion de soins que l'on doit à la Nature, etmet en exergue une harmonie avec elle.
Dans son étymologie latine, la culture n'est donc pas sentie comme une entité artificielle mais bien comme une entité en lienavec la Nature.
La métaphore de « culture de l'âme » est ainsi pour la première apparue chez un orateur latin du 1er siècle avant Jésus-Christ : Cicéron, dont lapensée a marqué le concept même de philosophie.
Selon lui, l'homme « cultivé » est un homme qui cultive son âme au même titre qu'un agriculteur doit cultiver sesterres.
La culture revêt alors l'aspect d'un travail de « soin de l'âme ».
Pour Cicéron, c'est bien cette culture de l'âme qui est en réalité philosophie.
Le retrait, le reculque nécessite la culture de l'âme constitue l'essence de la philosophie.
Il en va de même pour l'art, compris dans ce terme de « culture », puisque pour être apprécié,l'art nécessite une prise de recul lors de la contemplation artistique, propice à la réflexion et à la culture de l'âme.
La philosophie est alors avant tout un mode vie, unprojet de vie, une activité de toute la vie.
On se rend compte qu'on est assez loin du sens plus moderne qui considère la culture comme une accumulation deconnaissances.
Or dans la tradition antique, ce qui compte, ce n'est pas tant le savoir en lui-même, que la recherche de sens que l'on donne à ce savoir.
Il s'agit alorspar cet exercice de perfectionner son esprit, de perfectionner ce que l'on est déjà.
La philosophie doit aider, en tant que projet de vie à devenir ce que l'on est.
La trèscélèbre formule de Nietzsche est à comprendre en ce sens : « Devient ce que tu es ».
Rousseau reprend cette idée en parlant de la « perfectibilité de l'être », cettecapacité que nous possédons à devenir meilleur que ce que l'on est déjà.
Selon lui, c'est la plus profonde des caractéristiques de l'homme..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- ART DE DOUTER ET DE CROIRE, D’IGNORER ET DE SAVOIR (De l’) (résumé & analyse)
- LA PHILOSOPHIE : LA DISCIPLINE DU « COMMENT SAVOIR » (Exposé – Art & Littérature – Collège/Lycée)
- Dès que le savoir marche le premier, l'art est perdu. Alain
- L'amour de l'art est-il possible sans un savoir sur l'art ?
- Art du début du XX chose importante a savoir