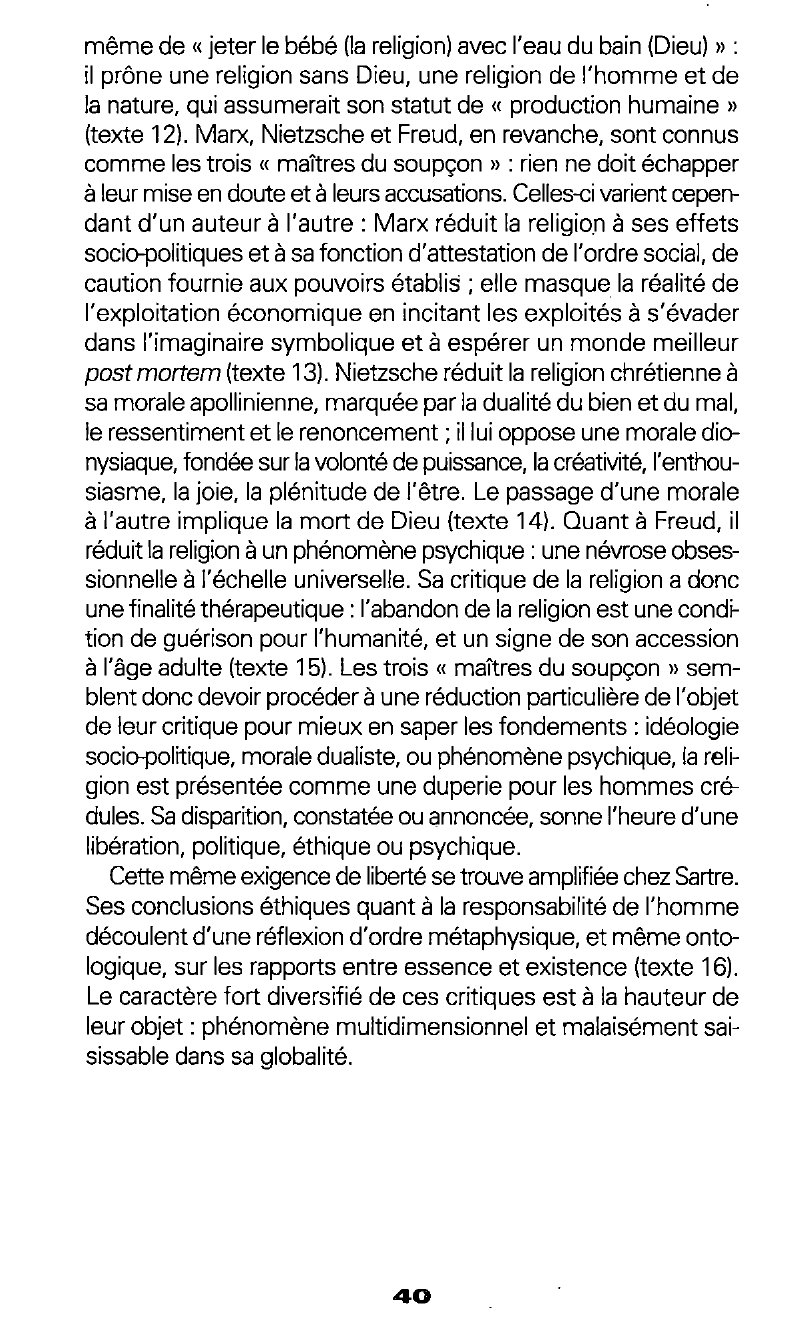Critiquer la religion
Publié le 26/01/2020

Extrait du document

même de « jeter le bébé (la religion) avec l'eau du bain (Dieu) » : il prône une religion sans Dieu, une religion de l'homme et de la nature, qui assumerait son statut de « production humaine » (texte 12). Marx, Nietzsche et Freud, en revanche, sont connus comme les trois « maîtres du soupçon » : rien ne doit échapper à leur mise en doute et à leurs accusations. Celles-ci varient cependant d'un auteur à l'autre : Marx réduit la religion à ses effets socio-politiques et à sa fonction d'attestation de l'ordre social, de caution fournie aux pouvoirs établis ; elle masque la réalité de l'exploitation économique en incitant les exploités à s'évader dans l’imaginaire symbolique et à espérer un monde meilleur postmortem (texte 13). Nietzsche réduit la religion chrétienne à sa morale apollinienne, marquée par la dualité du bien et du mal, le ressentiment et le renoncement ; il lui oppose une morale dionysiaque, fondée sur la volonté de puissance, la créativité, l'enthousiasme, la joie, la plénitude de l'être. Le passage d'une morale à l'autre implique la mort de Dieu (texte 14). Quant à Freud, il réduit la religion à un phénomène psychique : une névrose obsessionnelle à l'échelle universelle. Sa critique de la religion a donc une finalité thérapeutique : l'abandon de la religion est une condition de guérison pour l'humanité, et un signe de son accession à l'âge adulte (texte 15). Les trois « maîtres du soupçon » semblent donc devoir procéder à une réduction particulière de l'objet de leur critique pour mieux en saper les fondements : idéologie sociopolitique, morale dualiste, ou phénomène psychique, la religion est présentée comme une duperie pour les hommes crédules. Sa disparition, constatée ou annoncée, sonne l'heure d'une libération, politique, éthique ou psychique.
Cette même exigence de liberté se trouve amplifiée chez Sartre. Ses conclusions éthiques quant à la responsabilité de l'homme découlent d'une réflexion d'ordre métaphysique, et même ontologique, sur les rapports entre essence et existence (texte 16). Le caractère fort diversifié de ces critiques est à la hauteur de leur objet : phénomène multidimensionnel et malaisément sai-sissable dans sa globalité.
La Critique de la philosophie du Droit de Hegel (1844) est un écrit de jeunesse. Marx n'y développe pas encore son analyse scientifique de l'exploitation économique, ce qu'il fera dans la seconde phase de son itinéraire intellectuel ; il mène une critique politique de la religion comme idéologie, une critique de son instrumentalisation politique, et notamment de sa fonction d'aliénation : l'homme devient étranger à lui-même, au lieu de réaliser son essence. Mais le matérialisme abstrait et statique de Feuerbach ne lui suffit pas ; Marx veut expliquer pourquoi l'homme s'aliène dans la projection religieuse : c'est parce que sa vie réelle est invivable. Si la religion est une conscience inversée du monde, cette inversion n'est pas due à la conscience elle-même, mais est produite par un monde social qui est lui-même à l'envers. C'est donc en partant de la réalité matérielle que Marx déploie sa critique, et en mettant à jour les contradictions inhérentes aux conditions sociales de vie : son matérialisme est par conséquent concret et dialectique.
La religion reçoit dans ce texte de nombreux qualificatifs : en résumé, elle peut être définie par son effet d'assouplissement de conscience, d'oubli de soi et de sa propre réalité. Elle prêche en effet aux pauvres la résignation à leur condition misérable, dans l'attente d'un au-delà meilleur ; et cette double fonction de consolation et de production d'une espérance entrave leurs luttes pour un changement réel de la société.

«
même de« jeter le bébé (la religion) avec l'eau du bain (Dieu) » :
il prône une religion sans Dieu, une religion de l'homme et de
la nature, qui assumerait son statut de « production humaine »
(texte 12).
Marx, Nietzsche et Freud, en revanche, sont connus
comme les trois « maîtres du soupçon » : rien ne doit échapper
à leur mise en doute et à leurs accusations.
Celles-ci varient cepen
dant d'un auteur à l'autre : Marx réduit la religio.n à ses effets
socicrpolitiques et à sa fonction d'attestation de l'ordre social, de
caution fournie aux pouvoirs établis ; elle masque la réalité de
l'exploitation économique en incitant les exploités à s'évader
dans l'imaginaire symbolique et à espérer un monde meilleur
post mortem (texte 13).
Nietzsche réduit la religion chrétienne à
sa morale apollinienne, marquée par la dualité du bien et du mal,
le ressentiment et le renoncement ; il lui oppose une morale dio
nysiaque, fondée sur la volonté de puissance, la créativité, l'enthou
siasme, la joie, la plénitude de l'être.
Le passage d'une morale
à l'autre implique la mort de Dieu (texte 14).
Quant à Freud, il
réduit la religion à un phénomène psychique : une névrose obses
sionnelle à l'échelle universelle.
Sa critique de la religion a donc
une finalité thérapeutique: l'abandon de la religion est une condi
tion de guérison pour l'humanité, et un signe de son accession
à l'âge adulte (texte 15).
Les trois « maîtres du soupçon » sem
blent donc devoir procéder à une réduction particulière de l'objet
de leur critique pour mieux en saper les fondements : idéologie
socicrpolitique, morale dualiste, ou phénomène psychique, la reli
gion est présentée comme une duperie pour les hommes cré
dules.
Sa disparition, constatée ou annoncée, sonne l'heure d'une
libération, politique, éthique ou psychique.
Cette même exigence de liberté se trouve amplifiée chez Sartre.
Ses conclusions éthiques quant à la responsabilité de l'homme
découlent d'une réflexion d'ordre métaphysique, et même onto
logique, sur les rapports entre essence et existence (texte 16).
Le caractère fort diversifié de ces critiques est à la hauteur de
leur objet : phénomène multidimensionnel et malaisément sai
sissable dans sa globalité.
40.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Une religion peut elle être plus vraie qu'une autre ?
- Relationship between religion, spirituality, and young Lebanese university students’ well-being.
- : En quoi ce passage est-il une parodie des romans de chevalerie et une satire de la religion ?
- ANTHROPOLOGIE POLITIQUE ET SOCIALE. THEME : LE MOUVEMENT ALMORAVIDE ENTRE ECONOMIE ET RELIGION.
- Ethique appendice du livre I de Spinoza: déterminisme et religion