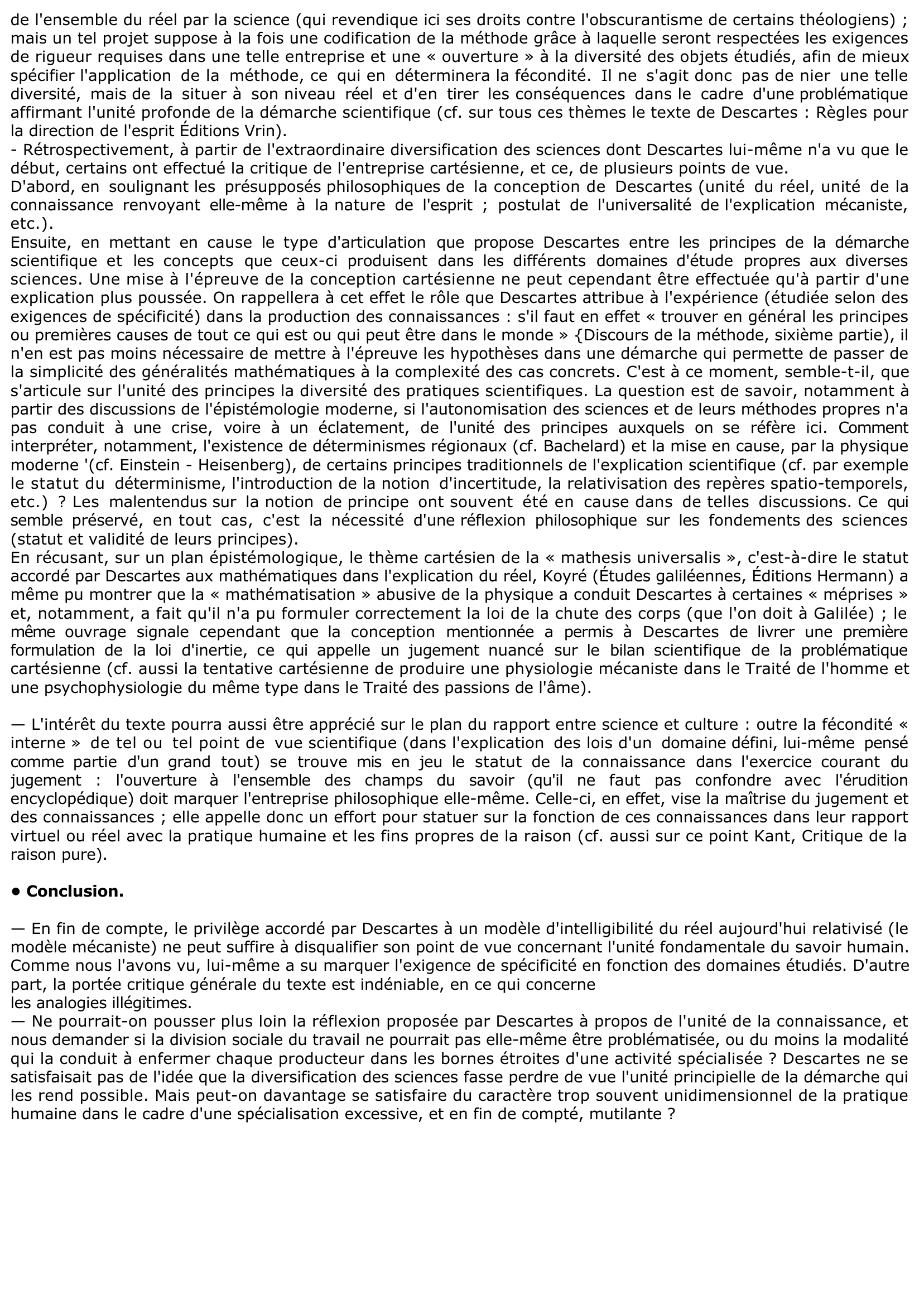Descartes et les arts
Publié le 17/04/2009

Extrait du document
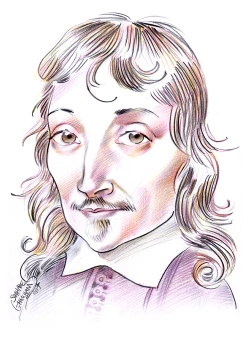
• Dans l'art (ici entendu au sens large de technique) l'homme s'adapte à son objet; son adaptation sera donc d'autant plus grande qu'elle aura moins d'objet. Pour développer l'habileté nécessaire à l'art, il convient donc de se spécialiser. • Ceci n'est pas vrai pour la science. En effet quelle que soit la grande diversité de choses que notre esprit se donne à connaître, sa puissance de connaître demeure constamment identique à elle-même. L'esprit reste toujours pleinement ouvert à tout ce qui se présente à lui. • Pour Descartes, en effet, savoir c'est voir. La connaissance est, au niveau de l'évidence, essentiellement réceptive, passive. Et de même que l'acuité de l'œil ne faiblit pas en raison de la multitude des objets qu'il voit, la faculté de connaître n'est jamais modifiée, empêchée par les objets de la connaissance : « la connaissance d'une vérité ne nous empêche pas d'en découvrir une autre, comme l'exercice d'un art nous empêche d'en apprendre un autre, mais bien plutôt elle nous y aide «. • Texte tiré des Règles pour la direction de l'esprit, I.
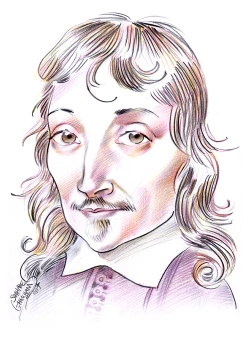
«
de l'ensemble du réel par la science (qui revendique ici ses droits contre l'obscurantisme de certains théologiens) ;mais un tel projet suppose à la fois une codification de la méthode grâce à laquelle seront respectées les exigencesde rigueur requises dans une telle entreprise et une « ouverture » à la diversité des objets étudiés, afin de mieuxspécifier l'application de la méthode, ce qui en déterminera la fécondité.
Il ne s'agit donc pas de nier une tellediversité, mais de la situer à son niveau réel et d'en tirer les conséquences dans le cadre d'une problématiqueaffirmant l'unité profonde de la démarche scientifique (cf.
sur tous ces thèmes le texte de Descartes : Règles pourla direction de l'esprit Éditions Vrin).- Rétrospectivement, à partir de l'extraordinaire diversification des sciences dont Descartes lui-même n'a vu que ledébut, certains ont effectué la critique de l'entreprise cartésienne, et ce, de plusieurs points de vue.D'abord, en soulignant les présupposés philosophiques de la conception de Descartes (unité du réel, unité de laconnaissance renvoyant elle-même à la nature de l'esprit ; postulat de l'universalité de l'explication mécaniste,etc.).Ensuite, en mettant en cause le type d'articulation que propose Descartes entre les principes de la démarchescientifique et les concepts que ceux-ci produisent dans les différents domaines d'étude propres aux diversessciences.
Une mise à l'épreuve de la conception cartésienne ne peut cependant être effectuée qu'à partir d'uneexplication plus poussée.
On rappellera à cet effet le rôle que Descartes attribue à l'expérience (étudiée selon desexigences de spécificité) dans la production des connaissances : s'il faut en effet « trouver en général les principesou premières causes de tout ce qui est ou qui peut être dans le monde » {Discours de la méthode, sixième partie), iln'en est pas moins nécessaire de mettre à l'épreuve les hypothèses dans une démarche qui permette de passer dela simplicité des généralités mathématiques à la complexité des cas concrets.
C'est à ce moment, semble-t-il, ques'articule sur l'unité des principes la diversité des pratiques scientifiques.
La question est de savoir, notamment àpartir des discussions de l'épistémologie moderne, si l'autonomisation des sciences et de leurs méthodes propres n'apas conduit à une crise, voire à un éclatement, de l'unité des principes auxquels on se réfère ici.
Commentinterpréter, notamment, l'existence de déterminismes régionaux (cf.
Bachelard) et la mise en cause, par la physiquemoderne '(cf.
Einstein - Heisenberg), de certains principes traditionnels de l'explication scientifique (cf.
par exemplele statut du déterminisme, l'introduction de la notion d'incertitude, la relativisation des repères spatio-temporels,etc.) ? Les malentendus sur la notion de principe ont souvent été en cause dans de telles discussions.
Ce quisemble préservé, en tout cas, c'est la nécessité d'une réflexion philosophique sur les fondements des sciences(statut et validité de leurs principes).En récusant, sur un plan épistémologique, le thème cartésien de la « mathesis universalis », c'est-à-dire le statutaccordé par Descartes aux mathématiques dans l'explication du réel, Koyré (Études galiléennes, Éditions Hermann) amême pu montrer que la « mathématisation » abusive de la physique a conduit Descartes à certaines « méprises »et, notamment, a fait qu'il n'a pu formuler correctement la loi de la chute des corps (que l'on doit à Galilée) ; lemême ouvrage signale cependant que la conception mentionnée a permis à Descartes de livrer une premièreformulation de la loi d'inertie, ce qui appelle un jugement nuancé sur le bilan scientifique de la problématiquecartésienne (cf.
aussi la tentative cartésienne de produire une physiologie mécaniste dans le Traité de l'homme etune psychophysiologie du même type dans le Traité des passions de l'âme).
— L'intérêt du texte pourra aussi être apprécié sur le plan du rapport entre science et culture : outre la fécondité «interne » de tel ou tel point de vue scientifique (dans l'explication des lois d'un domaine défini, lui-même pensécomme partie d'un grand tout) se trouve mis en jeu le statut de la connaissance dans l'exercice courant dujugement : l'ouverture à l'ensemble des champs du savoir (qu'il ne faut pas confondre avec l'éruditionencyclopédique) doit marquer l'entreprise philosophique elle-même.
Celle-ci, en effet, vise la maîtrise du jugement etdes connaissances ; elle appelle donc un effort pour statuer sur la fonction de ces connaissances dans leur rapportvirtuel ou réel avec la pratique humaine et les fins propres de la raison (cf.
aussi sur ce point Kant, Critique de laraison pure).
• Conclusion.
— En fin de compte, le privilège accordé par Descartes à un modèle d'intelligibilité du réel aujourd'hui relativisé (lemodèle mécaniste) ne peut suffire à disqualifier son point de vue concernant l'unité fondamentale du savoir humain.Comme nous l'avons vu, lui-même a su marquer l'exigence de spécificité en fonction des domaines étudiés.
D'autrepart, la portée critique générale du texte est indéniable, en ce qui concerneles analogies illégitimes.— Ne pourrait-on pousser plus loin la réflexion proposée par Descartes à propos de l'unité de la connaissance, etnous demander si la division sociale du travail ne pourrait pas elle-même être problématisée, ou du moins la modalitéqui la conduit à enfermer chaque producteur dans les bornes étroites d'une activité spécialisée ? Descartes ne sesatisfaisait pas de l'idée que la diversification des sciences fasse perdre de vue l'unité principielle de la démarche quiles rend possible.
Mais peut-on davantage se satisfaire du caractère trop souvent unidimensionnel de la pratiquehumaine dans le cadre d'une spécialisation excessive, et en fin de compté, mutilante ?.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Descartes: Science et arts
- L'USAGE DES MATHÉMATIQUES "Les mathématiques ont des inventions très subtiles et qui peuvent beaucoup servir, tant à contenter les curieux, qu'à faciliter tous les arts." Descartes, Discours de la méthode, 1637. Commentez cette citation.
- « Ce mot de philosophie signifie l'étude de la sagesse et... par sagesse... on n'entend pas seulement la prudence dans les affaires mais une parfaite connaissance de toutes les choses que l'homme peut savoir tant pour la conduite de sa vie que pour la conservation de sa santé et l'invention de tous les arts. » (DESCARTES, Principes de philosophie.). Commentez cette citation.
- HdA au Brevet 3e1 Objet d’étude : Arts et progrès techniques Thématique Domaine Période Arts, rupture et continuité Art du langage XXe siècle
- HISTOIRE DES ARTS SUR « MEME LA PLUIE » L'HISTOIRE : un éternel recommencement ?