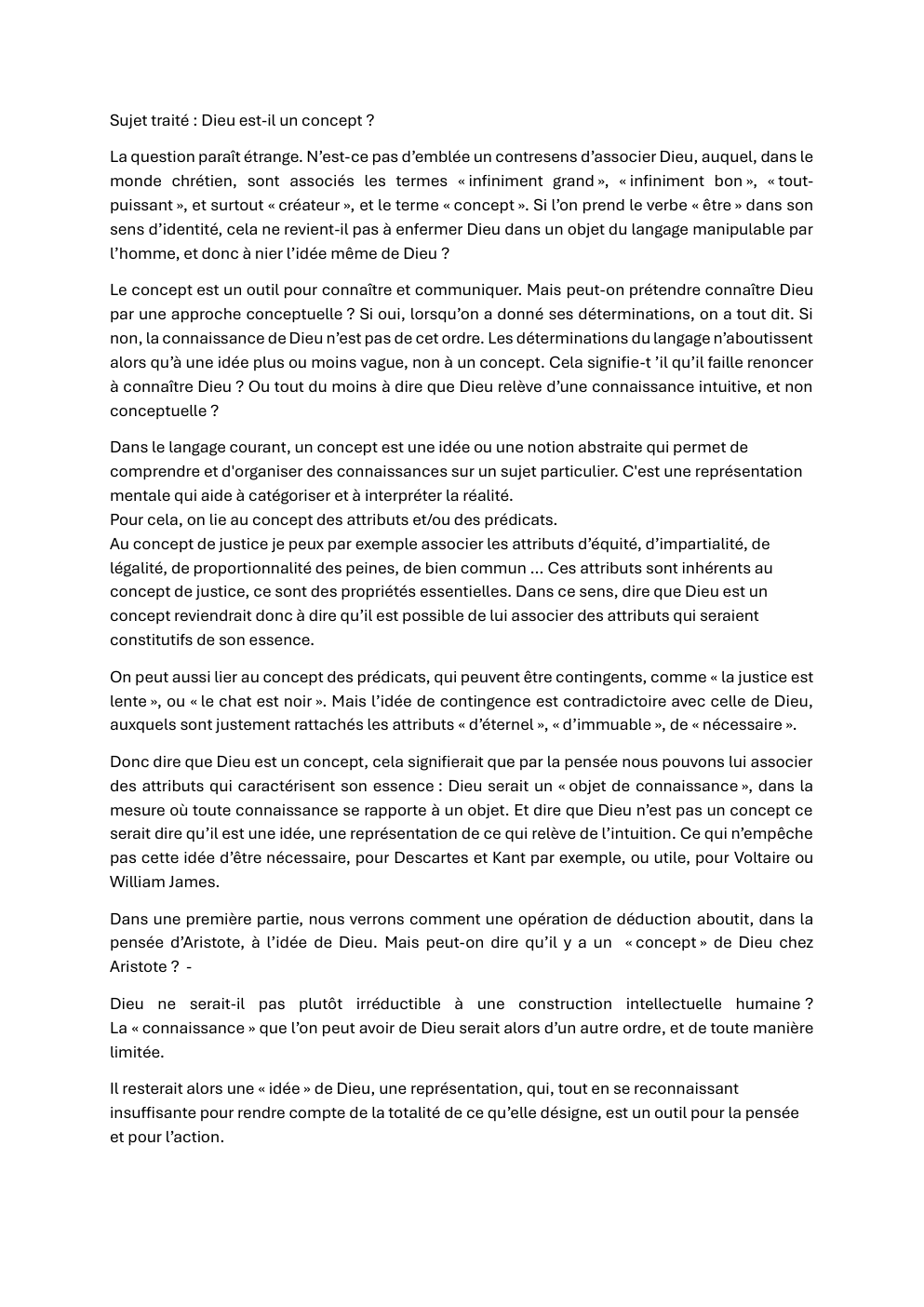Dieu est il un concept ?
Publié le 11/07/2025
Extrait du document
«
Sujet traité : Dieu est-il un concept ?
La question paraît étrange.
N’est-ce pas d’emblée un contresens d’associer Dieu, auquel, dans le
monde chrétien, sont associés les termes « infiniment grand », « infiniment bon », « toutpuissant », et surtout « créateur », et le terme « concept ».
Si l’on prend le verbe « être » dans son
sens d’identité, cela ne revient-il pas à enfermer Dieu dans un objet du langage manipulable par
l’homme, et donc à nier l’idée même de Dieu ?
Le concept est un outil pour connaître et communiquer.
Mais peut-on prétendre connaître Dieu
par une approche conceptuelle ? Si oui, lorsqu’on a donné ses déterminations, on a tout dit.
Si
non, la connaissance de Dieu n’est pas de cet ordre.
Les déterminations du langage n’aboutissent
alors qu’à une idée plus ou moins vague, non à un concept.
Cela signifie-t ’il qu’il faille renoncer
à connaître Dieu ? Ou tout du moins à dire que Dieu relève d’une connaissance intuitive, et non
conceptuelle ?
Dans le langage courant, un concept est une idée ou une notion abstraite qui permet de
comprendre et d'organiser des connaissances sur un sujet particulier.
C'est une représentation
mentale qui aide à catégoriser et à interpréter la réalité.
Pour cela, on lie au concept des attributs et/ou des prédicats.
Au concept de justice je peux par exemple associer les attributs d’équité, d’impartialité, de
légalité, de proportionnalité des peines, de bien commun … Ces attributs sont inhérents au
concept de justice, ce sont des propriétés essentielles.
Dans ce sens, dire que Dieu est un
concept reviendrait donc à dire qu’il est possible de lui associer des attributs qui seraient
constitutifs de son essence.
On peut aussi lier au concept des prédicats, qui peuvent être contingents, comme « la justice est
lente », ou « le chat est noir ».
Mais l’idée de contingence est contradictoire avec celle de Dieu,
auxquels sont justement rattachés les attributs « d’éternel », « d’immuable », de « nécessaire ».
Donc dire que Dieu est un concept, cela signifierait que par la pensée nous pouvons lui associer
des attributs qui caractérisent son essence : Dieu serait un « objet de connaissance », dans la
mesure où toute connaissance se rapporte à un objet.
Et dire que Dieu n’est pas un concept ce
serait dire qu’il est une idée, une représentation de ce qui relève de l’intuition.
Ce qui n’empêche
pas cette idée d’être nécessaire, pour Descartes et Kant par exemple, ou utile, pour Voltaire ou
William James.
Dans une première partie, nous verrons comment une opération de déduction aboutit, dans la
pensée d’Aristote, à l’idée de Dieu.
Mais peut-on dire qu’il y a un « concept » de Dieu chez
Aristote ? Dieu ne serait-il pas plutôt irréductible à une construction intellectuelle humaine ?
La « connaissance » que l’on peut avoir de Dieu serait alors d’un autre ordre, et de toute manière
limitée.
Il resterait alors une « idée » de Dieu, une représentation, qui, tout en se reconnaissant
insuffisante pour rendre compte de la totalité de ce qu’elle désigne, est un outil pour la pensée
et pour l’action.
Pour Aristote, qui ne parle pas encore de concept, une notion est une connaissance acquise par
l’intellect à part de l’expérience sensible.
Dans ce sens, Dieu ne pourrait être une notion.
Pourtant, par déduction, à partir du constat de l’impossibilité d’un « avant le temps » et « avant le
mouvement », Aristote aboutit à la nécessité d’un « premier moteur », qui « meut sans être mû,
qui est éternel, à la fois substance et acte » (Métaphysique Λ Chap.
7 1072a).
Cette « cause
finale » meut toute chose « comme objet de désir » (1072b), en tant qu’il est « désirable et
intelligible ».
De ce « principe » (1072b), Aristote nous dit qu’il est « de la nature du beau », qu’il a
« l’intellection de lui-même », que sa vie est « acte », qu’il est « l’animal éternel et le meilleur ».
Ce premier moteur est loin du Dieu chrétien.
Il est un principe, une réalité métaphysique, à la
fois origine et fin, il est « objet du désir » mais n’est pas lui-même amour.
La théologie d’Aristote
est négative (P.
Aubenque) : Dieu est inétendu, immatériel, sans génération, sans quantité et
sans qualité.
On ne peut finalement rien en dire, car le langage humain se formule au travers de
la temporalité, de la succession, du mouvement.
En langage moderne, on pourrait donc dire que pour Aristote le premier moteur n’est donc tout
au plus qu’un concept explicatif du mouvement et du temps.
D’emblée, il y a donc une difficulté intrinsèque, et peut être même une impossibilité, à déterminer
Dieu.
Faut-il donc renoncer à « dire Dieu », à en faire un objet du langage, et donc du raisonnement
logique ?
Au chapitre 4 du livre VI des Confessions, St Augustin décrit comment il a échoué à
« comprendre toutes choses » « avec la « même certitude que trois et sept font dix » : seule la foi
lui permettra de « guérir son âme » et « d’assurer sa vue » sur la vérité divine.
En effet, nous ne pouvons attribuer de détermination qu’à partir de notre propre rapport au
monde.
Au chapitre 1er du Livre VII, il évoque sa grande difficulté à connaître Dieu.
Il ne peut se
« représenter autrement une substance que comme quelque chose de corporel et qui peut se
voir par les yeux du corps ».
Mais il ne renonce pas cependant à l’usage de sa raison dans sa relation à Dieu.
Au Chapitre XIV du livre VII des Confessions, c’est bien son entendement que Dieu éclaire afin
de lui permettre de le connaitre.
C’est l’ordre de la création qui lui rend « intelligibles et comme
visibles » les attributs de Dieu ; « grandeurs invisibles, puissance éternelle, divinité souveraine ».
Selon une progression très platonicienne, St Augustin monte « par degré » « de la connaissance
des corps à celle de l’âme sensitive », puis « jusqu’à la puissance intérieure », puis « jusqu’à la
partie supérieure de l’âme de l’homme qui par le raisonnement et le discours juge de tout ce
que les sens lui rapportent » (livre VII chap XVII).
Son âme s’élève ensuite jusqu’à « la plus haute
manière de concevoir et de connaitre », se débarrasse de ses représentations habituelles pour
enfin découvrir « quelle est la lumière qui l’éclaire dans la connaissance du bien immuable ».
La connaissance à laquelle il parvient est donc « au-delà » du concept, au-delà de ce que peut
produire son jugement.
L’être de Dieu ne saurait être envisagé par l’esprit humain que « par des regards tremblants et
qui passent comme un éclair ».
(livre VII chap XVII.
Dieu se trouve dans sa mémoire, mais il ne
parvient pas à le situer plus précisément.
C’est en Dieu même que se situe la connaissance de
Dieu « Où ai-je pu vous connaître et vous trouver, sinon en....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Il nous faut bien un concept de Dieu
- Le concept de Dieu
- Le concept de DIEU en philosophie ?
- Quel concept de Dieu après Auschwitz ?
- HANS JONAS : LE CONCEPT DE DIEU APRES AUSCHWITZ (Résumé & Analyse)