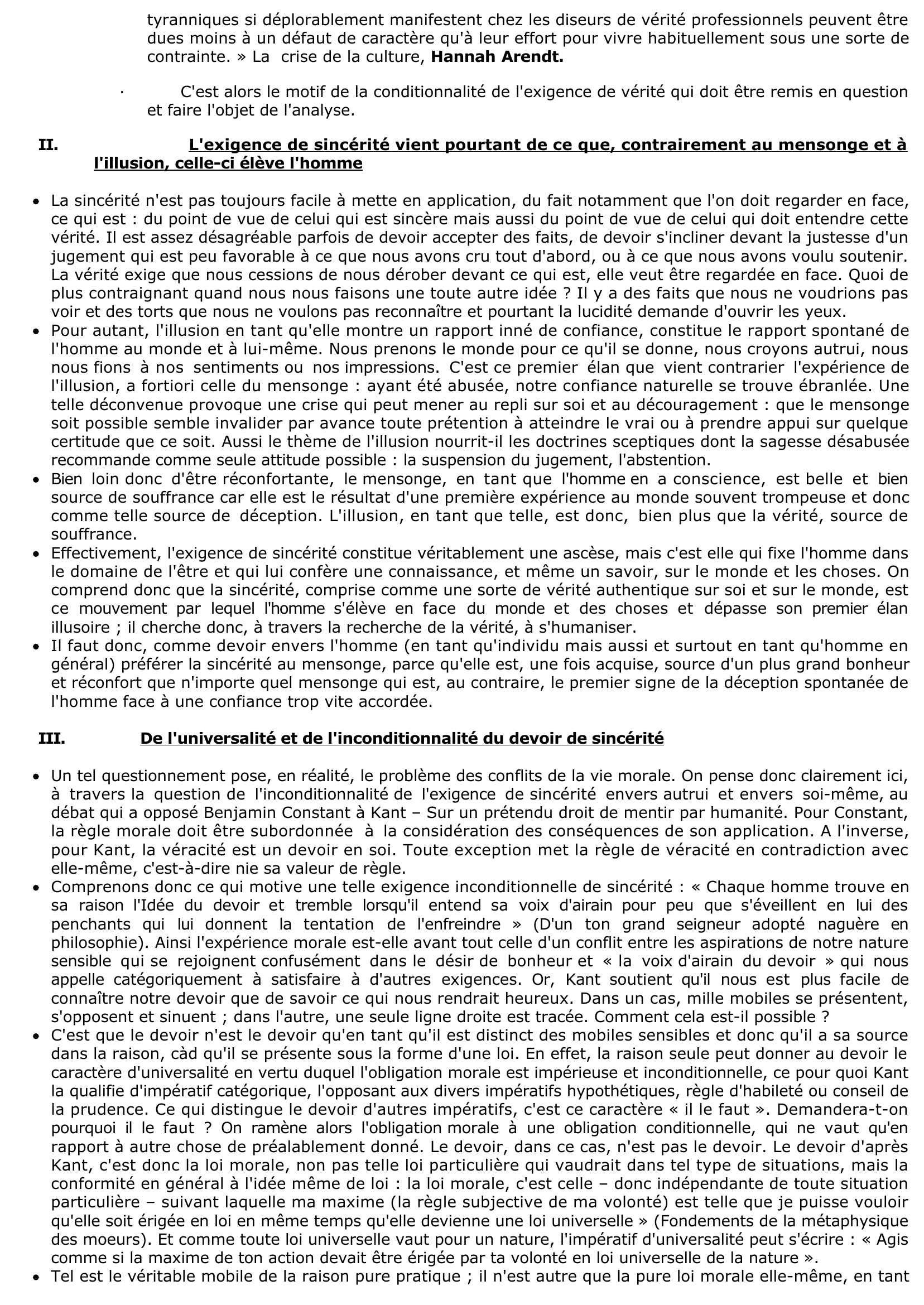Doit-on être sincère ?
Publié le 27/02/2008

Extrait du document
Doit-on être sincère ?
- Analyse du sujet
- L’obligation qui caractérise le devoir est distincte de la nécessité, que celle-ci se manifeste sous forme d’une tendance à agir à laquelle nous nous soumettrions sans recours possible, et qui serait alors équivalente à un instinct, ou sous l’espèce d’une force extérieure agissant sur nous. Le devoir concerne la volonté, ne concerne qu’un être susceptible de choisir : en ce sens, je dois le faire implique que je puisse ne pas le faire. Pour comprendre la notion de devoir, il faut donc écarter tous les emplois qui assimilent le devoir à une nécessité : « il doit avoir raison, il connaît son affaire «, « il doit être arrivé à présent «, « la sommes des angles d’un triangle doit être égale à deux droits «.
- Une 2e réduction préliminaire exige de distinguer les devoirs et le devoir. Il y a des obligations qui sont liées à l’exercice d’une fonction ; on évoquera les devoirs de sa charges pour indiquer qu’une condition éminente, qu’une dignité particulière comportent des obligations distinctives, que le privilège est assorti de servitude spécifiques. Or, ces devoirs sont relatifs à une condition qui, sans être nécessairement éminente, est tjrs particulières, alors que le devoir est une obligation pour tout homme quelle que soit sa condition, dans laquelle chacun se reconnaît en tant qu’homme simplement.
- On part couramment du principe que « toute vérité n’est pas bonne à dire «, partant du fait que la sincérité est parfois source de souffrance inutile. En ce sens la nécessité de la vie en société implique avec elle celui, si ce n’est du mensonge au moins peut-être de l’hypocrisie : pourquoi en effet attiser la haine quand on peut l’éviter.
- Une telle conception repose sur une conception de la sincérité comme exigence ascétique, source de souffrance. Or, même si la sincérité naît dans une souffrance originelle, n’est-elle pas source de délivrance, tant par rapport aux autres que par rapport à soi-même.
- Notons que ce qui est ici à la question c’est bien le fait de savoir si l’on peut considérer la sincérité comme une devoir – c’est-à-dire comme un impératif catégorique, nécessaire, universel, et donc proprement moral – ou si au contraire il ne s’agit là que d’une exigence conditionnelle. C’est donc la nature de notre rapport à la morale en tant que telle qui se trouve ainsi mise à la question à travers la sincérité.
«
tyranniques si déplorablement manifestent chez les diseurs de vérité professionnels peuvent êtredues moins à un défaut de caractère qu'à leur effort pour vivre habituellement sous une sorte decontrainte.
» La crise de la culture, Hannah Arendt.
· C'est alors le motif de la conditionnalité de l'exigence de vérité qui doit être remis en question et faire l'objet de l'analyse.
II.
L'exigence de sincérité vient pourtant de ce que, contrairement au mensonge et à l'illusion, celle-ci élève l'homme La sincérité n'est pas toujours facile à mette en application, du fait notamment que l'on doit regarder en face,ce qui est : du point de vue de celui qui est sincère mais aussi du point de vue de celui qui doit entendre cettevérité.
Il est assez désagréable parfois de devoir accepter des faits, de devoir s'incliner devant la justesse d'unjugement qui est peu favorable à ce que nous avons cru tout d'abord, ou à ce que nous avons voulu soutenir.La vérité exige que nous cessions de nous dérober devant ce qui est, elle veut être regardée en face.
Quoi deplus contraignant quand nous nous faisons une toute autre idée ? Il y a des faits que nous ne voudrions pasvoir et des torts que nous ne voulons pas reconnaître et pourtant la lucidité demande d'ouvrir les yeux.Pour autant, l'illusion en tant qu'elle montre un rapport inné de confiance, constitue le rapport spontané del'homme au monde et à lui-même.
Nous prenons le monde pour ce qu'il se donne, nous croyons autrui, nousnous fions à nos sentiments ou nos impressions.
C'est ce premier élan que vient contrarier l'expérience del'illusion, a fortiori celle du mensonge : ayant été abusée, notre confiance naturelle se trouve ébranlée.
Unetelle déconvenue provoque une crise qui peut mener au repli sur soi et au découragement : que le mensongesoit possible semble invalider par avance toute prétention à atteindre le vrai ou à prendre appui sur quelquecertitude que ce soit.
Aussi le thème de l'illusion nourrit-il les doctrines sceptiques dont la sagesse désabuséerecommande comme seule attitude possible : la suspension du jugement, l'abstention.Bien loin donc d'être réconfortante, le mensonge, en tant que l'homme en a conscience, est belle et biensource de souffrance car elle est le résultat d'une première expérience au monde souvent trompeuse et donccomme telle source de déception.
L'illusion, en tant que telle, est donc, bien plus que la vérité, source desouffrance.Effectivement, l'exigence de sincérité constitue véritablement une ascèse, mais c'est elle qui fixe l'homme dansle domaine de l'être et qui lui confère une connaissance, et même un savoir, sur le monde et les choses.
Oncomprend donc que la sincérité, comprise comme une sorte de vérité authentique sur soi et sur le monde, estce mouvement par lequel l'homme s'élève en face du monde et des choses et dépasse son premier élanillusoire ; il cherche donc, à travers la recherche de la vérité, à s'humaniser.Il faut donc, comme devoir envers l'homme (en tant qu'individu mais aussi et surtout en tant qu'homme engénéral) préférer la sincérité au mensonge, parce qu'elle est, une fois acquise, source d'un plus grand bonheuret réconfort que n'importe quel mensonge qui est, au contraire, le premier signe de la déception spontanée del'homme face à une confiance trop vite accordée. III. De l'universalité et de l'inconditionnalité du devoir de sincérité Un tel questionnement pose, en réalité, le problème des conflits de la vie morale.
On pense donc clairement ici,à travers la question de l'inconditionnalité de l'exigence de sincérité envers autrui et envers soi-même, audébat qui a opposé Benjamin Constant à Kant – Sur un prétendu droit de mentir par humanité.
Pour Constant,la règle morale doit être subordonnée à la considération des conséquences de son application.
A l'inverse,pour Kant, la véracité est un devoir en soi.
Toute exception met la règle de véracité en contradiction avecelle-même, c'est-à-dire nie sa valeur de règle.Comprenons donc ce qui motive une telle exigence inconditionnelle de sincérité : « Chaque homme trouve ensa raison l'Idée du devoir et tremble lorsqu'il entend sa voix d'airain pour peu que s'éveillent en lui despenchants qui lui donnent la tentation de l'enfreindre » (D'un ton grand seigneur adopté naguère enphilosophie).
Ainsi l'expérience morale est-elle avant tout celle d'un conflit entre les aspirations de notre naturesensible qui se rejoignent confusément dans le désir de bonheur et « la voix d'airain du devoir » qui nousappelle catégoriquement à satisfaire à d'autres exigences.
Or, Kant soutient qu'il nous est plus facile deconnaître notre devoir que de savoir ce qui nous rendrait heureux.
Dans un cas, mille mobiles se présentent,s'opposent et sinuent ; dans l'autre, une seule ligne droite est tracée.
Comment cela est-il possible ?C'est que le devoir n'est le devoir qu'en tant qu'il est distinct des mobiles sensibles et donc qu'il a sa sourcedans la raison, càd qu'il se présente sous la forme d'une loi.
En effet, la raison seule peut donner au devoir lecaractère d'universalité en vertu duquel l'obligation morale est impérieuse et inconditionnelle, ce pour quoi Kantla qualifie d'impératif catégorique, l'opposant aux divers impératifs hypothétiques, règle d'habileté ou conseil dela prudence.
Ce qui distingue le devoir d'autres impératifs, c'est ce caractère « il le faut ».
Demandera-t-onpourquoi il le faut ? On ramène alors l'obligation morale à une obligation conditionnelle, qui ne vaut qu'enrapport à autre chose de préalablement donné.
Le devoir, dans ce cas, n'est pas le devoir.
Le devoir d'aprèsKant, c'est donc la loi morale, non pas telle loi particulière qui vaudrait dans tel type de situations, mais laconformité en général à l'idée même de loi : la loi morale, c'est celle – donc indépendante de toute situationparticulière – suivant laquelle ma maxime (la règle subjective de ma volonté) est telle que je puisse vouloirqu'elle soit érigée en loi en même temps qu'elle devienne une loi universelle » (Fondements de la métaphysiquedes moeurs).
Et comme toute loi universelle vaut pour un nature, l'impératif d'universalité peut s'écrire : « Agiscomme si la maxime de ton action devait être érigée par ta volonté en loi universelle de la nature ».Tel est le véritable mobile de la raison pure pratique ; il n'est autre que la pure loi morale elle-même, en tant.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- la connaissance de soi peut-elle être sincère ?
- Arnolphe :amoureux sincère ou manipulateur ?
- Que soit vrai tout ce que l'on dit tant aux autres qu'à soi-même, c'est ce qu'il est impossible de garantir dans tous les cas, parce qu'on peut se tromper ; mais que ce soit sincère, c'est ce que l'on peut et doit toujours garantir, parce qu'on s'en rend compte immédiatement.
- Ovide par Georges Dumézil de l'Académie française Je vais peut-être donner la preuve d'un goût déformé : dans l'oeuvre d'Ovide, les Fastes sont, je crois, le morceau le plus puissant, le plus habile, le plus sincère.
- l'intention sincère de les permettre réellement?