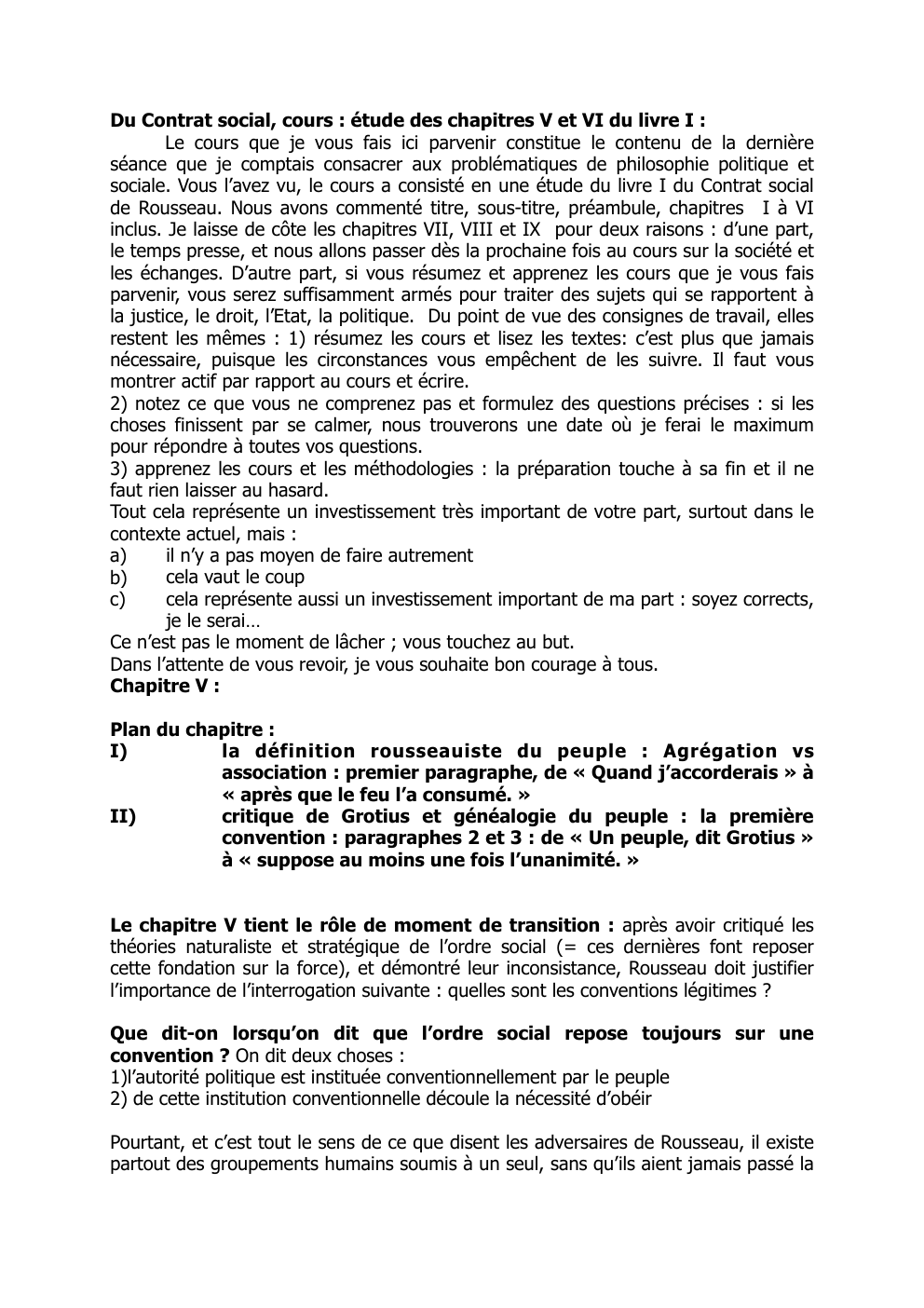Du Contrat social, cours : étude des chapitres V et VI du livre I
Publié le 13/10/2025
Extrait du document
«
Du Contrat social, cours : étude des chapitres V et VI du livre I :
Le cours que je vous fais ici parvenir constitue le contenu de la dernière
séance que je comptais consacrer aux problématiques de philosophie politique et
sociale.
Vous l’avez vu, le cours a consisté en une étude du livre I du Contrat social
de Rousseau.
Nous avons commenté titre, sous-titre, préambule, chapitres I à VI
inclus.
Je laisse de côte les chapitres VII, VIII et IX pour deux raisons : d’une part,
le temps presse, et nous allons passer dès la prochaine fois au cours sur la société et
les échanges.
D’autre part, si vous résumez et apprenez les cours que je vous fais
parvenir, vous serez suffisamment armés pour traiter des sujets qui se rapportent à
la justice, le droit, l’Etat, la politique.
Du point de vue des consignes de travail, elles
restent les mêmes : 1) résumez les cours et lisez les textes: c’est plus que jamais
nécessaire, puisque les circonstances vous empêchent de les suivre.
Il faut vous
montrer actif par rapport au cours et écrire.
2) notez ce que vous ne comprenez pas et formulez des questions précises : si les
choses finissent par se calmer, nous trouverons une date où je ferai le maximum
pour répondre à toutes vos questions.
3) apprenez les cours et les méthodologies : la préparation touche à sa fin et il ne
faut rien laisser au hasard.
Tout cela représente un investissement très important de votre part, surtout dans le
contexte actuel, mais :
il n’y a pas moyen de faire autrement
a)
cela vaut le coup
b)
cela représente aussi un investissement important de ma part : soyez corrects,
c)
je le serai…
Ce n’est pas le moment de lâcher ; vous touchez au but.
Dans l’attente de vous revoir, je vous souhaite bon courage à tous.
Chapitre V :
Plan du chapitre :
la définition rousseauiste du peuple : Agrégation vs
I)
association : premier paragraphe, de « Quand j’accorderais » à
« après que le feu l’a consumé.
»
critique de Grotius et généalogie du peuple : la première
II)
convention : paragraphes 2 et 3 : de « Un peuple, dit Grotius »
à « suppose au moins une fois l’unanimité.
»
Le chapitre V tient le rôle de moment de transition : après avoir critiqué les
théories naturaliste et stratégique de l’ordre social (= ces dernières font reposer
cette fondation sur la force), et démontré leur inconsistance, Rousseau doit justifier
l’importance de l’interrogation suivante : quelles sont les conventions légitimes ?
Que dit-on lorsqu’on dit que l’ordre social repose toujours sur une
convention ? On dit deux choses :
1)l’autorité politique est instituée conventionnellement par le peuple
2) de cette institution conventionnelle découle la nécessité d’obéir
Pourtant, et c’est tout le sens de ce que disent les adversaires de Rousseau, il existe
partout des groupements humains soumis à un seul, sans qu’ils aient jamais passé la
moindre convention.
Rousseau l’admet.
Mais, dit-il, un regroupement des individus
ne constitue pas encore un peuple.
Qu’est-ce qu’un peuple ? C’est l’unité d’une pluralité ; un certain mode d’unité.
Mais quels sont les facteurs qui maintiennent cette unité entre les éléments si épars
d’une telle diversité ? Le bien public et l’intérêt général, qui permettent le maintien
du corps politique.
La multitude ne devient réellement un peuple que lorsqu’elle ses
membres se lient les uns aux autres par l’acte du contrat.
Qu’est-ce que le contrat ?
Une opération volontaire.
On en déduit donc que dans le peuple, l’unité est
volontaire.
Comment procède l’argumentation de Rousseau dans ce chapitre ? Par
oppositions conceptuelles successives.
La première opposition, la plus fondamentale,
c’est celle qui structure tout le livre I du Contrat social : fait/ droit ; c-à-d l’opposition
entre ce qui est et ce qui doit être.
Dans ce chapitre, cette opposition se décline dans
une
opposition entre deux types de groupements humains, l’agrégation et
l’association.
Ce qui existe réellement, ce qui relève donc du fait, ce sont des groupes
humains agrégés.
Qu’est-ce que cela signifie ? Dans le modèle de l’agrégation, l’unité
de la multitude est fictive.
Sous l’apparence de l’unité, les individus restent épars.
Pourquoi ? Parce que le lien social n’est qu’externe, c-à-d qu’il procède d’une force
qui maintient ensemble les individus.
Lorsque cette force, qui peut être par exemple
la puissance d’un prince, cesse de s’exercer, l’agrégation se dissout.
L’association, quant à elle, relève de l’ordre du droit, c-à-d de ce qui doit être.
Quand
les individus ne sont pas seulement agrégés les uns aux autres mais associés, le lien
social est interne.
Pourquoi ? Parce qu’il procède de la volonté qu’ont les membres de
rester associés, et non pas d’une force extérieure.
Le lien associatif est volontaire,
libre et contractuel : il fonde donc une obligation.
On peut donc poser et résoudre le problème suivant : qu’est-ce qui rend légitime le
fait d’obéir ? Une obéissance libre, c-à-d une obéissance qui relève de l’association.
Dans une multitude agrégée, les membres sont rassemblés, regroupés mais restent
épars parce qu’ils ne sont pas unis par un intérêt commun et par une volonté
commune= il ne font pas corps.
Le problème au cœur du chap V est donc le
suivant : voir comment la multitude devient un corps politique.
Que signifie la
conception rousseauiste du peuple ? Que l’identité d’un peuple n’est pas tant
culturelle que politique.
En un mot, selon Rousseau, l’appartenance à la nation
française ne se fonde pas tant que la possession commune d’ancêtres celtes et
romains entre les Français, que sur la volonté commune d’appartenir politiquement à
la nation française, c-à-d sur la volonté d’accepter les obligations et la jouissance des
droits octroyés à tout citoyen français, quelque soit l’origine culturelle de ses
ancêtres.
Quelle est donc, pour reprendre le titre du chapitre, la première convention
à laquelle il faut remonter pour penser le fondement légitime de l’ordre
social ? La convention contractuelle qui fait d’une multitude d’individus épars un
peuple.
C’est précisément ce que Grotius n’a pas vu, lorsqu’il affirme qu’un peuple
peut se donner tout entier à un roi.
Lorsqu’il affirme cela, Grotius présuppose que les
hommes en question forment déjà un peuple.
Or, Rousseau l’a montré, cela ne peut
se faire que par l’adoption d’une convention ; la première, celle qui institue une
multitude en peuple.
La convention instituant la multitude en peuple est la première de toutes, et se
trouve à la base de toutes les autres.
Ainsi, dit Rousseau, il peut paraître légitime
d’imaginer un peuple qui se donnerait tout entier au roi.
Comment ? Par exemple
après un vote au cours duquel la majorité des suffrages se serait prononcé en
faveur de cet échange.
Mais la validité de ce vote, fondé sur le pouvoir de la majorité
des suffrages, présuppose une convention antérieure : la convention par laquelle
tous les individus ont décidé que les votes à venir se feraient à la majorité.
Or, cette
première convention a dû être adoptée à l’unanimité, c-à-d par tous sans exception,
et par son intermédiaire, la multitude des individus s’est instituée en peuple.
Chapitre VI : Du pacte social :
Plan du chapitre :
la formation de la multitude sous l’effet des catastrophes
I)
naturelles : de « Je suppose » à « faire agir de concert.
»
La position du problème : de « Cette somme de force » à « Tel
II)
est le problème fondamental dont le contrat social donne la
solution.
»
Description du contrat et corps politique: de « Les clauses de
III)
ce contrat » à « indivisible du tout.
»
Les figures de la personne publique : de « A l’instant, au lieu
IV)
de la personne particulière » à « il suffit de les savoir
distinguer quand ils sont employés dans toute leur précision.
»
I)
Je passe sur le premier moment du texte : Rousseau dit seulement que puisque
l’abondance de l’état de nature a été rompue par un certain nombre de catastrophes
naturelles, les hommes se sont trouvés contraints de se regrouper pour faire face
aux difficultés de leur nouvel environnement.
Cela nécessite qu’ils agrègent leurs
forces pour agir de façon efficace.
Mais tous ces individus regroupés, en tant qu’ils étaient membres de l’état de nature,
sont dépositaires d’un droit naturel : la liberté, ou encore le pouvoir d’agir sans être
soumis à la contrainte d’autrui.
II)
De là la position d’un problème, qui fait l’objet du deuxième moment du
texte :que doit être un ordre politique juste ? A cette question, Rousseau
répond qu’un ordre politique juste, c’est un ordre fondé sur un contrat dont les
clauses sont susceptibles d’associer les individus pour leur faire former un corps
politique.
Rousseau y formule le problème fondamental du droit politique : celui de
savoir ce que doit être un ordre politique juste.
Un ordre politique juste, c’est un
ordre fondé sur un contrat dont les clauses sont susceptibles d’associer les individus
pour leur faire former un corps politique .Mais....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- L'inaliénabilité de la liberté comme fondement du droit. Étude du Livre I, chapitre IV du Contrat Social de Jean-Jacques Rousseau
- Rousseau, Du contrat social, livre IV, chapitre II, des suffrages
- Analyse livre 1 Du contrat social rousseau
- Du Contrat social, livre I, chapitre VIII
- Rousseau. Du Contrat social, livre I. Oral du bac