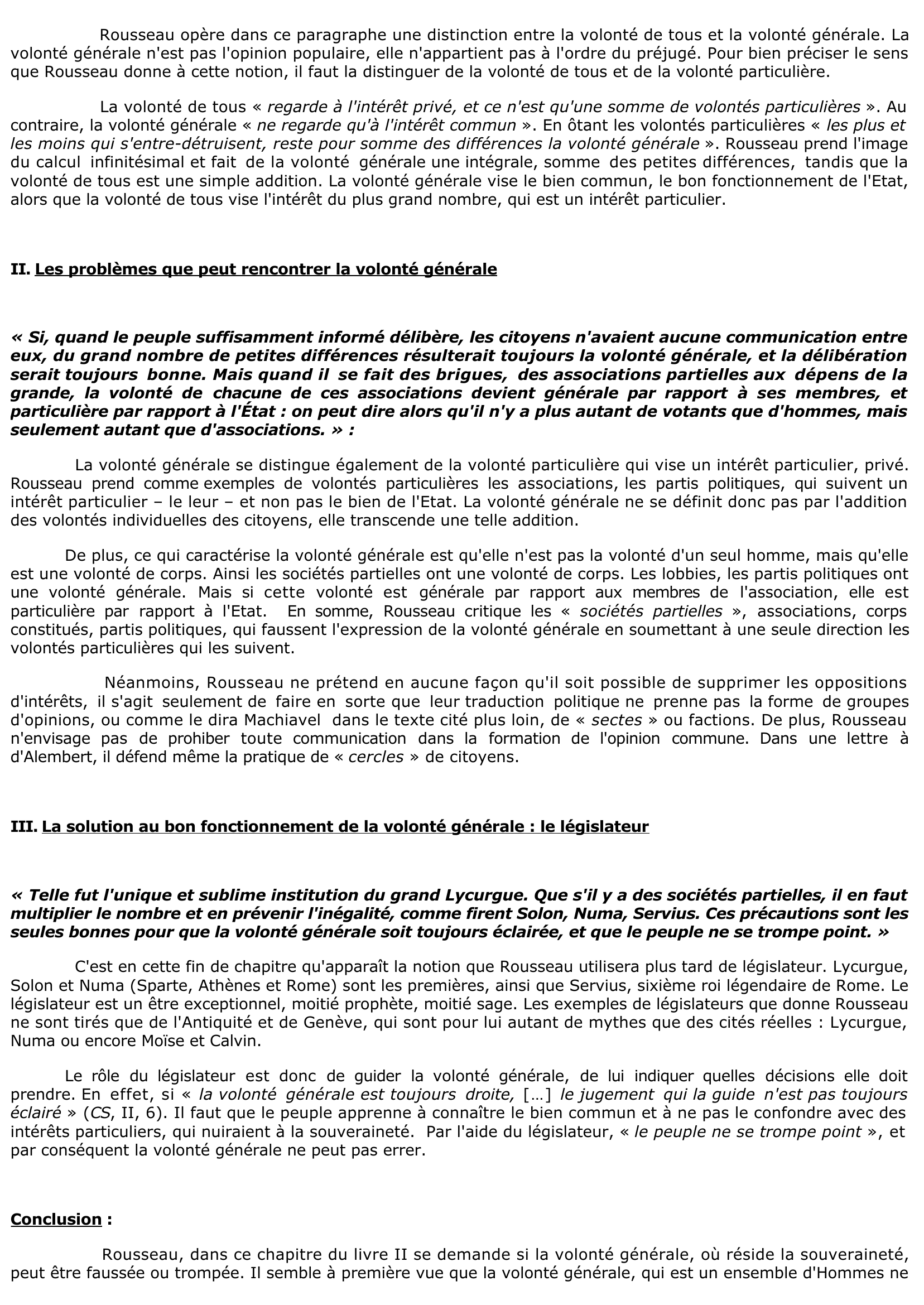Du Contrat Social, II, 3 de ROUSSEAU
Publié le 07/03/2011

Extrait du document

« Chacun de nous met en commun sa personne et toute sa puissance sous la suprême direction de la volonté générale : et nous recevons en corps chaque membre comme partie indivisible du tout « (CS, I, 6). L’autorité souveraine est la volonté générale, qui est la volonté du corps social uni par le contrat social. La volonté générale est la clé de voûte de l’état Rousseauien développé dans l’ouvrage Du Contrat Social, rédigé en 1762. Dans cet ouvrage de philosophie politique, Rousseau y expose sa façon de concevoir l’Etat. Il fait résider la souveraineté dans le peuple, et non plus dans le ou les gouvernants. De ce fait, il faut avant tout éviter que les individus soient soumis à une volonté particulière, et donc qu’un seul ou quelques hommes possèdent le pouvoir de faire la loi. La solution de Rousseau consiste à remettre l’autorité souveraine entre les mains de tout un peuple. Dans le chapitre 3 du livre II, l’auteur se demande « si la volonté générale peut errer «, en un mot si elle peut se tromper.
⇒La volonté générale est-elle le meilleur moyen pour garantir la souveraineté ?

«
Rousseau opère dans ce paragraphe une distinction entre la volonté de tous et la volonté générale.
Lavolonté générale n'est pas l'opinion populaire, elle n'appartient pas à l'ordre du préjugé.
Pour bien préciser le sensque Rousseau donne à cette notion, il faut la distinguer de la volonté de tous et de la volonté particulière.
La volonté de tous « regarde à l'intérêt privé, et ce n'est qu'une somme de volontés particulières ».
Au contraire, la volonté générale « ne regarde qu'à l'intérêt commun ».
En ôtant les volontés particulières « les plus et les moins qui s'entre-détruisent, reste pour somme des différences la volonté générale ».
Rousseau prend l'image du calcul infinitésimal et fait de la volonté générale une intégrale, somme des petites différences, tandis que lavolonté de tous est une simple addition.
La volonté générale vise le bien commun, le bon fonctionnement de l'Etat,alors que la volonté de tous vise l'intérêt du plus grand nombre, qui est un intérêt particulier.
II.
Les problèmes que peut rencontrer la volonté générale
« Si, quand le peuple suffisamment informé délibère, les citoyens n'avaient aucune communication entreeux, du grand nombre de petites différences résulterait toujours la volonté générale, et la délibérationserait toujours bonne.
Mais quand il se fait des brigues, des associations partielles aux dépens de lagrande, la volonté de chacune de ces associations devient générale par rapport à ses membres, etparticulière par rapport à l'État : on peut dire alors qu'il n'y a plus autant de votants que d'hommes, maisseulement autant que d'associations.
» :
La volonté générale se distingue également de la volonté particulière qui vise un intérêt particulier, privé. Rousseau prend comme exemples de volontés particulières les associations, les partis politiques, qui suivent unintérêt particulier – le leur – et non pas le bien de l'Etat.
La volonté générale ne se définit donc pas par l'additiondes volontés individuelles des citoyens, elle transcende une telle addition.
De plus, ce qui caractérise la volonté générale est qu'elle n'est pas la volonté d'un seul homme, mais qu'elle est une volonté de corps.
Ainsi les sociétés partielles ont une volonté de corps.
Les lobbies, les partis politiques ontune volonté générale.
Mais si cette volonté est générale par rapport aux membres de l'association, elle estparticulière par rapport à l'Etat.
En somme, Rousseau critique les « sociétés partielles », associations, corps constitués, partis politiques, qui faussent l'expression de la volonté générale en soumettant à une seule direction lesvolontés particulières qui les suivent.
Néanmoins, Rousseau ne prétend en aucune façon qu'il soit possible de supprimer les oppositionsd'intérêts, il s'agit seulement de faire en sorte que leur traduction politique ne prenne pas la forme de groupesd'opinions, ou comme le dira Machiavel dans le texte cité plus loin, de « sectes » ou factions.
De plus, Rousseau n'envisage pas de prohiber toute communication dans la formation de l'opinion commune.
Dans une lettre àd'Alembert, il défend même la pratique de « cercles » de citoyens.
III.
La solution au bon fonctionnement de la volonté générale : le législateur
« Telle fut l'unique et sublime institution du grand Lycurgue.
Que s'il y a des sociétés partielles, il en fautmultiplier le nombre et en prévenir l'inégalité, comme firent Solon, Numa, Servius.
Ces précautions sont lesseules bonnes pour que la volonté générale soit toujours éclairée, et que le peuple ne se trompe point.
»
C'est en cette fin de chapitre qu'apparaît la notion que Rousseau utilisera plus tard de législateur.
Lycurgue, Solon et Numa (Sparte, Athènes et Rome) sont les premières, ainsi que Servius, sixième roi légendaire de Rome.
Lelégislateur est un être exceptionnel, moitié prophète, moitié sage.
Les exemples de législateurs que donne Rousseaune sont tirés que de l'Antiquité et de Genève, qui sont pour lui autant de mythes que des cités réelles : Lycurgue,Numa ou encore Moïse et Calvin.
Le rôle du législateur est donc de guider la volonté générale, de lui indiquer quelles décisions elle doit prendre.
En effet, si « la volonté générale est toujours droite, […] le jugement qui la guide n'est pas toujours éclairé » ( CS, II, 6).
Il faut que le peuple apprenne à connaître le bien commun et à ne pas le confondre avec des intérêts particuliers, qui nuiraient à la souveraineté.
Par l'aide du législateur, « le peuple ne se trompe point », et par conséquent la volonté générale ne peut pas errer.
Conclusion :
Rousseau, dans ce chapitre du livre II se demande si la volonté générale, où réside la souveraineté,peut être faussée ou trompée.
Il semble à première vue que la volonté générale, qui est un ensemble d'Hommes ne.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Commentaire de texte Du contrat social de Rousseau: Pourquoi la représentation du peuple est un frein à la souveraineté ?
- « DU CONTRAT SOCIAL » DE J.J. ROUSSEAU
- DU CONTRAT SOCIAL ou Principes du droit politique. Traité de Jean-Jacques Rousseau (résumé de l'oeuvre & analyse détaillée)
- CONTRAT SOCIAL OU PRINCIPES DU DROIT POLITIQUE (Du) Jean-Jacques Rousseau. Traité
- CONTRAT SOCIAL (DU), ou Principes du droit politique, 1762. Jean-Jacques Rousseau (exposé de l’oeuvre)